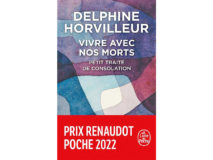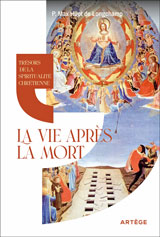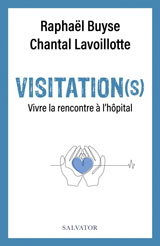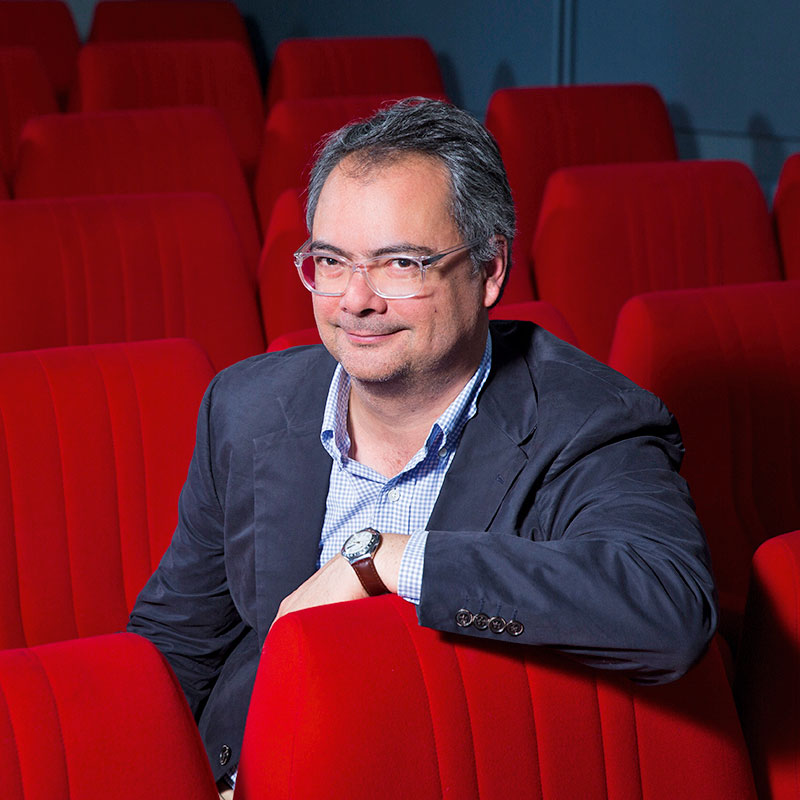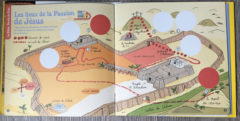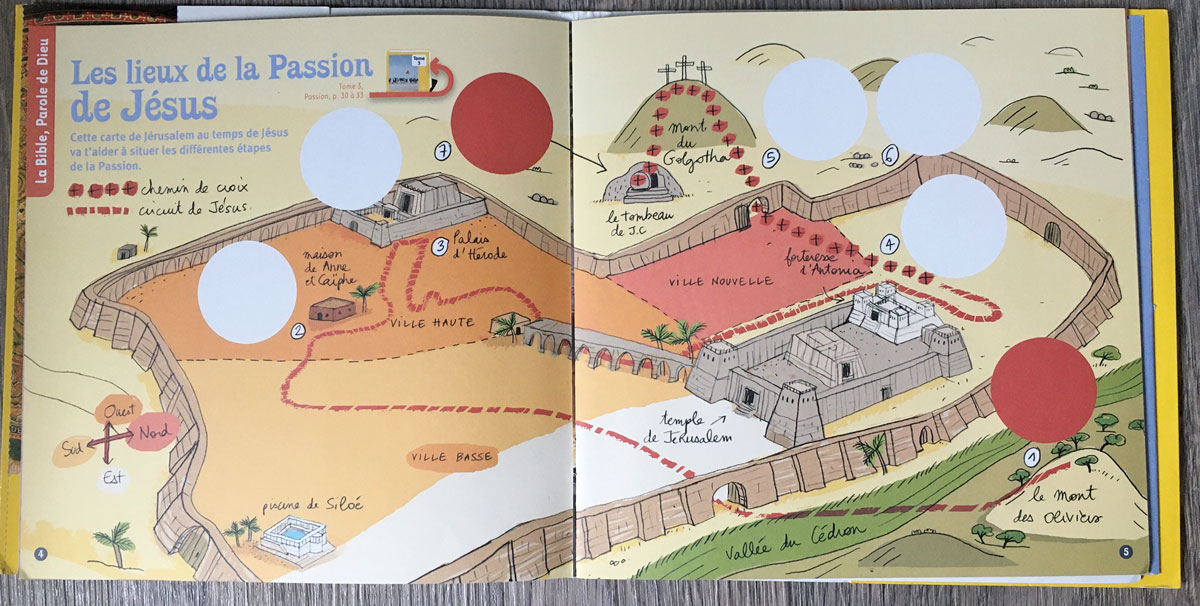C’est un pays meurtri par près de 60 ans de guerre civile que le pape François a visité lors de son voyage apostolique, en 2017. Lors d’une rencontre de prière, il a exhorté la Colombie à la réconciliation et a honoré la mémoire de Pedro Maria Ramirez Ramos. Ce prêtre, mort à cause de sa foi, fait partie des huit millions de victimes du conflit.

Par Myriam Bettens | Photo : Citizenship Word
Pedro Maria Ramirez Ramos n’avait que 49 ans. Le 10 avril 1948, il est trainé sur la place centrale de la ville d’Armero, où il dirige une paroisse. Les insultes des insurgés fusent. Ils ne veulent pas seulement tuer le prêtre, mais réclament pour lui une mort douloureuse et spectaculaire.
Fosse anonyme
Après avoir été lynché, son corps frappé à coups de machette a été laissé sur place jusque tard dans la nuit. Il a ensuite été dépouillé de ses attributs religieux et traîné à l’entrée du cimetière, dans une fosse anonyme : les fidèles ayant été empêchés de lui offrir une sépulture chrétienne.
Le crime du père Ramirez ? Alors que de violents affrontements font rage entre conservateurs et libéraux, déclenchés par la mort du dirigeant libéral Jorge Eliecer Gaitan à Bogota, des émeutes éclatent à Armero.
Le prêtre est pris à parti par les partisans de Gaitan qui accusent l’Eglise de soutenir les conservateurs aux dépens des libéraux. Le maire de la ville lui avait conseillé de fuir pour préserver sa vie. Pedro Maria Ramirez Ramos refuse d’abandonner ses fidèles et les religieuses d’Armero à leur sort. Il paie ce choix de sa vie et pourtant il pardonne. Avant que ses bourreaux ne l’achèvent, des témoins l’entendent dire : « Père, pardonne-leur… tout pour le Christ. »
Une foi vécue avec « héroïsme »
Les restes de sa dépouille, exhumés un mois plus tard par sa famille, sont aujourd’hui au cimetière de La Plata, son village natal, à environ 400 km d’Armero et devenu un important lieu de pèlerinage.
En le béatifiant lors de la visite apostolique du pape François, en 2017, l’Eglise a reconnu une foi vécue avec « héroïsme » et une mort en « haine de la foi ». Le pontife a également exhorté à la réconciliation nationale après plus de soixante ans de guerre civile.