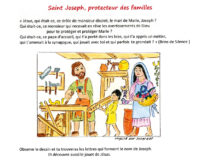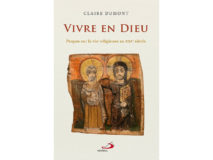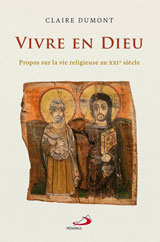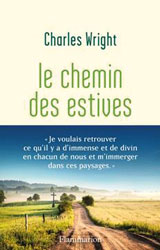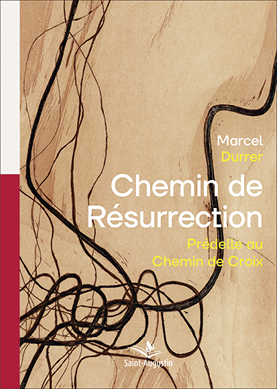C’est très tôt que Valentin décide de consacrer sa vie à la musique. Il apprend le piano dès 6 ans et à 11 ans il participe, dans le cadre de son école, à une création musicale. Là, il se rend à l’évidence que la musique fait partie de sa vie, il s’y consacrera. Il compose d’ailleurs déjà.
A 19 ans, il dirige son premier chœur à la paroisse catholique de Morges.
Valentin reconnaît volontiers devoir beaucoup aux chœurs d’église puisque c’est par eux qu’il décrochera ses premières commandes en tant que compositeur.
Travailler comme musicien professionnel, suppose des horaires de travail bien particuliers et souvent variables. Le matin est consacré à la composition, ainsi que bien souvent le début d’après-midi, puis vient le moment de préparer la répétition du soir, ensuite un entraînement à l’instrument reste indispensable. Après une petite pause, les répétitions commencent vers 19h30-20h et se prolongent facilement jusque vers 22h30.
La grande partie du travail est dédiée à la composition, puis à l’orgue car pour assurer un minimum de revenus, il faut s’investir dans plusieurs paroisses. Valentin est organiste dans quatre paroisses du Gibloux, ainsi que chef de chœur et organiste, dans notre UP, à Massonnens.
Ainsi, son travail se prolonge le week-end, entre divers concerts et toutes les prestations qu’il assure dans les paroisses. Là où cela se complique, c’est évidemment lors des fêtes religieuses qui ont lieu en même temps dans chaque paroisse. Notre musicien donne alors la priorité à Massonnens puisqu’il y est directeur et organiste, et trouve des remplaçants organistes pour les autres paroisses où il est actif.
Actuellement, Valentin dirige un chœur profane, « Elle en C » et le chœur mixte de Massonnens, qui en plus de l’animation des messes paroissiales s’adonne aussi à la musique profane, pour des concerts et parfois des cafés-théâtres.
Valentin consacre environ la moitié de son temps à la musique liturgique.
Comme dit plus haut, il est reconnaissant de l’opportunité que lui a offerte le milieu catholique qui, alors qu’il était encore adolescent, lui a passé ses premières commandes. Et durant longtemps, une grande part de son travail était dédiée à la musique liturgique. Son langage musical s’est formé avec la musique religieuse, cela faisait partie de son identité. La poursuite de sa formation rime bien sûr avec un élargissement de l’exploration et une diversification de son travail, mais qui reste, imprégné d’une grande spiritualité.
N’est-ce pas le propre de la musique et de l’art en général de nous transporter dans un monde spirituel, au-delà de notre vie corporelle ? C’est ce qui fait toute la beauté de l’art et qui le rend important dans nos vies.
Valentin exprime cela en disant que : « Pour lui la musique entraîne le compositeur dans un mouvement ascendant, de la terre vers le ciel. »
Certainement pas uniquement le compositeur d’ailleurs, mais les interprètes et les auditeurs aussi, et le manque de la période difficile que nous vivons encore, l’a fait ressentir a beaucoup d’entre nous.
Le compositeur aime le défi qu’il doit relever lorsqu’il compose pour un chœur amateur et une assemblée paroissiale. Il doit concilier qualité musicale et accessibilité à tous, tout en ayant un niveau qui motive ses chanteurs, le tout dans une tonalité, une musicalité qui porte la prière.
A ce moment de l’entretien, je lui ai demandé s’il pense alors qu’il est indispensable d’avoir la foi pour se consacrer à ce type de musique ?
Son expérience vaudoise lui ferait répondre oui, car le chœur qu’il a dirigé n’avait d’existence que pour l’animation liturgique. Depuis qu’il est dans notre canton, les chœurs chantant aussi en certaines occasions du profane, il est moins affirmatif. Mais en tout cas, le directeur et compositeur doit avoir un profond respect et une très bonne connaissance de la culture chrétienne, une bonne compréhension, une ouverture à ce monde, pour pouvoir œuvrer dans ce registre.
Avoir une porte ouverte à « quelque chose » est important, sinon il y a une forme d’hypocrisie. Il faut une cohérence entre ce que l’on fait et vit sinon les chanteurs le ressentent et l’assemblée aussi.
On dit volontiers que chanter c’est prier deux fois. Lorsque tu composes, est-ce qu’on pourrait dire que c’est prier trois fois ?
« Oh, c’est saint Augustin qui a dit ça… La musique est un art abstrait, immatérielle. Lorsque l’œuvre est achevée, on n’a rien dans les mains, on ne peut pas toucher, se saisir de la musique et en cela, je pense que la musique se rapproche de la prière, c’est un peu comme s’il y avait deux couches de spirituel l’une sur l’autre. Cet aspect impalpable fait que la musique a ce rôle de connexion spirituelle très fort.
Je ne pense pas que composer c’est prier trois fois, c’est comme écrire un roman mais on utilise des notes au lieu des lettres. Mais quand même, lorsque je compose un chant religieux, le sens des paroles me fait choisir un autre ton que pour du profane, je ne composerais pas un air de valse musette. Dans la musique religieuse, il y a un aspect transcendant, de transformation.
Ce n’est pas prier trois fois, mais me consacrer à la musique religieuse m’aide à vivre ma foi. Et j’ai le désir de faire quelque chose de beau, qui me pousse, ainsi que les chanteurs et l’assemblée, au-delà de… »