La mobilisation des gilets jaunes interpelle jusqu’à nos frontières. A travers la parole des «sans voix», de profondes inégalités refont surface. En Suisse aussi, celles-ci existent comme autant de pauvretés cachées. Quelles sont-elles et quelles sont les formes de solidarités mises en place par l’Eglise pour y remédier?
Par Pascal Ortelli
Photos : Ciric, Jean-Claude Gadmer, Pxhere, DRLa pauvreté ne diminue pas en Suisse. Tel est le constat que livre l’Almanach social 2019 de Caritas Suisse. 615’000 personnes – soit 7,5% de la population – vivent dans la précarité, alors qu’autant d’autres risquent d’y tomber. Car ces « juste au-dessus du seuil » ne reçoivent pas d’aide. Les familles monoparentales, les personnes en formation post-obligatoire et les sans-emploi représentent les catégories les plus à risque.
Parmi elles, on compte 140’000 working poor qui exercent une activité professionnelle sans pour autant arriver à boucler leur fin de mois. A cela s’ajoute le problème croissant de l’endettement des jeunes adultes. « Certains n’ont jamais appris à gérer leur salaire », explique Joëlle Renevey de Caritas Fribourg. En 2017, son service a conseillé 1078 ménages, dont 288 plus particulièrement.
Divorce et pauvreté
« ]La pauvreté touche aussi les enfants au travers des divorces, parfois sources de précarité matérielle et humaine : « Lorsque les enfants apprennent que leurs parents divorcent, ils ont peur de perdre leurs amis et leurs repères » constate Marie-France Kilchoer, animatrice au MADEP (Mouvement d’apostolat des enfants et préadolescents). C’est un grand traumatisme pour eux, sans compter que les enfants de migrants peuvent servir d’outils de dialogue pour les parents qui ne maîtrisent pas le français.
Le cri des pères divorcés commence enfin à se faire entendre. Même avec un bon salaire, certains vivent au seuil de la précarité quand ils ont fini de payer les frais de pension et le loyer élevé d’un grand appartement. La loi leur impose d’avoir suffisamment d’espace pour pouvoir accueillir chez eux leurs enfants… au risque de se ruiner !
Un chemin de confiance
Pour la première fois en Suisse romande, plus de 200 personnes en situation de pauvreté et des agents pastoraux se sont réunis à l’Université de Fribourg les 29 et 30 janvier derniers pour se rencontrer et apprendre les uns des autres afin d’ouvrir des chemins nouveaux.
Un intervenant de l’Université de la solidarité et de la diaconie raconte son combat. Marié et père de trois enfants, il est venu en Suisse pour trouver du travail afin d’aider sa famille. Tout a basculé quand il est entré dans la précarité. « J’ai tout perdu, dit-il, au moment où j’avais le plus besoin d’eux. » Comme il ne ramène pas assez d’argent, sa femme demande le divorce.
Seul et sans-abri, il ne se reconnaît plus dans son rôle de père jusqu’à ce qu’il découvre la Pastorale des milieux ouverts à Genève. « Inès, la responsable, m’a redonné confiance, en me faisant comprendre que je n’avais pas perdu ma dignité. Elle m’a recommandé de faire du bénévolat, alors que j’avais moi-même besoin d’aide » confie-t-il. Il y puise assez de forces pour « récupérer » sa famille. Aujourd’hui, même si les difficultés financières persistent, il a retrouvé la place qui lui revient.
Apprenons les uns des autres
Car, ne l’oublions pas, dans le cœur de Dieu, les pauvres ont la première place. Le Christ s’appuie sur eux pour nous révéler sa tendresse. Ils ont beaucoup à nous enseigner. La pauvreté revêt de multiples visages. D’une certaine manière, nous sommes chacun le pauvre d’un autre. Il est primordial pour l’Eglise de favoriser de tels espaces de rencontre.
Une priorité pour l’Eglise
La diaconie, autrement dit le soin et l’accueil accordés aux plus fragiles, constitue l’une des missions fondamentales de l’Eglise. Pour Pascal Tornay, assistant pastoral à Martigny et responsable du Service diocésain de la diaconie (SDD), « ce n’est pas d’abord un dicastère ecclésial, c’est l’Eglise en train d’aimer et de transformer le monde ».
Le SDD n’a pas pour but de porter seul ce souci dans le diocèse de Sion. C’est la mission de tous. « Nous cherchons à développer un réseau, assure le Martignerain, pour permettre à chacun d’être acteur dans sa communauté locale. » La proximité y est de mise.

Un « monastère » sur la place publique
Voilà presque sept ans que le Rencar remplit cette mission dans le Jura avec un camping-car transformé en lieu d’écoute. L’accueil y est inconditionnel et gratuit, grâce à une équipe de plus de 30 personnes.
« Certains viennent juste pour un café ; d’autres sur rendez-vous ou d’une manière inattendue pour parler de leurs problèmes. » De plus en plus d’adolescents franchissent la porte. « Ils y trouvent un refuge où ils peuvent déposer leurs problèmes, sans que cela soit balancé sur les réseaux sociaux », confie Isabelle Wermelinger, animatrice au Rencar.
L’un des défis, pour elle, consiste à mieux habiter l’espace public. « Le Rencar, c’est un peu comme un monastère itinérant. On peut choisir de passer plus loin ou de s’y arrêter, avec la certitude d’y être reçu et écouté. »

Une attention aimante
Liberté, gratuité et don de soi dans la relation, vécus fraternellement au nom de l’amour du Christ et du prochain. La mission de l’Eglise consiste à être encore là quand toutes les autres portes sont fermées. Aujourd’hui, elle est invitée peut-être à mieux aider ces « 600’000 autres », vivant avec peu et sans aide, juste au-dessus du seuil de pauvreté. Et de leur prêter, selon le vœu du pape François, une « attention aimante qui honore l’autre en tant que personne et recherche son bien ».
Seuil de pauvreté et aide sociale
Le seuil de pauvreté est fixé par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) à Fr. 2247.– par mois pour une personne seule et Fr. 3981.– pour un ménage de deux adultes et deux enfants au-dessous de 14 ans.
Depuis 2010, les demandes d’aide n’ont cessé d’augmenter. On dénombre 278’345 cas en 2017, soit 5000 personnes de plus qu’en 2016. Or l’aide sociale ne garantit déjà plus le minimum vital. Le montant moyen dépensé par une personne seule (hors primes d’assurance-maladie et loyer) s’élève à Fr. 1082.–, tandis que le forfait moyen d’aide actuellement fixé par la CSIAS est de Fr. 986.–.
Accompagner les détresses paysannes
Maria Vonnez et Pascale Cornuz, de l’aumônerie agricole vaudoise, assurent une présence d’écoute auprès des paysans en détresse. Le risque de suicide y est en effet 37% plus élevé que dans le reste de la population suisse. Une formation de prévention au suicide, destinée aux professionnels en relation directe avec les paysans, a été mise sur pied, afin de créer un réseau de « sentinelles ». « Mon rôle, dit Maria Vonnez, est d’arriver à ce qu’ils s’accrochent de nouveau à l’espérance. »[thb_image image= »3616″ img_link= »url:%2Fwp-content/uploads/2019/02/Graphique_pauvrete. »]


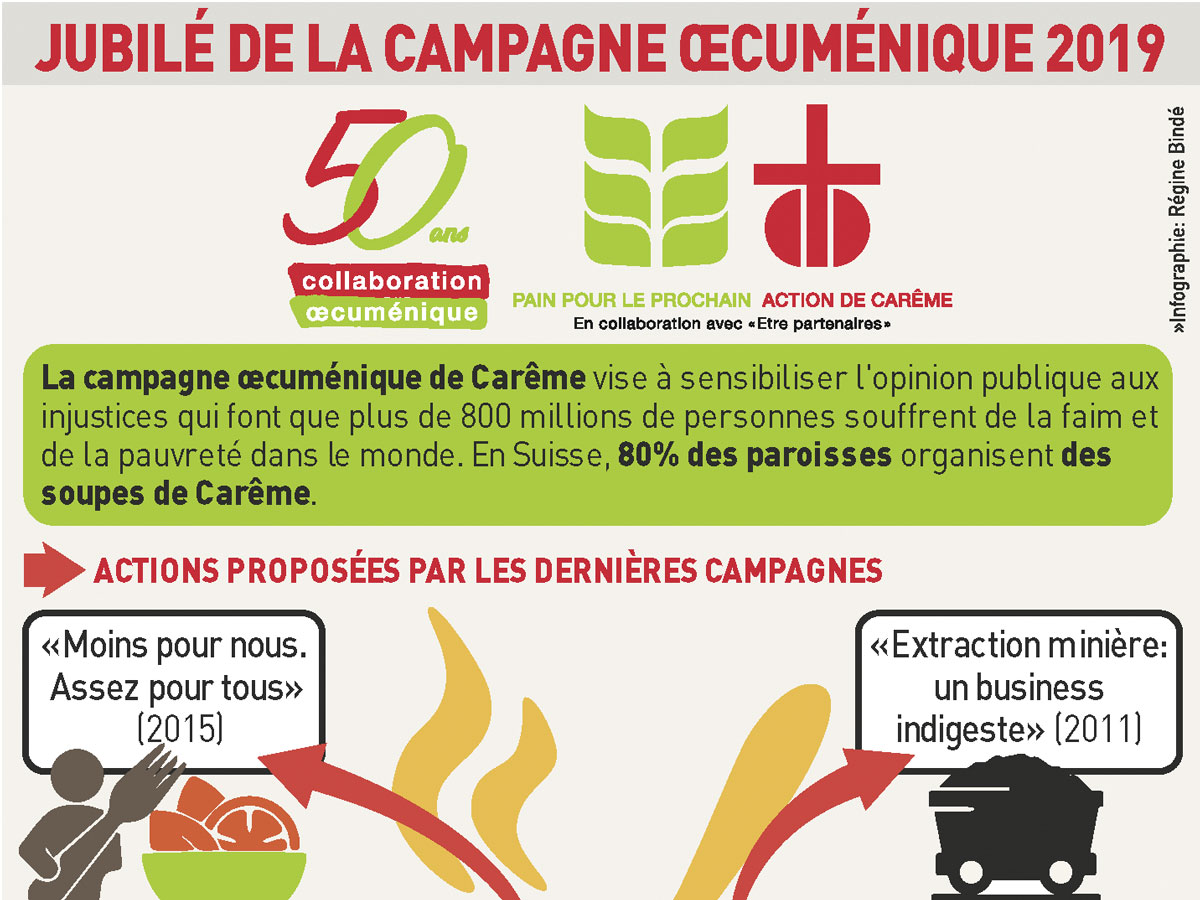
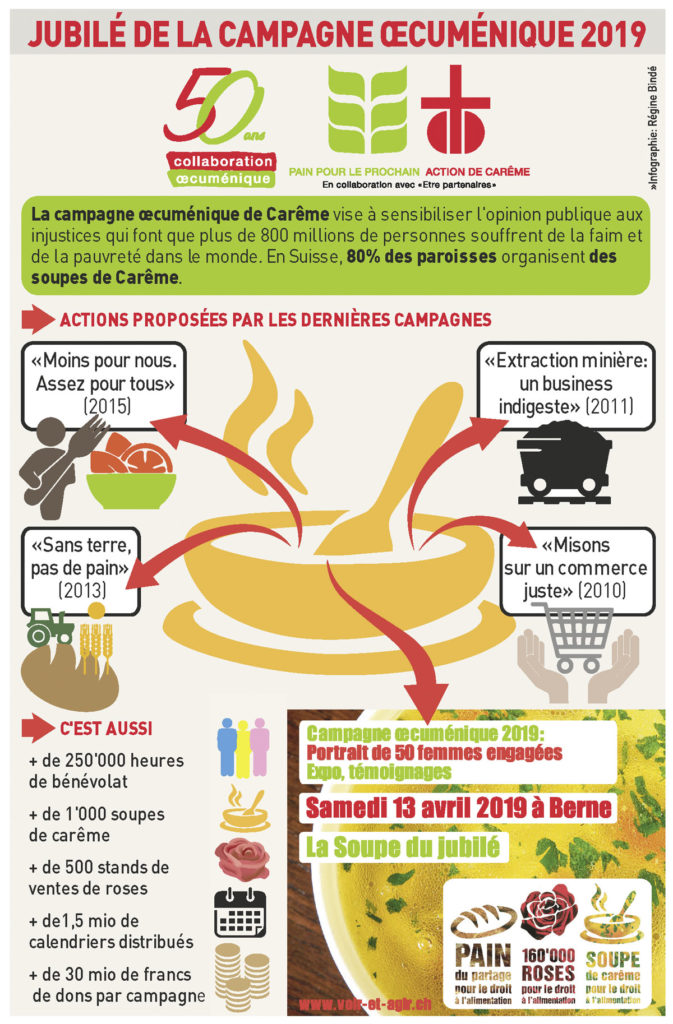










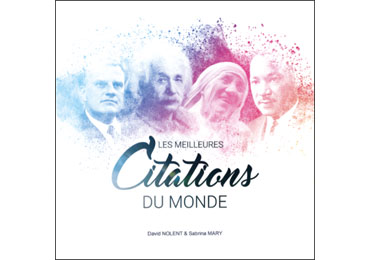
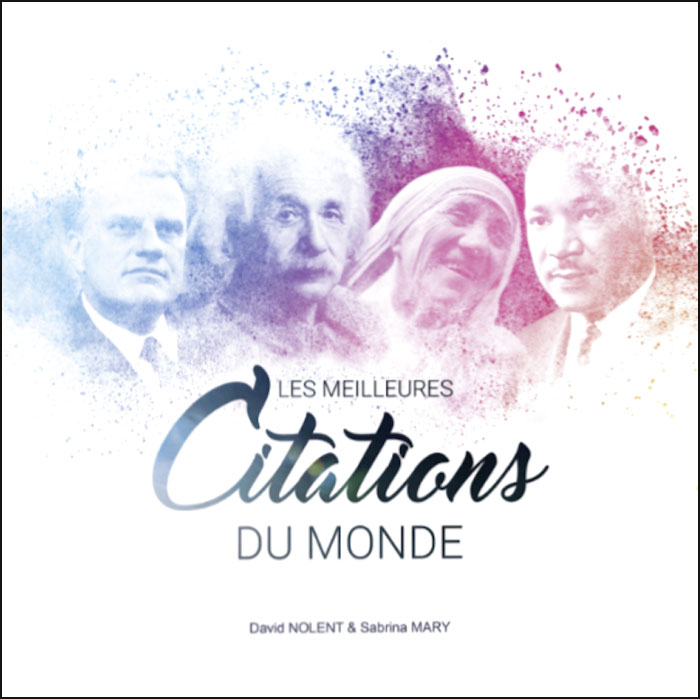 Les meilleures citations du monde
Les meilleures citations du monde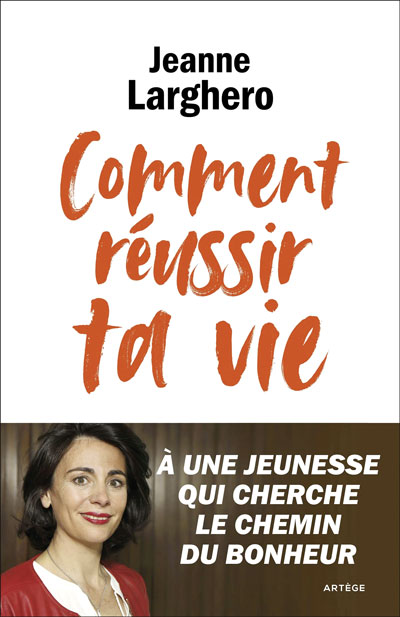 Comment réussir ta vie
Comment réussir ta vie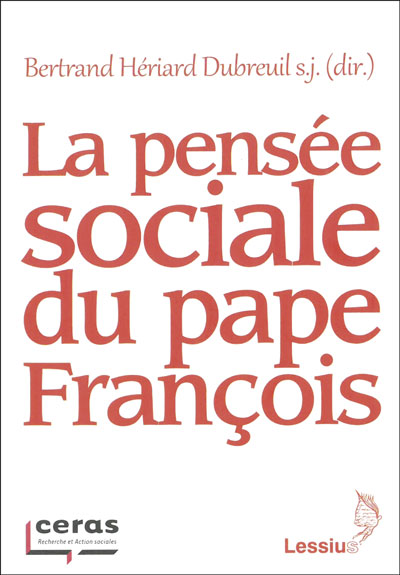 La pensée sociale du pape François
La pensée sociale du pape François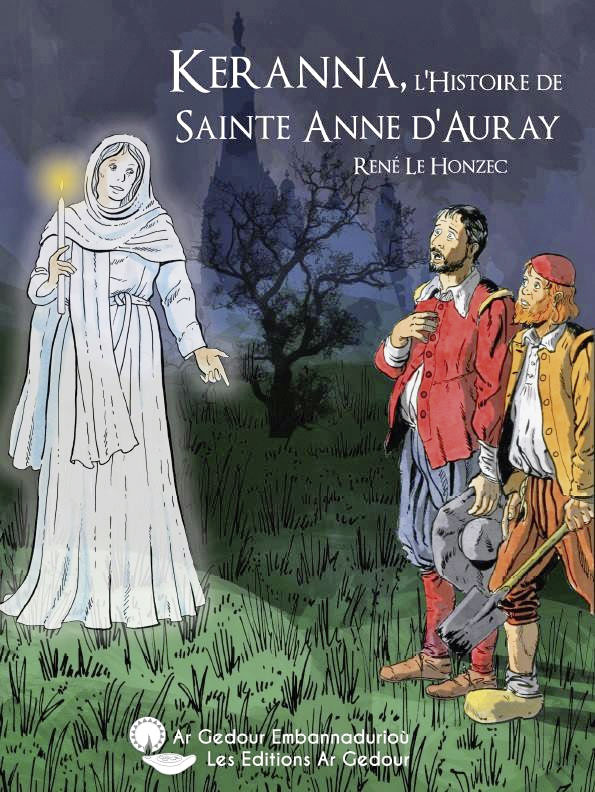 Keranna, l’histoire de Sainte Anne d’Auray
Keranna, l’histoire de Sainte Anne d’Auray

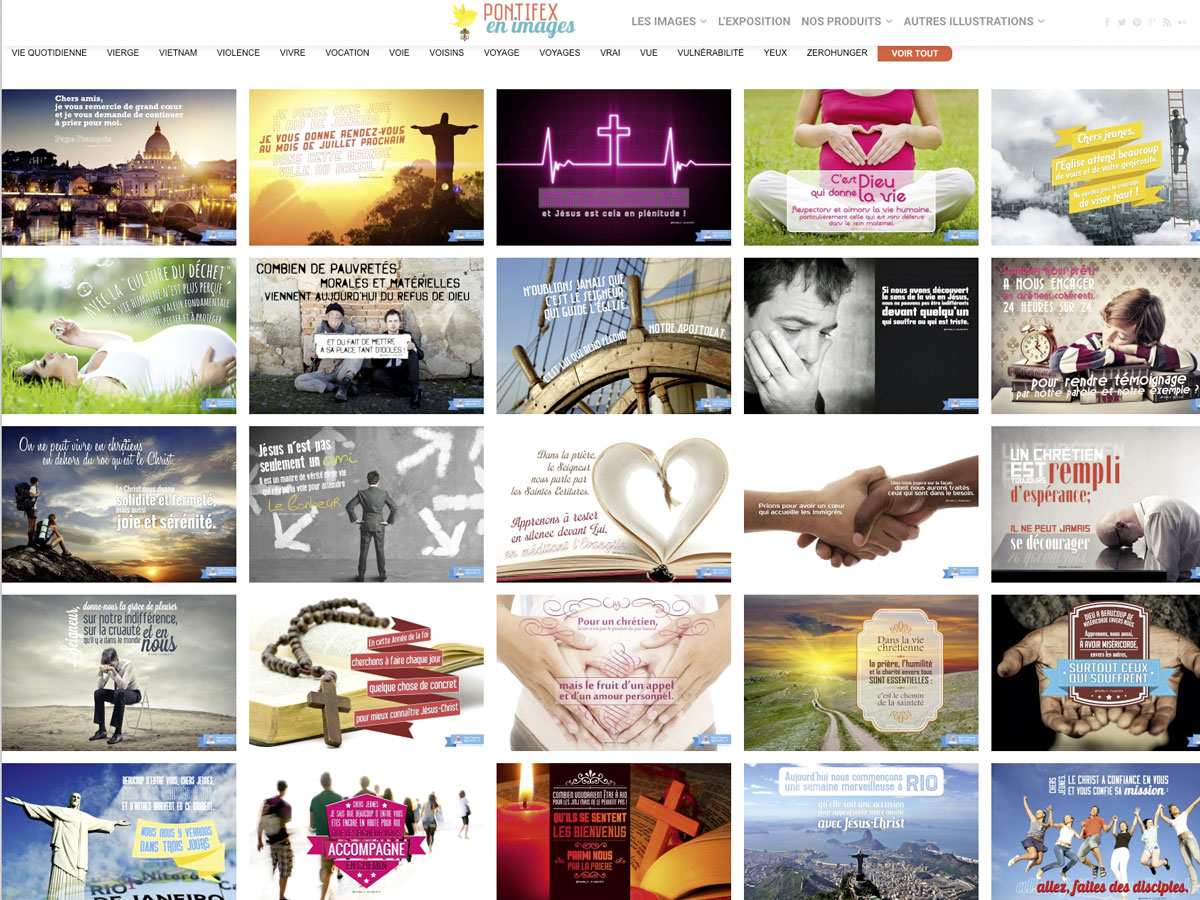
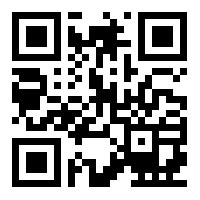









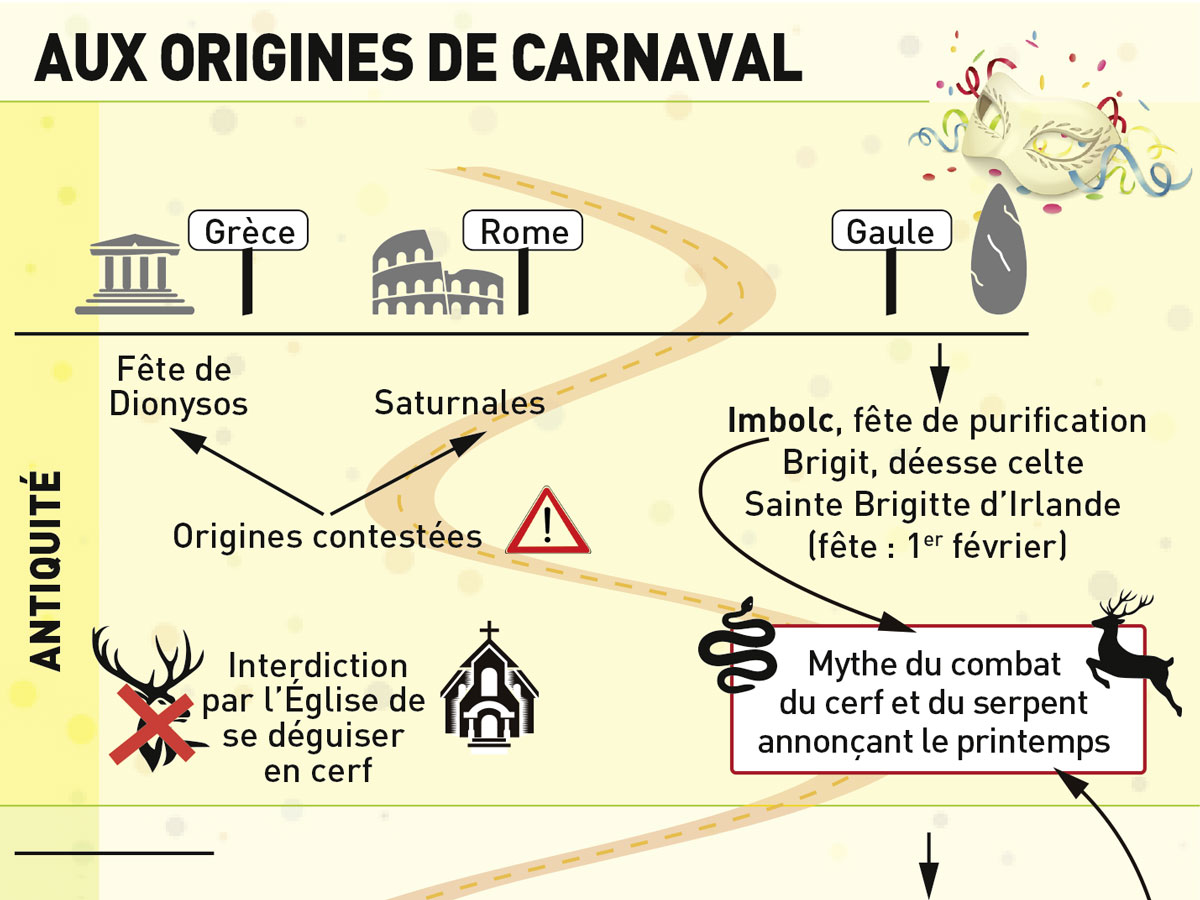
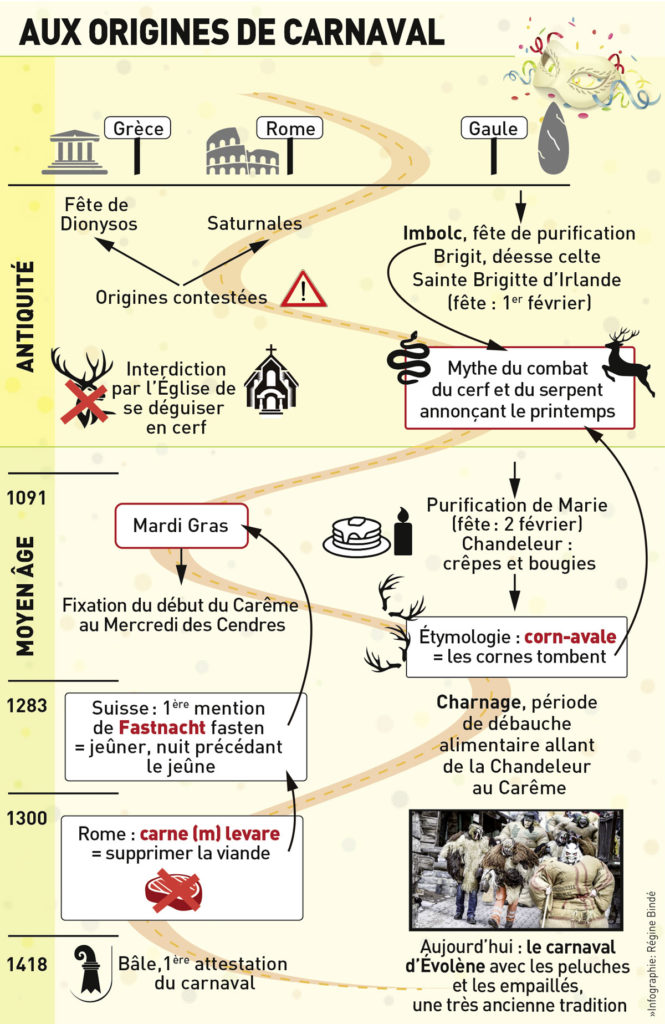


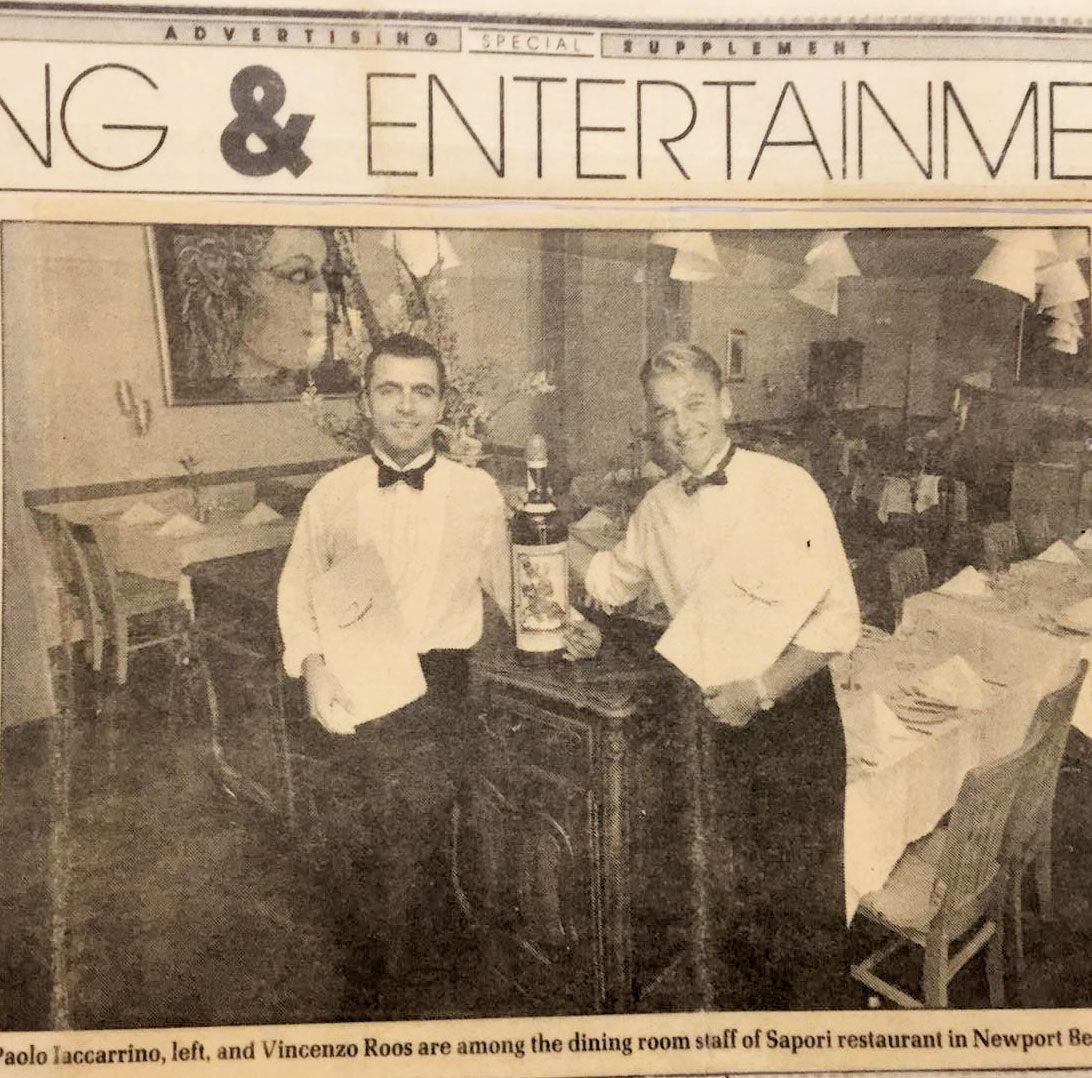
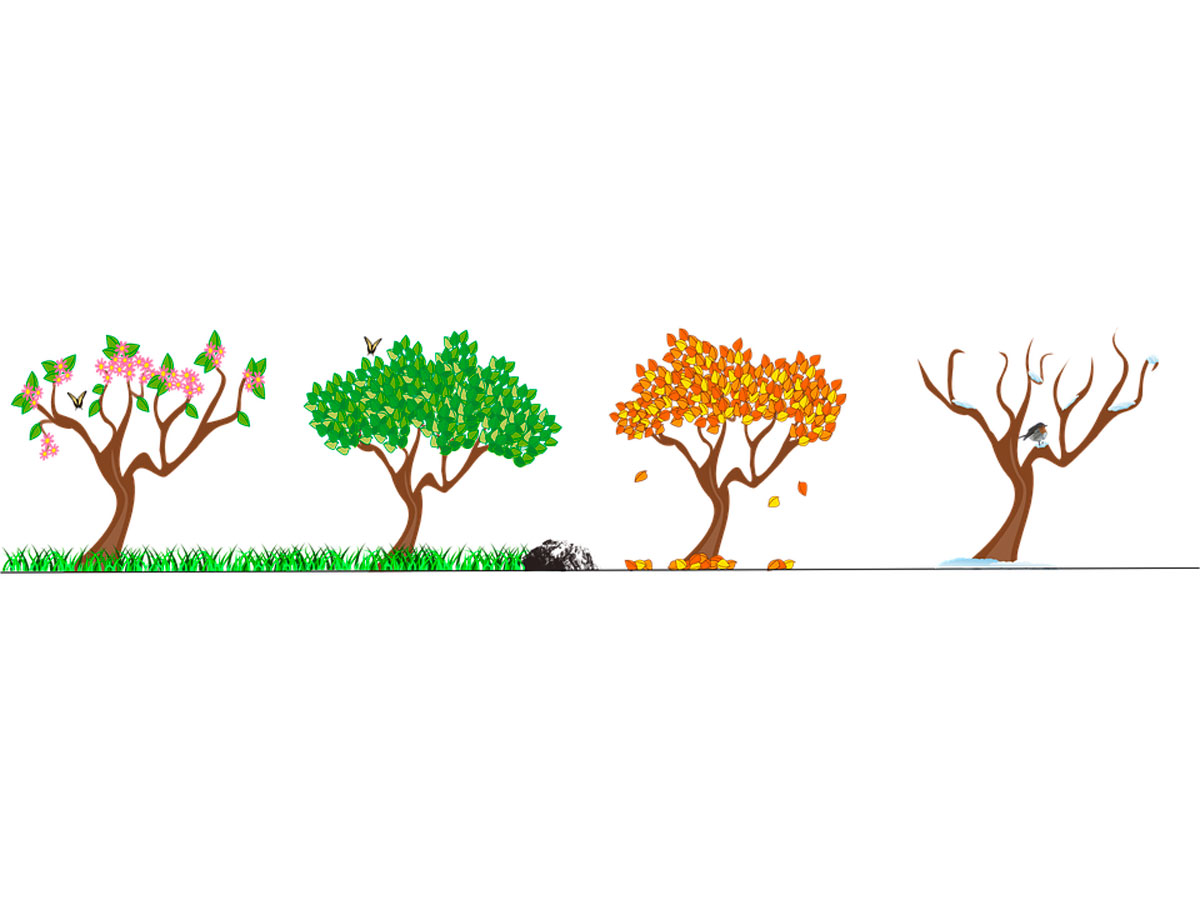

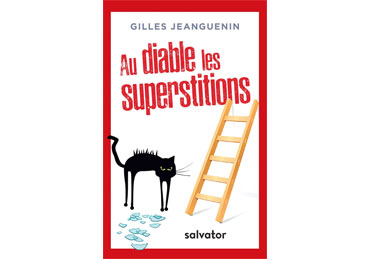
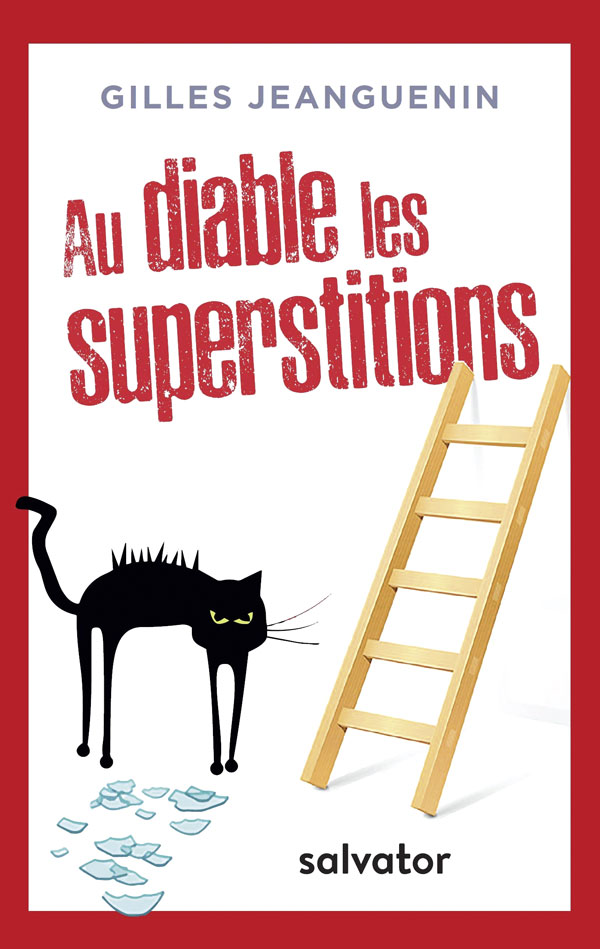 Au diable les superstitions
Au diable les superstitions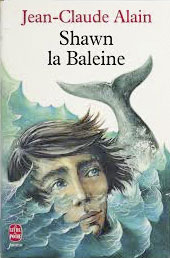 Shawn la Baleine
Shawn la Baleine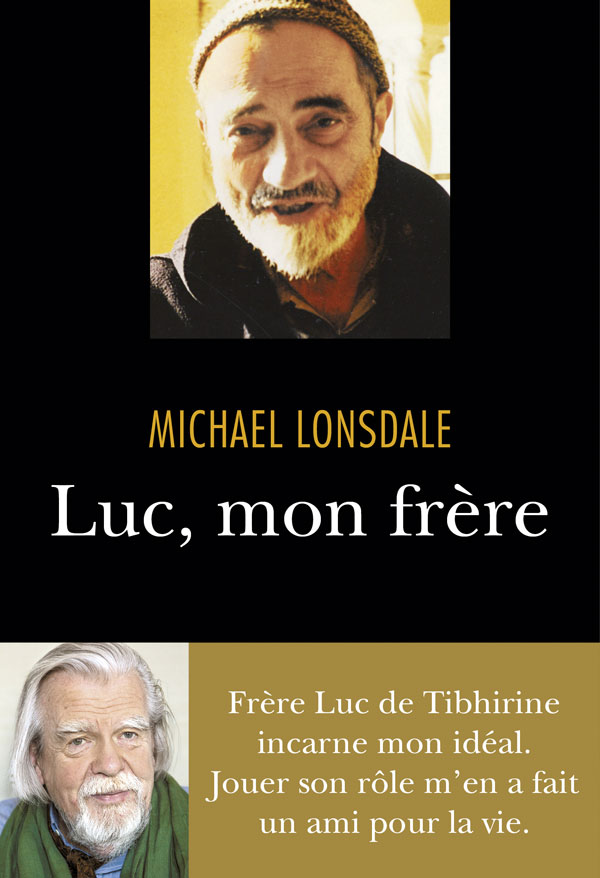 Luc, mon frère
Luc, mon frère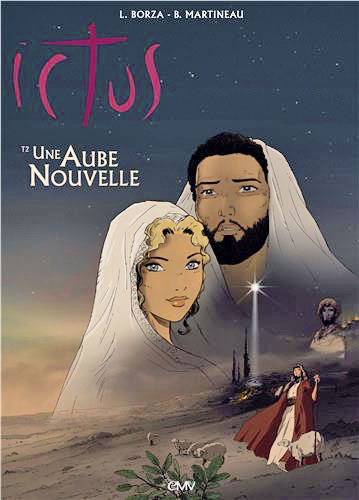 Ictus – Une Aube Nouvelle
Ictus – Une Aube Nouvelle