Woke, voilà un terme en vogue ! Utilisé à toutes les sauces, on ne parvient toutefois pas si bien à le définir, si ce n’est qu’il a une connotation plutôt péjorative. A bien y regarder, il ressemble étrangement à un puritanisme… sans théologie.
Par Myriam Bettens | Photos : AdobeStock, Unsplash, DR
Force est de constater que si ce mot n’est pas celui de l’année, il est au moins celui de ces dernières années. Le terme woke désigne en anglais le fait d’être éveillé, conscient et en alerte face aux inégalités. Plus que toute autre occurrence issue du vocabulaire identitaire, ce terme décrit bien les affrontements politiques et culturels entre une gauche « progressiste » et une droite « conservatrice ». Outre l’aspect politique patent que ce terme revêt, les détracteurs de la « culture woke » – à la fois pour dénoncer et mettre en garde contre son importation sous nos cieux – ont tendance à recourir au lexique religieux dans leur critique. De la simple comparaison jusqu’à, parfois, l’assimilation.
La paresse intellectuelle comme vertu
L’utilisation de l’analogie religieuse comme outil d’analyse de faits sociaux dans le registre des sciences humaines et sociales n’est pas nouvelle. Déjà en 1941, le philosophe et sociologue français Raymond Aron proposait l’expression de « religion séculière »1. Mais on peut se demander si, ici, l’analogie religieuse est propre à nous aider à saisir le phénomène du wokisme en lui-même. Or, dans un essai sur les limites de l’analogie religieuse2, la sociologue française Nathalie Heinich pointait le risque d’un tel procédé, qui, « par un effet d’aspiration, tire vers « le religieux » tout ce qui, de près ou de loin, y ressemble, sans que ne soit jamais discutée la pertinence d’une telle assimilation ».
Pour reprendre ses termes, « l’effet d’aspiration » produit une certaine paresse intellectuelle. Dans ce cas précis, le wokisme n’est plus analysé pour lui-même, mais uniquement par le prisme du religieux. Cette comparaison induit aussi un transfert des attributs de la religion – renvoyant l’image d’un christianisme dans sa version la plus fondamentaliste – au mouvement woke. L’intolérance, le refus du dialogue, le fanatisme ou encore le dogmatisme deviennent alors des qualificatifs de la culture woke. En outre, cette analogie a pour conséquence d’inciter à penser qu’il existe une unité, une vision, voire un programme au sein du wokisme, alors qu’il demeure tout au plus un mouvement.
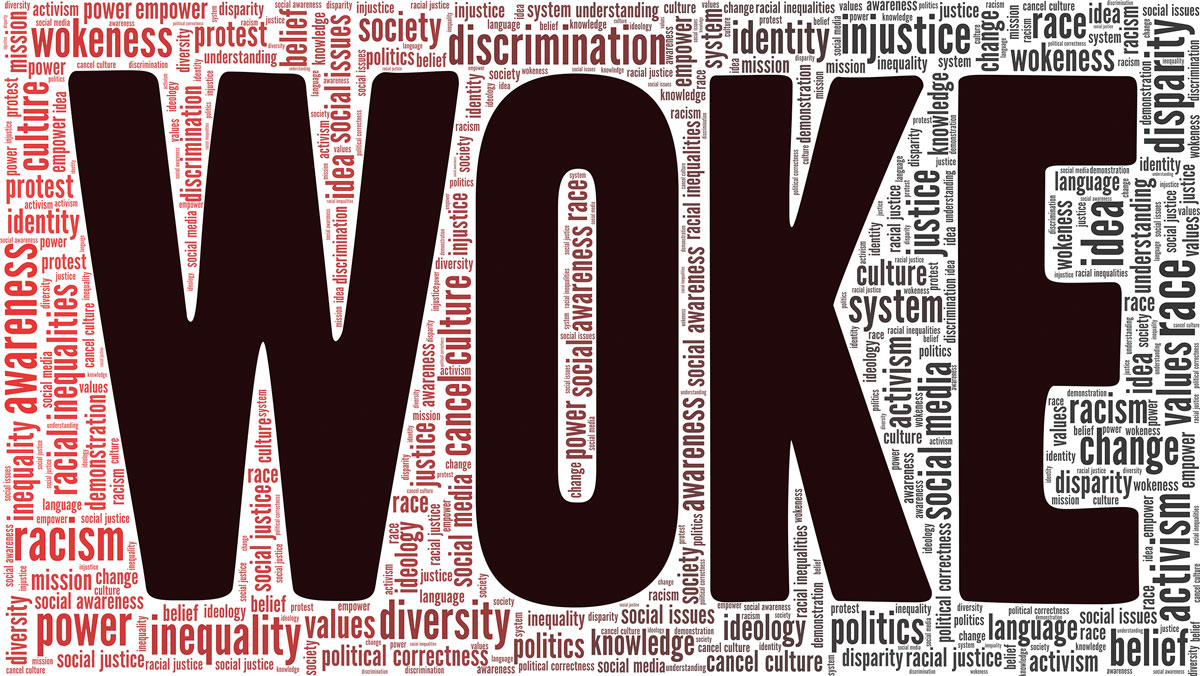
Une rhétorique de saturation
Ce qui devrait rester un outil au service d’une démonstration en devient la fin et « le problème avec l’analogie religieuse n’est pas qu’elle soit fausse, mais bien qu’elle ne soit jamais fausse »3. Les caractéristiques apparentées au religieux de la culture woke – moins pour comparer que pour dénoncer – et son assimilation à une nouvelle religion sont toujours opérées sur le mode de l’évidence. L’exemple le plus emblématique se trouve dans La religion woke 4 de Jean-François Braunstein. Les militants « prêchent », leurs actions sont « des rites » et ils sont conduits par un ensemble de « textes sacrés » regroupés en « missels ». C’est ce procédé rhétorique de saturation du texte au moyen du lexique religieux qui finit par conférer à la culture woke sa dimension religieuse ! Par contre, aucune trace du pourquoi le wokisme serait une religion. Le Mystère se trouve peut-être là…
Il est vrai que la sémantique invite à franchir le pas par son appellation même. Le terme woke [ndlr. éveillé] évoque les vagues de Réveil religieux qui ont marqué toute l’histoire des Etats-Unis depuis le XVIIIe siècle. Si l’éveil peut être une caractéristique de la religion, celle-ci n’en a pas l’exclusivité. Rappelons le philosophe Kant se félicitant d’avoir été « réveillé de son sommeil dogmatique » par son homologue écossais Hume, ou encore les thèses conspirationnistes reprenant à leur compte la thématique de l’éveil. Si un rapprochement semble tout à fait légitime, une assimilation ne l’est en revanche pas.

Une « quasi-religion » civile
Dans une longue analyse5 réalisée pour l’Institut Religioscope de Fribourg, l’historien Olivier Moos avance qu’« un certain nombre d’auteurs ont utilisé le modèle du Great Awakening [ndlr. Grand Réveil] pour analyser le phénomène woke à la manière d’un surgissement culturel et révolutionnaire, comme l’émergence d’une nouvelle « religion civile », ou encore la manifestation d’un post-protestantisme débarrassé de sa théologie ». Il souligne que « le wokisme fonctionne à la manière d’un système de croyances, mais n’est pas pour autant une religion. […] Une partie des idées et des attitudes adoptées par les militances progressistes reproduisent des croyances et des comportements que l’on observe plus couramment dans certains groupes religieux fondamentalistes ».
Il cite l’obsession de la pureté et du péché, la certitude de jouir d’une infaillibilité morale, la condamnation de l’hérésie ou encore l’autorité indiscutable des écritures. Le wokisme, tout comme les systèmes religieux, offre à ses adeptes un système interprétatif de la société, avec ses normes, ses valeurs et ses dogmes. « Ayant émergé dans un univers culturel profondément influencé par le protestantisme, il n’est pas surprenant que de nombreuses valeurs et pratiques woke puissent reproduire, inconsciemment, des éléments de cet héritage. Cependant, les intellectuels de cette mouvance revendiquent de produire du savoir et de l’expertise, et non du spirituel. » En d’autres termes, il manque au wokisme sa dimension proprement métaphysique.
Eveil et crépuscule
Le chercheur fribourgeois reconnaît que « tant les comportements des activismes qu’une partie du corpus de la Social Justice prêtent aisément le flanc à une analogie religieuse » en transférant la sensibilité morale du protestantisme dans le champ politique « alors que le cadrage métaphysique s’est étiolé ». Cela a « entraîné non seulement une moralisation de la politique, mais aussi une érosion de la frontière entre cette dernière et le religieux ». Il déplore l’absence de « garde-fous théologiques » dans ce mouvement. A l’image d’un « corpus théologique, qui se serait construit à travers des siècles d’affinage et de conciles, procurant ainsi un cadre normatif à des notions de justice, de péché ou de rédemption. Ces idées, libérées de leur cadre et réintroduites dans une religiosité révolutionnaire, risquent l’emballement ». Le Royaume des Cieux ne demeurerait alors plus que l’ambition d’établir en ce monde une société parfaitement égalitaire, « quels qu’en soient les coûts ».
1 Raymond Aron, L’avenir des religions séculières, in Raymond Aron, Une histoire du XXe siècle. Une anthologie, Paris, Plon, 1996.
2 Nathalie Heinich, Des limites de l’analogie religieuse, Archives de sciences sociales des religions, n° 158, 2012, pp. 157-177.
3 Eric Maigret, Du mythe au culte… ou de Charybde en Scylla ? Le problème de l’importation des concepts religieux dans l’étude des publics des médias, in Philippe Le Guern (dir.), Les cultes médiatiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002, pp. 97-110.
4 Jean-François Braunstein, La religion woke, Paris, Grasset, 2022.
5 Olivier Moos, The Great Awokening : réveil militant, justice sociale et religion, sur www.religion.info/2020/12/31/great-awokening-reveil-militant-justice-sociale-et-religion



