Le voile signifie bien davantage qu’une simple pièce de vêtement. Il peut protéger, envelopper, séparer, délimiter, dissimuler… Symbole lié au mystère, il traverse allégrement les siècles. A la fois jeteur de ponts ou obstacle infranchissable, il poursuit son influence dans l’espace profane (public) comme l’espace sacré (privé).
Par Nicole Andreetta
Photos: Ciric, DRDans les temps antiques, on associait la chevelure féminine à la magie sexuelle. Les cheveux étaient séduisants, et donc dangereux.
Une loi assyrienne (XIe siècle avant Jésus-Christ) recommande aux femmes mariées, aux veuves… de ne pas laisser leur tête sans voile… Le voile de la femme mariée marque une limite entre le mari et les autres hommes.
Moïse et le prophète Muhammad se voilent à proximité de Dieu, par crainte et respect pour son mystère insondable. Dans la tradition judaïque, le talith (châle de prière recouvrant la tête) permet aux pratiquants d’entrer dans un espace consacré à la prière.
A la mort de Jésus, le voile qui séparait le Saint des saints se déchire. Dieu est alors dévoilé.
Selon saint Paul, l’homme, image et gloire de Dieu, n’a pas besoin de se couvrir la tête pour prier. En revanche, la femme, subordonnée à son mari, en a l’obligation 1. Cette pratique a été abolie en 1983 par le pape Jean-Paul II.
En prenant le voile, les moniales signifient une vie consacrée au Christ, l’humilité face à Dieu et le renoncement à un attribut de beauté.
Le Coran recommande aux femmes du Prophète de se voiler lorsqu’elles sortent afin de ne pas être importunées 2. Ailleurs, il enjoint les femmes à se couvrir et observer un comportement modeste 3. Le voile agit ainsi comme une protection 4 qui permet de franchir les limites de la maison, c’est-à-dire celles entre hommes et femmes.
Le tournant des Lumières
Les Lumières marquent une rupture entre Orient et Occident. Les sciences développent des techniques qui permettent de « voir » la « vérité ». La pensée rationnelle vise la maîtrise et le contrôle de l’insaisissable. Le religieux est ramené à la sphère privée.
La démocratie prône la liberté, l’égalité, la transparence, valeurs qui s’accommodent mal avec le port du voile dans l’espace public.
1 1 Co 11, 2-16
2 XXXIII, 59
3 XXIV, 31
4 C’est la signification du mot hidjab
Echos et résonances : quatre femmes vivant en Suisse romande témoignent de leur démarche personnelle
Kadriye, 37 ans, travaille dans un EMS
Lorsque j’étais jeune, en Turquie, je ne portais pas le voile. Je l’ai mis après le mariage. Dans ma belle-famille, toutes les femmes le portaient. Cela faisait partie du contexte social dans lequel je vivais et j’y ai trouvé du sens.
Je vis en Suisse depuis huit ans et je suis séparée de mon mari. Je dois construire l’avenir de mes enfants. Il m’a fallu trouver un emploi stable qui me permette d’obtenir une autorisation de séjour. J’ai compris qu’il fallait renoncer au voile. Cela m’a fait mal au cœur. Pendant quelque temps, je ne me sentais pas à l’aise.
Maintenant, je travaille et je suis en paix. J’ai donné la priorité à la vie. C’est aussi une manière d’être proche de Dieu, comme la prière.
Je n’ai jamais porté le voile dans l’idée de marquer une différence. Mais, je sentais que, dans le bus, on hésitait parfois à s’asseoir à côté de moi. Cela n’arrive plus maintenant.
Je souhaite que l’on respecte les femmes qui portent le voile car on ne sait pas ce qu’il y a au fond de leur cœur.
Subhan, 26 ans, prépare son brevet d’avocate
Je suis née en Irak, mais j’ai passé toute mon enfance en Valais. J’ai mis le voile à 13 ans dans le respect de mes principes religieux.
Maintenant, j’ai compris pourquoi je le porte. Dans le Coran, il signifie la modestie. C’est pourquoi je prends la liberté de le mettre.
Quoiqu’on dise, même en Occident, la société est patriarcale. La femme est toujours considérée comme un objet. Il n’y a qu’à regarder les publicités dans la rue. Je refuse d’être vue juste sur mon apparence physique. En même temps je préférerais être davantage anonyme, car pour moi le voile est une pratique religieuse liée à ma foi, non un symbole. Mais nous vivons en Suisse et parce que des musulmanes le portent, le voile est devenu, ici, le symbole de l’islam.
Jusqu’à présent j’ai refusé les jobs où je devais enlever le voile. Je ne sais pas si cela sera toujours possible…
Sœur Catherine, 70 ans, sœur de Saint-Augustin
Notre congrégation a été fondée en 1906. Les sœurs portaient une longue robe noire, leurs cheveux étaient rassemblés en chignon.
En 1964, après le Concile Vatican II, il fut enjoint aux ordres religieux de réfléchir à la manière de revenir « aux sources ». C’est à ce moment, qu’ensemble, nous avons décidé de porter le voile. Cela permettait de mettre en avant le vœu de pauvreté en évitant des frais inutiles et des comparaisons futiles.
Dans le train, j’ai parfois l’impression que l’on m’évite. Mais il arrive aussi que l’on me cherche pour me parler ou poser des questions.
Sœur Béatrice, 66 ans, sœur de Ste-Ursule, Fribourg et Genève
Dans notre congrégation, nous avons depuis quelques années la possibilité de porter ou non le costume.
J’ai choisi de porter le costume, par conséquent, je porte également le voile. C’est ma manière de témoigner de mon engagement au service de Dieu et des autres.
J’ai longtemps travaillé à Fribourg, dans un collège. Je me suis toujours trouvée à l’aise. En revanche, pour les sœurs travaillant dans le milieu social, le costume n’était pas toujours recommandé.
Maintenant retraitée, je vis à Genève avec trois sœurs qui ont choisi l’habit civil. En déménageant, j’avais décidé que selon mes engagements, je demanderais de porter l’habit civil.
Je participe à l’animation liturgique à la prison de Champ-Dollon. Je m’attendais, conformément aux lois genevoises 5, à devoir enlever mon voile et ma croix. Personne ne m’a interpellée dans ce sens – et bien des gardiens me saluent par « ma sœur ».
Un jour par semaine, je fais de la marche. Je porte alors des jeans, c’est plus adapté !
5 La législation genevoise actuellement en vigueur et celle qui est encore en projet tendent à limiter la port de signes religieux ostentatoires.Conclusion
Le port du voile brouille les cartes quant à la place de la femme et du religieux dans notre société.
Les personnes qui nous ont fait présent de leur témoignage soulignent la cohérence de leur choix en lien avec des valeurs que nous reconnaissons et ne font pas de ce choix une pratique figée.
S’intéresser davantage à l’histoire, aux racines, au cheminement de l’autre
permettrait d’élargir un débat par trop polarisé.
Ouvrage de référence :
Voile, corps et pudeur. Approches historiques et anthropologiques. Labor et Fides 2015
La chevelure de Marie-Madeleine
 Dans l’iconographie du Moyen Age, la figure de Marie-Madeleine réunit Marie de Béthanie, Marie de Magdala et la femme au parfum.
Dans l’iconographie du Moyen Age, la figure de Marie-Madeleine réunit Marie de Béthanie, Marie de Magdala et la femme au parfum.
Avec sa longue chevelure qui couvre sa nudité de pénitente, Marie-Madeleine personnifie la pécheresse repentante. Ses pieds nus rappellent sa vie antérieure, ses mains jointes indiquent que le pardon de Dieu s’obtient par la prière.
Plus tard, elle symbolisera, pour les protestants, la grâce de celle qui est choisie. Pour les catholiques, ardents défenseurs de la confession, elle demeurera une pénitente.
Sculpture en pierre (1311-1313) qui se trouve dans la collégiale Notre-Dame à Ecouis (Eure).
Le voile de l’homme
Dans le monde méditerranéen et proche-oriental le correspondant masculin du voile se nomme turban. Son origine remonte à la Perse antique. Dans la culture arabe et chez les sultans ottomans, le turban devait faire deux fois la taille et être plus large que les épaules.
Il pouvait ainsi servir de linceul au cas où la mort surviendrait à l’improviste. De nos jours, appelé keffieh, il est devenu l’emblème de la résistance palestinienne. Les Touaregs portent un turban composé de deux parties, celle protégeant la tête et le front et celle masquant la bouche et les narines (parties malodorantes, considérées comme honteuses). Les sikhs pratiquants enroulent leurs cheveux, qu’ils ne doivent pas couper, dans un turban.

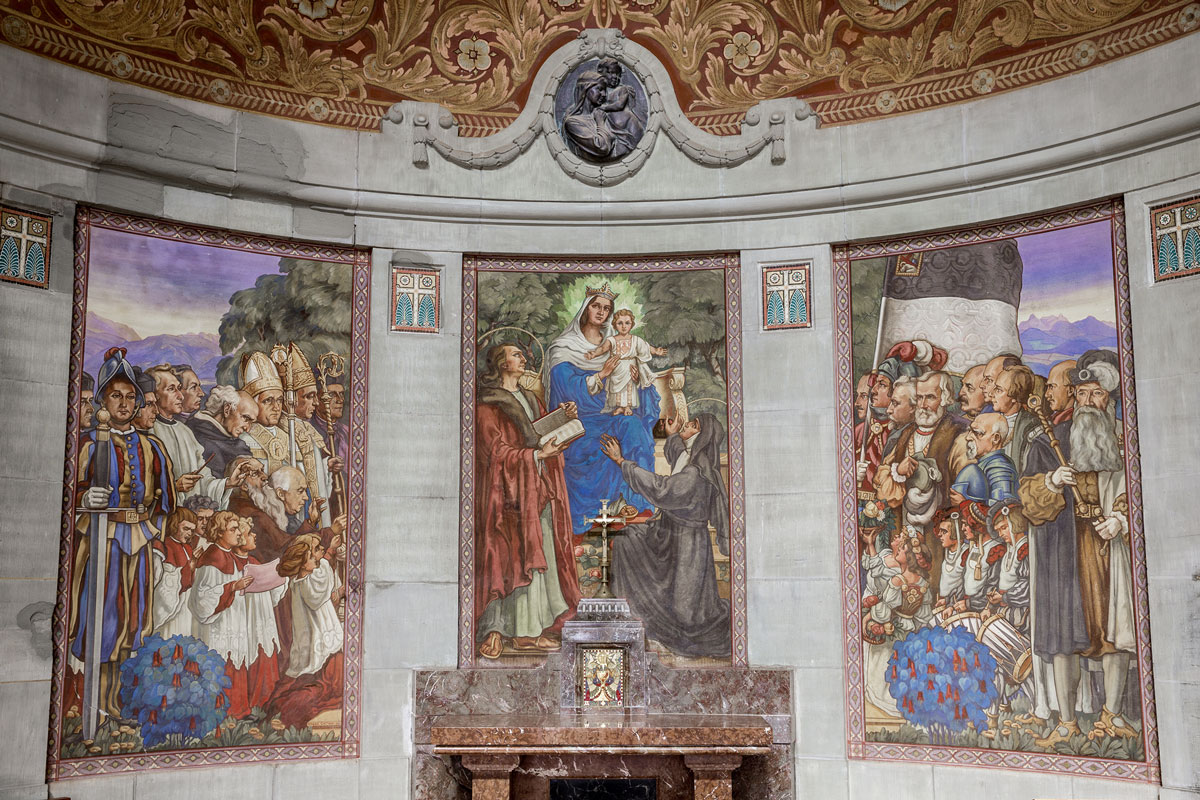



 Dans l’iconographie du Moyen Age, la figure de Marie-Madeleine réunit Marie de Béthanie, Marie de Magdala et la femme au parfum.
Dans l’iconographie du Moyen Age, la figure de Marie-Madeleine réunit Marie de Béthanie, Marie de Magdala et la femme au parfum.





 En préambule, le Président du Conseil, Walter Hauser annonce la démission de Gotthard Hegi, membre du Conseil depuis 2001. Walter Hauser souligne sa disponibilité durant ces seize années, son fidèle engagement et le plaisir de travailler avec lui. Un cadeau lui sera remis pour lui exprimer la reconnaissance de la Paroisse.
En préambule, le Président du Conseil, Walter Hauser annonce la démission de Gotthard Hegi, membre du Conseil depuis 2001. Walter Hauser souligne sa disponibilité durant ces seize années, son fidèle engagement et le plaisir de travailler avec lui. Un cadeau lui sera remis pour lui exprimer la reconnaissance de la Paroisse.




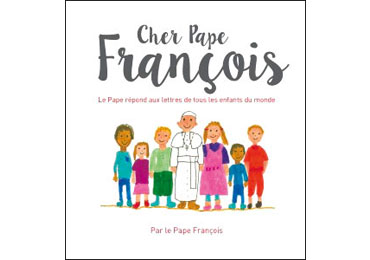
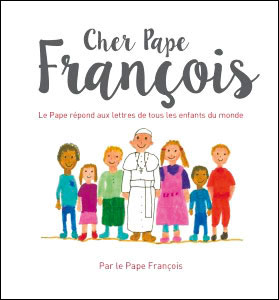 «Cher Pape François»
«Cher Pape François»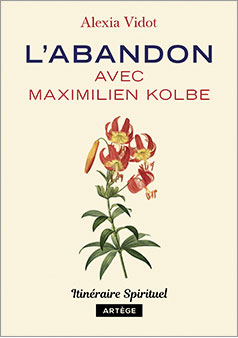 Une nouvelle collection: «Itinéraire spirituel»
Une nouvelle collection: «Itinéraire spirituel»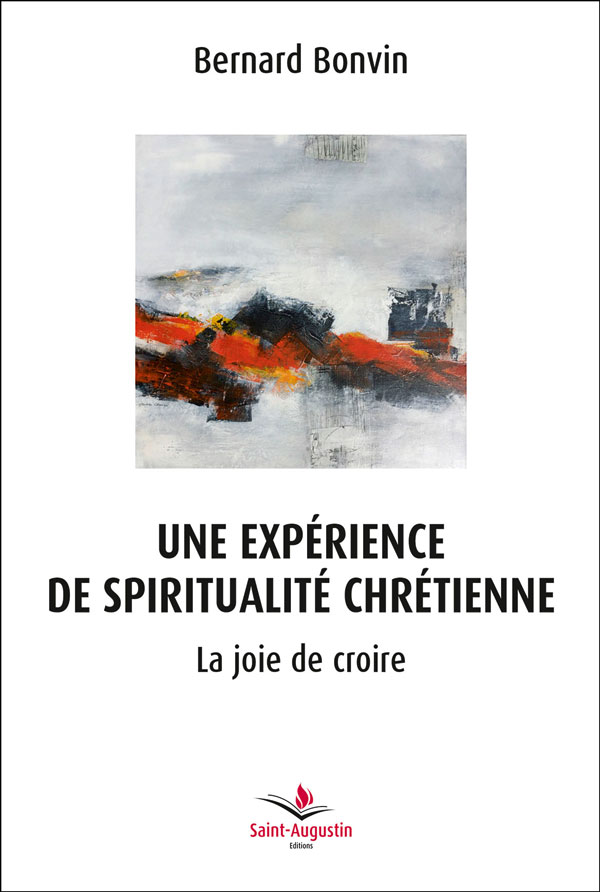 «Une expérience de spiritualité chrétienne»
«Une expérience de spiritualité chrétienne»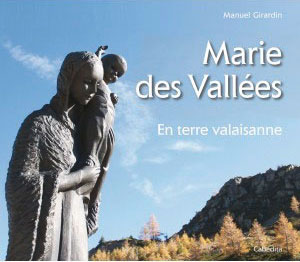 «Marie des Vallées»
«Marie des Vallées»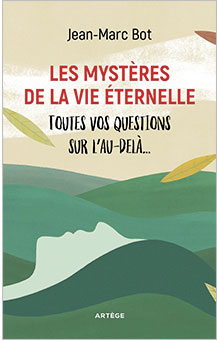 «Les mystères de la vie éternelle»
«Les mystères de la vie éternelle»






 Objet d’exception, cet ouvrage sur les monastères rattachés au Patriarcat de Moscou présente le travail photographique réalisé par Charles Xelot, avec le soutien de la Fondation Neva. Jeune photographe de talent, Charles Xelot s’est immergé durant deux ans et au cours de 24 voyages dans la vie monastique, afin de s’imprégner au mieux de l’atmosphère si particulière qui y règne et d’en restituer des images empreintes d’authenticité et de spiritualité. De l’archipel de Valaam, sur le lac Ladoga en Carélie, à l’Ukraine, la Grèce et Israël, le photographe a parcouru ces territoires dans des conditions parfois extrêmes, à la découverte de la vie monastique orthodoxe russe et de ses architectures multiples.
Objet d’exception, cet ouvrage sur les monastères rattachés au Patriarcat de Moscou présente le travail photographique réalisé par Charles Xelot, avec le soutien de la Fondation Neva. Jeune photographe de talent, Charles Xelot s’est immergé durant deux ans et au cours de 24 voyages dans la vie monastique, afin de s’imprégner au mieux de l’atmosphère si particulière qui y règne et d’en restituer des images empreintes d’authenticité et de spiritualité. De l’archipel de Valaam, sur le lac Ladoga en Carélie, à l’Ukraine, la Grèce et Israël, le photographe a parcouru ces territoires dans des conditions parfois extrêmes, à la découverte de la vie monastique orthodoxe russe et de ses architectures multiples.