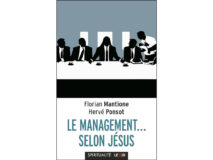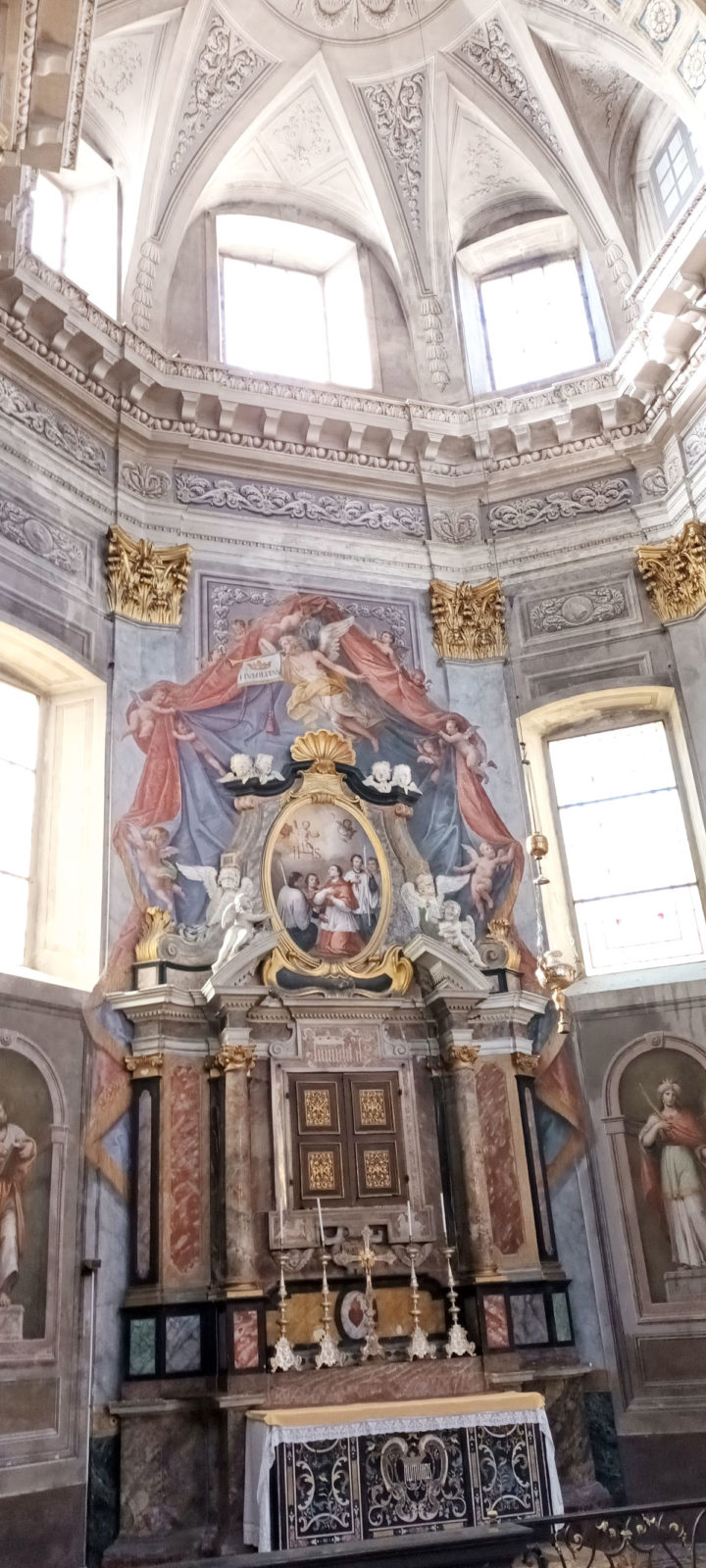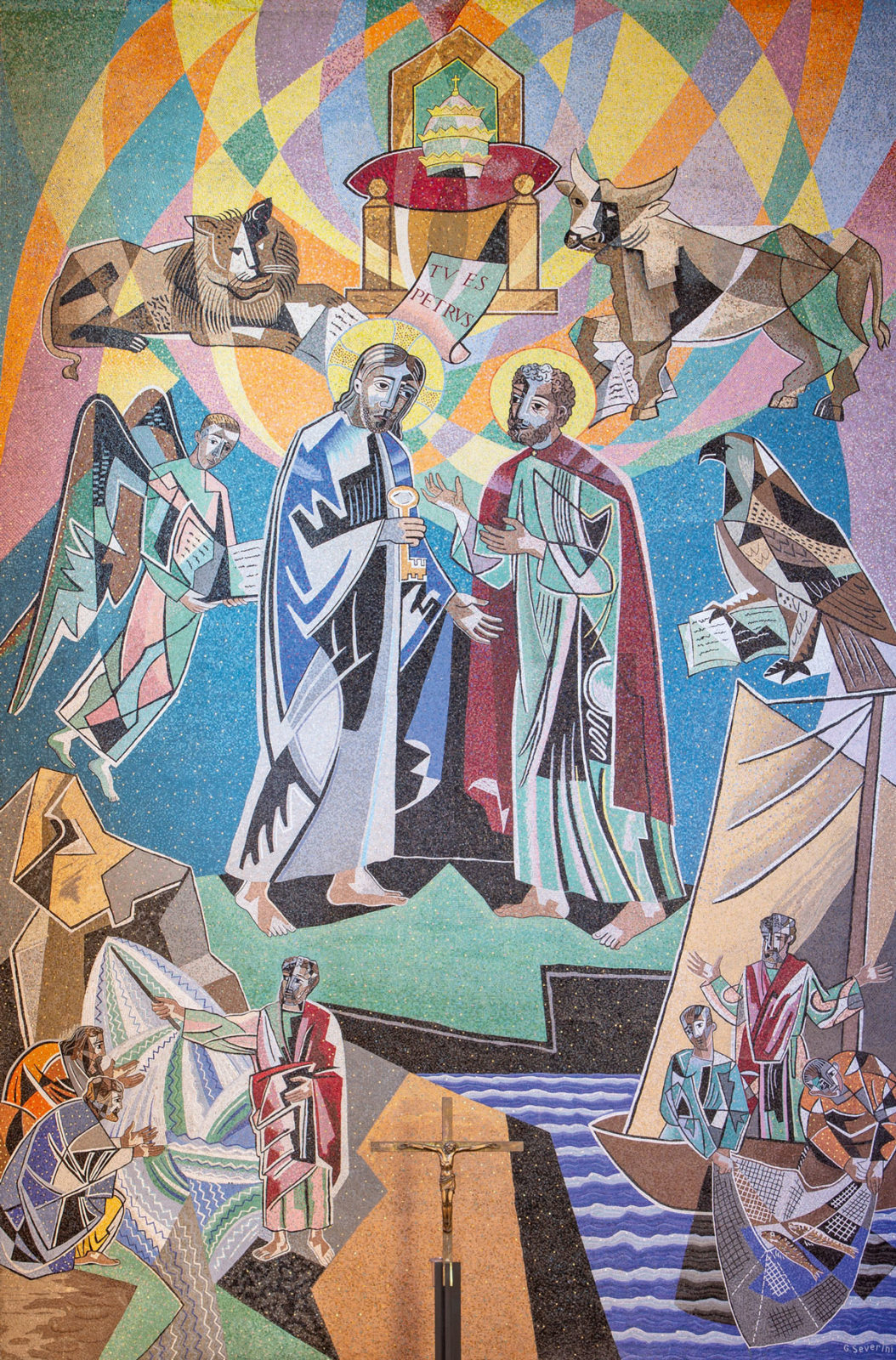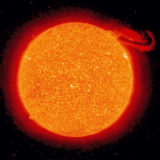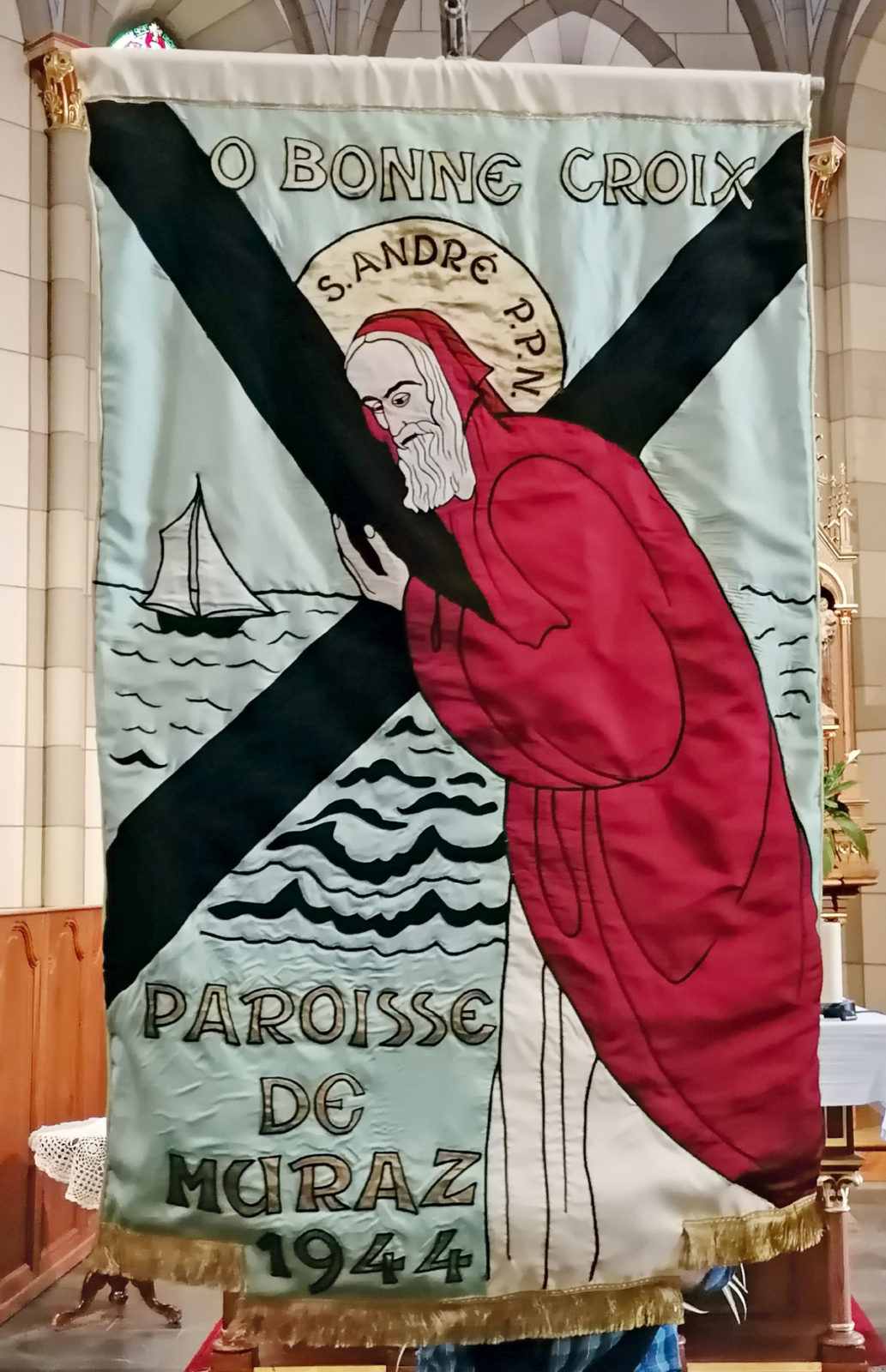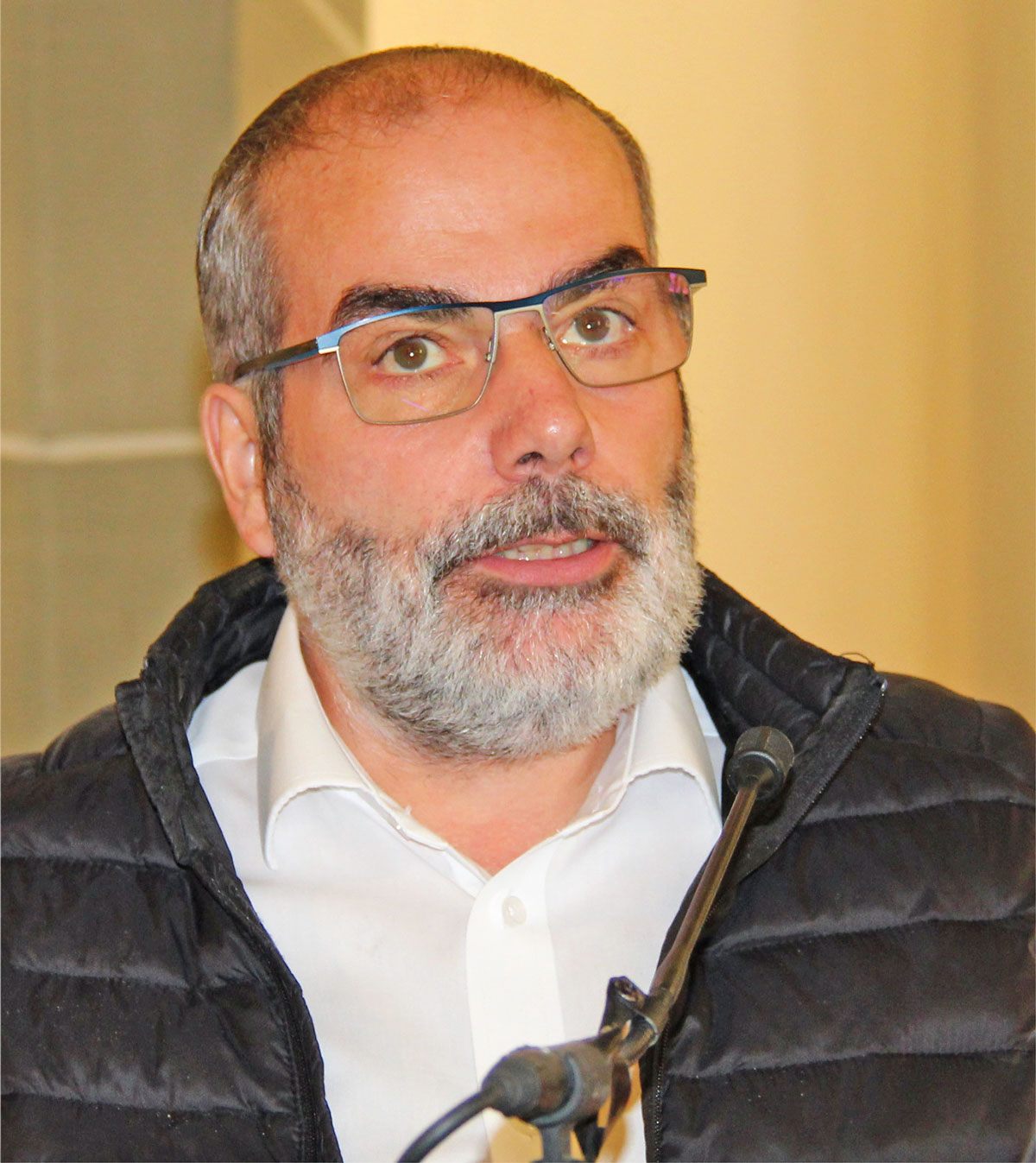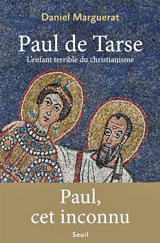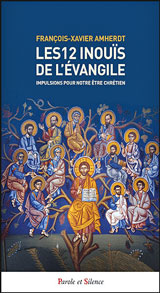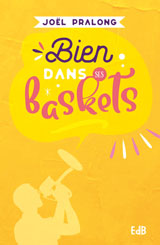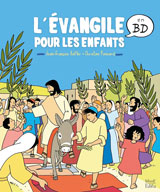Par Calixte Dubosson et la librairie Saint-Augustin
Des livres

Le management… selon Jésus
Florian Mantione – Hervé Ponsot
Qui a dit que, dans l’Evangile, il n’était question que de religion ? Incroyable mais vrai, c’est également un excellent manuel de management ! Voici le livre qu’il nous fallait pour réconcilier l’attaché-case avec l’encensoir, l’homme d’affaires et le prêtre. Le livre qui nous fait comprendre, à la relecture de la vie de Jésus, son rôle de leader et l’efficacité de son discours et de sa stratégie pour convertir le monde.
Editions du Cerf
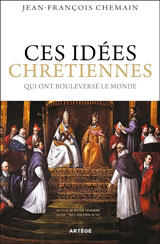
Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde
Jean-François Chemain
La vieille Europe, la chrétienté, est-elle en train de mourir après avoir rempli sa mission d’ensemencer le monde du christianisme ? On peut s’interroger sur la nécessité d’un tel pessimisme. L’Occident se trouve désormais au banc des accusés. A l’extérieur, on conteste son hégémonie, invoquant des griefs présents et passés. A l’intérieur, les uns, surenchérissant sur le monde, exigent qu’il fasse repentance de ce qu’il a été – conquérant, dominateur, homogénéisateur… tandis que d’autres, nostalgiques de la « chrétienté », lui font grief de ce qu’il ne serait plus assez « chrétien ». A l’heure du doute, Jean-François Chemain livre ici une réflexion puissante et originale sur les apports civilisationnels du christianisme et la légitimité de leur devenir.
Editions Artège

Madeleine Delbrêl
Elisabeth de Lambilly
Madeleine Delbrêl, née dans une famille peu croyante, perd la foi à 15 ans. Elle rencontrera à nouveau le Christ grâce à des amis chrétiens et, à 20 ans, est « éblouie par Dieu », lors d’un passage en l’église Saint-Dominique de Paris. Sa conversion la pousse à s’engager dans le scoutisme puis à travailler comme assistante sociale auprès des plus pauvres, annonçant la Bonne Nouvelle de l’Evangile dans les banlieues rouges de la capitale. Avec des amies, elle fonde une communauté qui s’attache à rencontrer les gens où ils vivent, devenir leur ami, les recevoir chez soi, s’entraider. Une biographie qui se lit comme un roman, pour nourrir l’âme des jeunes et moins jeunes.
Editions Emmanuel Jeunesse
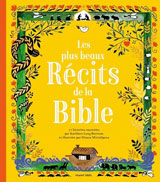
Les plus beaux Récits de la Bible
Katleen Long Bostrom
Ce n’est pas toujours aisé d’initier les enfants à la Bible. Ce livre est l’outil idéal, car il narre, à l’aide d’une langue simple et de magnifiques images, 17 histoires fameuses tirées de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Editions Bayard Soleil
Pour commander
- A la librairie de Saint-Maurice:
librairievs@staugustin.ch ou +41 24 486 05 51 - A la librairie de Fribourg:
librairiefr@staugustin.ch ou +41 26 322 36 82 - Sur notre shop en ligne:
librairie.saint-augustin.ch