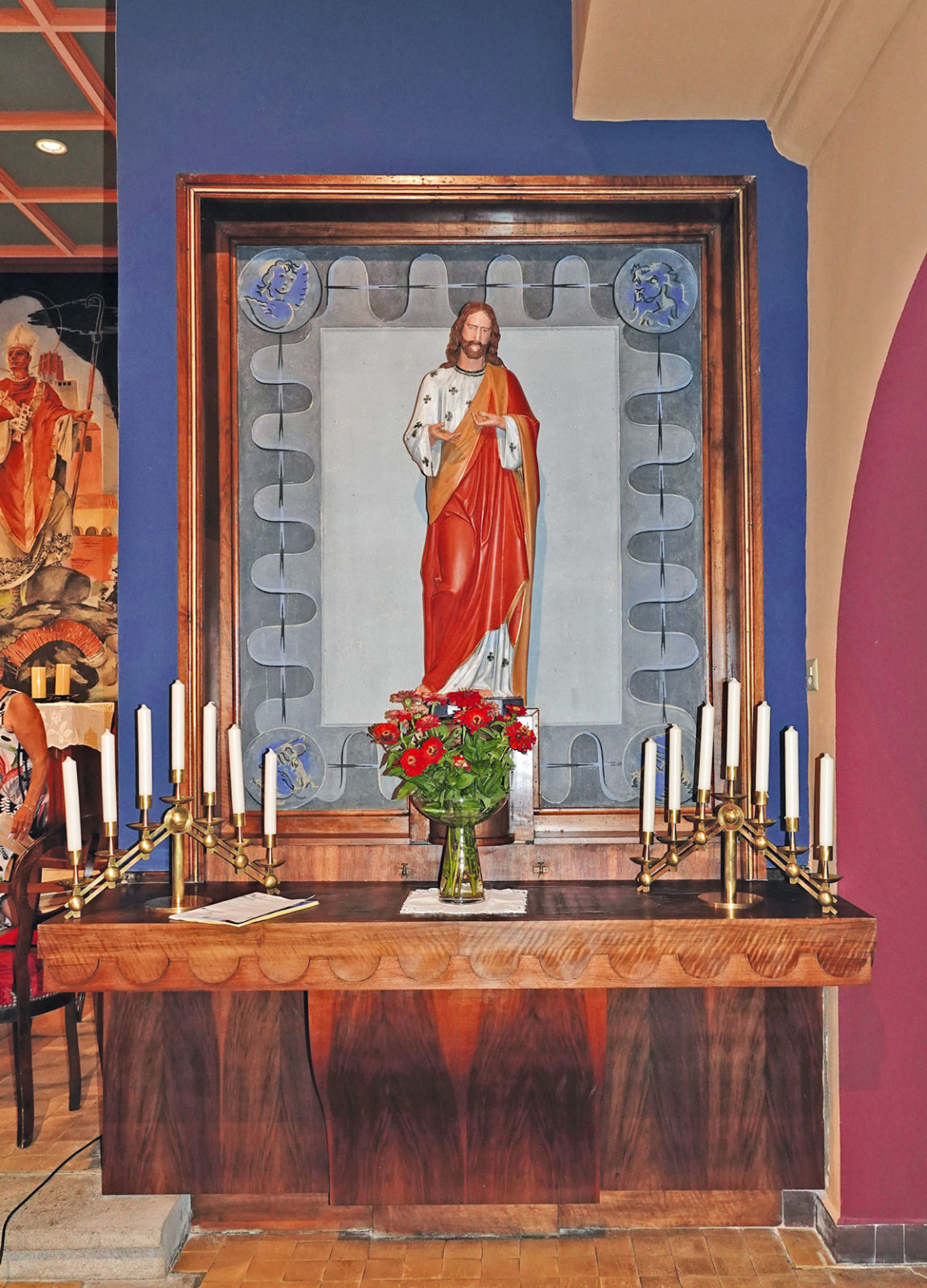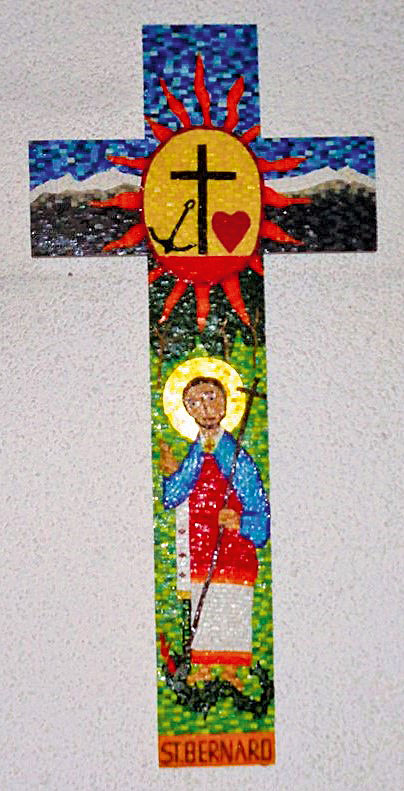Le film Magnificat, sorti récemment en salle, interroge avec respect et délicatesse sur la place des femmes dans l’Eglise d’aujourd’hui. Entretien avec Anne-Isabelle Lacassagne, auteure du livre qui a inspiré le long-métrage.
Par Myriam Bettens
Photos : Silvana Bassetti, Myriam Bettens
Quelle est, selon vous, la place des femmes dans l’Eglise d’aujourd’hui ?
La place des femmes est essentielle. Sans elles, il n’y aurait pas grand-chose dans l’Eglise, car elles accomplissent la majeure partie du travail de base. Autant dans la transmission de la foi, que l’entretien des paroisses, ou encore la pastorale de la santé. Tout le fonctionnement quotidien de l’Eglise est effectué par des femmes. Par contre, au niveau des postes de direction, c’est le désert ! Pourtant, beaucoup d’entre elles sont formées et capables d’assumer ce type de postes. A cause de la distinction fondamentale de statut qui existe entre les prêtres et les femmes, et que l’on perpétue, ces dernières s’autocensurent.
Pourquoi les femmes en Eglise s’autocensurent-elles ?
Il y a l’idée, encore très ancrée, qu’elles ne vont pas faire le poids. Elles ne s’autorisent donc pas à dire ou faire les choses et n’osent pas non plus contredire la parole du prêtre. Tout mon combat concerne le fait d’avoir un vrai langage de vérité avec eux, mais toujours empreint de bienveillance et d’amour. Ils sont reconnaissants lorsqu’on leur parle vraiment, car eux-mêmes sont coincés dans un rôle qui les rend extrêmement solitaires.
Vous déplorez également que la voix d’une femme a toujours moins de poids que celle d’un prêtre…
Oui, c’est malheureusement encore vrai. Simplement parce que l’on considère que le sacrement a plus de valeur. Cela va même plus loin que ça. Beaucoup de femmes considèrent encore les prêtres au-dessus, avec pour corollaire l’idée qu’il est impossible de s’exprimer sur un pied d’égalité. Une femme peut faire toutes les études de théologie qu’elle veut, on ne l’écoute pas. Et ce mode de fonctionnement est malheureusement ancré très profondément.
Malgré ces obstacles, les femmes demeurent indispensables à la bonne marche de l’Eglise. Si elles se mettaient en grève, l’Eglise s’en relèverait-elle ?
L’Eglise serait à genoux ! Cela fait des années que je leur chuchote de se mettre en grève… Cela leur permettrait de prendre enfin conscience de tout ce qu’elles accomplissent. L’Eglise ne peut fonctionner sans les femmes. Malheureusement, aujourd’hui, elles accomplissent la plupart des tâches, mais sans en avoir la reconnaissance.
Vous esquissez un tableau peu enviable de la place des femmes en Eglise. L’est-elle plus en Suisse ?
Il y a une différence énorme entre la Suisse et la France. Du fait de la présence des Eglises protestantes, il y a plus de latitude pour dire les choses ainsi que des points de comparaison. L’image des femmes pasteurs, partageant leurs points de vue avec liberté, utilisant pleinement leurs compétences et qui sont appréciées à leur juste valeur fait une grande différence. Il y a vraiment une question d’image revalorisante, sans laquelle on ne s’autorise pas à penser que les choses puissent être différentes.
Qu’espérez-vous avec la sortie du film Magnificat ?
Que les gens puissent se dire, en regardant une femme, qu’elle est tout aussi capable que ses homologues masculins et surtout de lui donner les possibilités de le faire. Raconter une histoire permet d’utiliser l’imaginaire. Cela parle aux sentiments et ouvre bien souvent des portes qui jusqu’alors semblaient verrouillées.
Des femmes en noir
« J’ai commencé à écrire ce livre au moment de l’élection du pape François. On vérifie toujours que le futur Pape soit bien un homme. Cela m’a fait rire. En même temps, au-delà de la vocation, je me suis questionnée sur la vocation féminine et sa place au sein de l’Eglise et, de manière plus vaste, ce que cela signifie de croire », détaille Anne-Isabelle Lacassagne concernant son livre, Des femmes en noir, publié en 2016 aux Editions du Rouergue, qui a inspiré le film. Elle écrit depuis longtemps des livres pour enfants publiés chez Bayard et après avoir travaillé dans un évêché, au service de la catéchèse, elle se tourne vers des textes religieux.