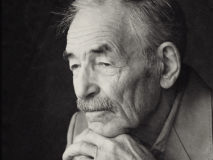Médecine et religion sont liées. Dans l’Antiquité, les prêtres exercent couramment la médecine. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est aussi un « médecin » des âmes et des corps. Les Evangiles sont remplis d’anecdotes, d’histoires décrivant comment, dans sa vie publique, le Christ guérit les malades. Dieu nous guérit, directement ou indirectement, par l’entremise des saints et bienheureux.
Par Pierre Guillemin | Photos : DR
Dieu guérit par les sacrements : réconciliation, Eucharistie, onction des malades.
Dieu guérit par des miracles de guérison qui sont les signes et surtout les rappels de sa compassion et de Son Amour infini.
Dieu guérit par la médecine et les médecins : c’est son action la plus normale, la plus commune. Ainsi, l’Eglise n’est pas éloignée de la médecine. Bien au contraire, car toute guérison est un retour à plus de vie, à cette vie que Dieu est toujours prêt à nous donner.
L’Eglise est à l’origine des hospices, des hôtels-Dieu, des hôpitaux. Combien de missionnaires, de religieux, de religieuses se sont sacrifiés au service des souffrants, des exclus, des sans-abris ? Saint Damien, saint Camille de Lellis, saint Jean de Dieu, saint Vincent de Paul, la bienheureuse Mère Teresa, entre autres, qui nous montrent que l’Eglise a toujours été la première à s’occuper des malades, des lépreux, des handicapés, des sidéens, des exclus.
Ferveur et désintéressement
Et elle continue ! Ainsi, par exemple, en matière de lutte et de soins contre le sida, c’est l’Eglise catholique qui prend en charge 28 % de l’activité mondiale. A la suite
de l’Eglise, de nombreux médecins se sont attachés au soin des malades avec ferveur et désintéressement. Dans l’histoire du christianisme, plus de 50 médecins ont été béatifiés ou canonisés ; parmi eux citons :
Luc, patron des médecins, Côme et Damien, les médecins anargyres (c’est-à-dire les saint médecins byzantins qui exerçaient leurs talents sans être payés), saint Martin de Porrès, le bienheureux Nicolas Sténon, saint Joseph Moscati, sainte Jeanne Beretta Molla et tant d’autres.
La question du lien entre Eglise et médecine n’est pas récente. Mais contrairement à l’idée commune, l’Eglise ne condamne ni la médecine ni la chirurgie. Nous pensons souvent en effet que le concile de Tours de 1163 interdit la pratique de la chirurgie en citant Ecclesia abhorret a sanguine (L’Eglise a horreur du sang). Or cet adage ne se trouve nulle part dans les actes du concile de Tours. Il n’apparaît qu’en 1744 à la page 35 de l’histoire de la chirurgie française composée par François Quesnay. En réalité, le concile de Tours défend aux religieux profès (religieux qui a prononcé ses vœux pour s’engager dans un ordre) de sortir de leur cloître pour exercer la médecine, étudier les lois civiles et s’adonner aux affaires sous prétexte de charité (canon 8). Le concile ne flétrit pas la médecine, le droit ou le commerce, mais les religieux qui se mêlent d’affaires séculières.
Citons deux exemples de médecins chrétiens qui n’auraient pas pu exercer leur art si ce concile de Tours l’avait interdit.
Au XIVe siècle, Guy de Chauliac, chanoine de la collégiale Saint-Just dans la région lyonnaise, fut médecin et chirurgien de quatre papes : Benoît XII, Clément VI, Innocent VI et Urbain V. Il aurait, par exemple, trépané Clément VI pour le soigner de céphalées. Il est considéré comme le plus grand chirurgien du Moyen-Age : son ouvrage Chirurgie, Chirurgia Magna restera un ouvrage de référence jusqu’au XVIIIe siècle.

Ambroise Paré, chrétien fervent, ne cessa jamais de célébrer dans ses œuvres la gloire de Dieu. Paré soignait tous les hommes, sans tenir compte de leur confession, fait extrêmement rare au XVIe siècle, période des guerres de religion. Mais Paré ne limita pas son art à soigner les rois et les pauvres gens, qu’il plaçait, en tant que thérapeute, sur un pied d’égalité. Gynécologue avant la lettre, il se préoccupa avec une magnifique attention des femmes enceintes, des techniques d’accouchement et des soins aux nouveau-nés, « petites créatures de Dieu », écrit-il, qui l’émerveillaient comme l’émerveillaient toutes les beautés de la création, plantes incluses. La foi chrétienne d’Ambroise Paré s’épanouit dans son esprit d’entreprise, dans son inventivité, dans sa compassion envers ses patients, rois, notables et simples soldats, et plus que tout dans sa volonté de transmettre un savoir exigeant par amour du bien public, trait de cet humanisme du XVIe siècle dont, aux côtés d’Erasme, de Rabelais ou de Montaigne, il nous offre un exemple admirable.
Engagements actuels
Et aujourd’hui ? Si l’Eglise et la médecine sont si proches, comment, par des exemples d’engagement de médecins et de chrétiens, pouvons-nous comprendre ce lien qui est si difficile à comprendre dans nos sociétés modernes ?
Le Père Philippe Gauer – prêtre, médecin, spécialiste de bioéthique – nous rappelle que l’homme, voulu et aimé par Dieu, est au cœur du regard du médecin chrétien sur son patient. Dans son ouvrage Soigner : la découverte d’une mission à la lumière du Christ médecin, il nous rappelle que « jamais nous ne voyons Jésus s’apitoyer sur une maladie, son regard se fixe toujours sur la personne ». S’inspirant de l’attitude du Seigneur, les médecins catholiques apprennent à poser un regard d’amour sur le patient et à en être les serviteurs.
Des soins pour l’âme
Le docteur Xavier Emmanuelli, médecin, philosophe, chrétien, voue sa vie et surtout son action en tant que médecin au profond engagement chrétien qui l’anime. Il est cofondateur de « Médecins sans frontières » en 1971, médecin-chef à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis de 1987 à 1993, fondateur du SAMU Social de la ville de Paris en 1993, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’Action humanitaire d’urgence du 18 mai 1995 au 2 juin 1997, président du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées du 29 août 1997 au 23 août 2015, fondateur du SAMU Social International en 1998, parrain d’Action Froid (Association citoyenne à but non lucratif venant en aide aux sans domicile fixe toute l’année).
Dans une interview de 1995, réalisée par Jean-Claude Noyé, Xavier Emmanuelli s’exprimait ainsi : « A vrai dire, c’est la fin d’un monde, d’une civilisation, qui a commencé au XVIe siècle et qui a eu des étapes marquantes comme le XVIIIe siècle, dit des « Lumières », le XIXe siècle et son lot de souffrances terribles qui ont accompagné la révolution industrielle, puis ce XXe siècle vraiment apocalyptique avec ses deux conflits mondiaux et tout le reste. Un monde sans Dieu voué à la production. On est arrivé au bout de cette logique. Le communisme lui-même, sorte de « christianisme de la terre » sans transcendance, amorce de communion des saints en termes matérialistes, a déçu ceux qui avaient placé en lui leurs espoirs. L’apocalypse est là. C’est l’exclusion qui nous sépare les uns des autres. C’est se couper de nos racines. »
N’y a-t-il pas du saint Vincent de Paul dans ces propos et ces actions ?
Laissons enfin le dernier mot à Monique Cuany, PhD, Professeur HET-PRO en Histoire du christianisme qui nous rappelle que pour Basile le Grand (330-379) « la médecine est une image des soins dont notre âme a besoin ». Comme certains médicaments, les soins et avertissements du Seigneur peuvent parfois nous être désagréables et pénibles. Mais son but, comme celui du médecin ou du chirurgien, est de nous guérir et de nous restaurer.