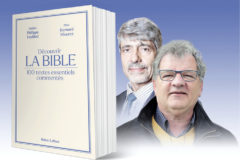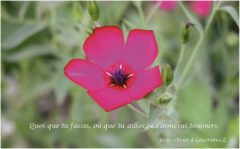Geneviève est originaire du Valais, elle était institutrice avant son entrée au Monastère de la Visitation à Fribourg.
PAR ANTOINE MBOMBO TSHIMANGA | PHOTO : DR
L’engagement au monastère : quelles références, quelle intuition?
Jeune, Geneviève tisse une relation toute personnelle avec Marie, «Marie m’a conduite vers Jésus».
Originaire du Valais, à 19 ans Geneviève fait connaissance avec la Communauté
du monastère de la Visitation à Fribourg lors de la retraite de l’école Normale de Sion. Cette rencontre comptera énormément dans son engagement futur tant elle a été marquée par la joie de cette communauté.
Autre expérience marquante, le partage de foi entre jeunes notamment auprès des Jeunes de Lourdes.
A 21 ans, Geneviève est interpellée par l’exemple d’un prêtre engagé dans la pastorale jeunesse.
Son attrait pour la Visitation se confirme lors d’un pèlerinage à Compostelle, elle a 24 ans.
Geneviève exerce son métier d’institutrice durant quatre années avant de frapper à la porte du monastère de la Visitation, elle a 25 ans. Elle se souvient, en ces temps-là, nourrir un secret espoir d’expérimenter une vie exempte de tensions familiales.
Départ du monastère
Geneviève n’a pas oublié une remarque de sa formatrice durant son noviciat « Tu es comme un œuf sans croise (coquille). » « J’ai compris aujourd’hui que je suis une hypersensible » concède Geneviève, ce qui ne l’a pas aidée à trouver et prendre toute sa place au monastère.
En 2014, âgée de 50 ans, elle quitte le monastère après 25 ans de vie religieuse et retourne vivre en Valais.
Retour à la vie hors les murs
Automne 2014, Geneviève repart à Fribourg où elle occupe parallèlement un poste de secrétariat et comptabilité, compétence acquise au monastère, et d’animatrice en pastorale jeunesse et de rue. Septembre 2015, retour de Geneviève en Valais vers l’enseignement, son métier de formation.
En 2016, au bout d’une année d’enseignement Geneviève connaît une grave dépression, elle passe un mois à l’hôpital. Il s’en suit une ouverture d’un dossier AI. Toutefois elle obtient un poste, à temps partiel, en comptabilité pour une association. Elle tient ce poste durant cinq années.
Tout au long de ces années de « réinsertion » dans une société civile qui a énormément changé en 25 ans, ses premiers lieux d’amitié et de soutien sont d’une part le Groupe Salésien qui se réunit une fois par mois au monastère de la Visitation, groupe dont elle était l’une des deux instigatrices six ans plus tôt, et d’autre part le Cercle de femmes de Vallorbe.
Un autre lieu d’ancrage important sont les amitiés : celles fidèles depuis la jeunesse et celles tissées nouvellement notamment par le travail et la chorale, Geneviève y rencontre notamment trois bonnes amies dont « sa marraine ». «Je rencontre des personnes dans la même ligne humaine et ou spirituelle que moi. Même si certaines se disent non pratiquantes tout en étant ouvertes et accueillantes au Dieu dont je parle avec elles.»
«Ma famille se faisait présente au début mais je crois que mon « craque » leur a fait peur… J’ai senti un peu de prise de distance, depuis j’ai fait le deuil d’un soutien tel que je l’attendais et j’accueille ce qui est donné.»
En 2021, Sœur Catherine, nouvelle prieure de la Communauté de Géronde à Sierre lui demande de travailler au monastère, entre autres au service d’accueil. « J’ai vécu un coup du Saint-Esprit ! Je sens une mission d’interface entre la Communauté des sœurs et la société actuelle.»
«J’ai longtemps vécu avec le sentiment d’un échec, aujourd’hui j’accueille mon chemin, mon histoire. Malgré mes anxiétés je peux dire, le Seigneur a toujours été là et j’ai toujours eu ce qu’il me fallait. »
«Avec humour, je racontais à une amie que dans une période compliquée financièrement, je priais le Père ainsi: tu sais mon ordinateur, ma voiture, mon téléphone, j’en ai besoin alors merci d’en prendre soin. Et voilà que mon imprimante tombe en panne ! Mince, Père, j’ai oublié de te la confier. Mais (sourire) quand je sors la garantie, je découvre qu’elle est valable encore un mois. Du coup je dis au Père : pardon, tu as même pris soin de mon imprimante. Cela fait sourire mon amie mais souvent, elle me dit elle-même que j’ai un Grand Patron génial.»
Que retirer de l’expérience de vie au monastère?
«Le monastère a forgé en moi une grande ouverture de Cœur, ça sert pour le service d’accueil. Je me rends compte qu’aujourd’hui j’ai un cercle d’amis anciens et nouveaux. J’ai même rencontré un couple d’enseignants qui est devenu « parrain et marraine » pour moi.»
«Dans une communauté on ne sent pas la hiérarchie des unes vis à vis des autres. Ce qui compte c’est la fraternité de la communauté et de la Sœur supérieure. Beaucoup de décisions se prennent en commun, la synodalité est donc vécue concrètement.»
Au monastère, Geneviève a exercé différents métiers, du travail manuel de blanchisserie, en passant par le jardinage, la liturgie, au travail de gestion et comptabilité (économat) étudié en formation interne. «Tout travail quel qu’il soit a une valeur, dans une communauté on reçoit toutes le même « salaire » : logée, nourrie, etc.»
«La Communauté de Géronde vient de vivre un changement de prieure, l’ancienne redevient simple Sœur. Est-ce que dans notre monde on verrait un patron redevenir simple ouvrier?»
Où trouver aujourd’hui la joie de vivre
«J’ai retrouvé ma capacité d’émerveillement, par la nature, par mes relations, et parce que je ne suis pas seule ; quelqu’un m’accompagne. En plus j’ai la chance aujourd’hui d’avoir une patronne avec qui je ris beaucoup !»
«Quand je jette un œil dans le rétroviseur je perçois que même dans les périodes les plus sombres la lumière du Ressuscité reste discrètement présente. » Ce qui confirme la phrase reçue de Jésus lors de ma dernière retraite au monastère : « Quoi que tu fasses, ou que tu ailles, je t’aimerai toujours.»
Quel conseil à la personne qui entre dans la vie religieuse et celle qui en sort?
Pour la personne qui entre : «Ecoute ton cœur et prends ton temps.»
Pour celle qui sort du couvent ou monastère: «Cherche le soutien auprès d’une autre communauté pour faire une transition et n’aie pas peur de confier ce que tu vis à tes amis proches. » Ton expérience de vie est particulière, ose en parler même si parfois tu te sens « en décalage».
Quel cri à l’Eglise et au monde?
A l’Eglise «Oser parler et vivre d’Amour et même d’Amour inconditionnel ! » et au monde « Connectez-vous à votre cœur, aimez-vous et aimez les autres, c’est le cœur de notre vie».