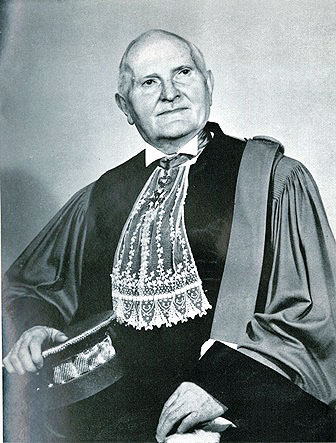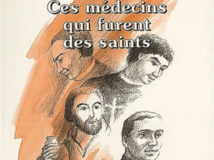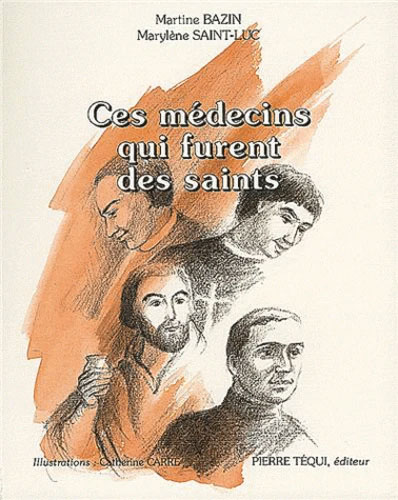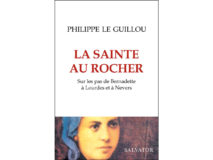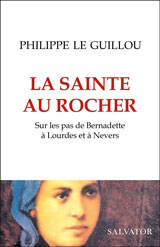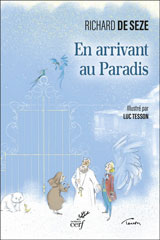Depuis plus d’un siècle, les communautés chrétiennes du Moyen-Orient sont confrontées à de nombreux défis. A l’occasion d’une conférence, au printemps dernier, la paroisse du Christ-Roi de Lancy a vécu un voyage exploratoire dans le berceau géographique de la chrétienté. Interview de l’orateur de la soirée, Pascal Maguesyan.
Par Myriam Bettens
Photos : Pascal Maguesyan
L’Association Chemin de solidarité avec les chrétiens d’Orient et les populations victimes des violences au Moyen-Orient (CSCO) a invité Pascal Maguesyan à venir s’exprimer sur la situation des chrétiens d’Orient et ce qu’il restait encore de leur patrimoine, dans une région où ils sont confrontés au défi de leur propre survivance. Le chargé de mission pour l’association Mesopotamia connaît sa partition, mais nous l’interpellons tout de même pour répondre à quelques questions en marge de son intervention.
Les attentats du Bataclan ont plus marqué les esprits que les perpétuels massacres des chrétiens d’Orient, pourquoi ?
Cela fait bien longtemps que les chrétiens d’Orient disent que l’islamisme progresse, aussi en Europe. Suite à l’attentat de la Cathédrale Sayidat al-Najat, en 2010, à Bagdad [préfigurant, par la violence et la méthode employées, l’attaque du Bataclan en 2015, ndlr.] il y a eu une vraie prise de conscience du drame que vivaient les chrétiens d’Orient. Mais nous étions encore loin d’imaginer que les actions criminelles de Daesh pourraient se porter également sur notre sol et de cette manière-là.
De quelle manière se positionner entre un angélisme qui prévaut parfois dans les relations avec le monde musulman et une méfiance tous azimuts ?
Le dialogue est un processus très exigeant. Il existe, à mon sens, une troisième voie. Celle-ci repose sur l’intelligence collective dont la société est capable pour dépasser les clichés. Cette capacité est nourrie par un grand nombre de représentants de l’islam appelant à la modération tout en dissociant l’Islam de ceux qui l’instrumentalisent à des fins criminelles.
Quelle est aujourd’hui la situation des chrétiens d’Orient et leurs perspectives ?
Par chrétiens d’Orient, je pense aux communautés natives dans ce territoire « source » de l’Alliance, qui va du Nil au Tigre. Les chrétiens qui y vivent sont pour l’essentiel des populations autochtones de traditions et de langues copte, guèze, syriaque, grecque, hébraïque, arménienne, turque, perse et arabe. Leurs espaces territoriaux s’y réduisent drastiquement et le 20e siècle a précipité ce mouvement : destruction des communautés arméniennes, assyro-chaldéennes et syriaques de l’Empire ottoman (1915-1918), cession par la France de la Cilicie (1921) et du Golfe d’Alexandrette (1939) à la Turquie, guerre civile (1975) et exil incessant des chrétiens libanais. Le 21e siècle prolonge cette tendance avec une pression fondamentaliste-islamiste croissante, comme en Syrie (depuis 2011) et en Irak (2003-2017). A cela s’ajoute la politique de l’Azerbaïdjan, qui vise l’éradication de l’identité arménienne par le blocus et l’asphyxie des 120’000 habitants de l’Artsakh. En définitive, les chrétiens d’Orient sont des résistants. Ils luttent pour se maintenir sur leurs terres. Cependant, comme en Irak depuis 2017, un nouvel horizon d’espérance s’est ouvert, là où les chrétiens ont pu reprendre racine. C’est le cas dans la plaine de Ninive et dans le Kurdistan d’Irak.
Un héritage immémoriel
L’association Mesopotamia réalise des missions culturelles et patrimoniales au cœur de la Mésopotamie, notamment en Irak, où le patrimoine a subi des outrages révoltants.
Mesopotamia a notamment réalisé un inventaire du patrimoine des communautés fragilisées à l’extrême (chrétiennes et yézidies) au travers d’un site web qui recense aujourd’hui plus d’une centaine d’édifices emblématiques irakiens. Mesopotamia organise également des expositions et des conférences. L’association mène également des programmes de restauration. Elle met en place enfin un ambitieux programme de camion du patrimoine en Irak.
Ces initiatives contribuent à la revitalisation de ces communautés autochtones confrontées à des destructions massives, parfois irréversibles.
A consulter sur mesopotamiaheritage.org