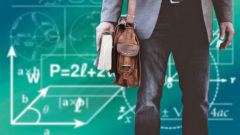Chanteuses et chanteurs se réjouissent déjà : le retour des Céciliennes est programmé pour novembre prochain à Cugy. Avec quelques changements mais ce même besoin pour les membres des chorales de se retrouver pour le plaisir de chanter ! Les préparatifs avancent bon train. Etat à six mois de l’événement.
Athée souhaits

Vous aussi, cela vous fait tousser de lire que les athées sont en voie de disparition alors qu’on parle sans arrêt d’une baisse du sentiment religieux? Paradoxalement, cette classe « d’incroyants » est bien en voie d’extinction selon certaines recherches. Faut-il alors créer un biotope protégé pour la préserver?
Par Myriam Bettens | Photos : DR
« La religion est l’opium du peuple. Aujourd’hui, je dirais plutôt la Ritaline des masses », écrit tout de go Thierry Stegmüller lors d’un échange de SMS. Il fait encore partie de ces 4 % de la population suisse se qualifiant d’athées. « Sommes-nous en voie de disparition ? », répond-il en écho, tout en ponctuant sa réponse d’un rire. L’enseignant au Gymnase de Bienne n’y croit pas : « De la part des croyants, nous avons tout de suite une étiquette. Or, cela dépend où est-ce que nous plaçons le curseur. Les gens que je rencontre ne se disent pas athées, mais le sont de fait. » Une observation que confirme Thierry Dewier, président de l’Association suisse de la Libre Pensée. « Après une semaine au Salon du livre de Genève à discuter avec de nombreux visiteurs, j’ai remarqué que ces personnes se disent par exemple catholiques, mais ne croient à aucun des dogmes du catholicisme. La religion n’est plus qu’une marque culturelle. » Tout comme son homonyme, il soutient que tout est question de définition. « Très peu de gens affirment être persuadés que Dieu n’existe pas. Ils préfèrent dire qu’ils ne savent pas et souvent, ils ne veulent pas non plus savoir. »

De l’athéisme à l’indifférence
« Il y a aujourd’hui une indifférence du religieux », pointe Christophe Monnot, maître de conférence en sociologie des religions à l’Université de Strasbourg. « On voit actuellement en Europe que lorsqu’une génération se désaffilie [ndlr., quitte officiellement une Eglise], la génération suivante va plus loin en termes de « non-religion ». » Même si la Suisse semble encore relativement préservée, Thierry Dewier souligne que le renouvellement constant des croyances engendrera une mutation de la société et peut-être même des dogmes. « Ce qu’il se passe en Europe constitue probablement l’embryon de ce qu’il va se produire à l’échelle mondiale. » Ce phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur selon les derniers chiffres de l’Office de la statistique suisse (OFS) et « la catégorie des « sans-religion » retient de plus en plus l’attention des chercheurs, à la mesure de l’importance que ces personnes occupent dans les statistiques sur les affiliations religieuses », relève Jean-François Mayer, directeur de l’Institut Religioscope. « En Suisse, dans les années septante, on ne recensait que quelques pourcents de non-affiliés. Aujourd’hui, ils représentent un tiers de la population », développe Christophe Monnot.
Chrétiens, vraiment ?
« Il y a maintenant tellement de personnes qui sont dans la non-croyance que les limites de ce que l’on considère comme l’athéisme peuvent se reconfigurer. Les critères employés pour le définir correspondent à une certaine classe de personnes, alors que l’on constate que dans la population, beaucoup en sont malgré tout très proches. » Pour Thierry Dewier, « toute notre société se rattache fortement aux valeurs humanistes, sans pour autant le reconnaitre ». Il va même plus loin : « La population tient peut-être même plus de la libre-pensée qu’elle ne le pense. » Christophe Monnot explique que la compréhension de la religion est devenue beaucoup plus sectorisée. « Ce n’est plus une religion globale et sociale, mais de l’ordre du bien spirituel privé. Il entre dès lors en compétition avec d’autres biens ou propositions. » Le choix est devenu possible. « Avant, la tradition familiale primait en matière de religion. Ce qui relevait auparavant de l’inné ne l’est plus aujourd’hui. » Thierry Stegmüller abonde dans le même sens, il temporise toutefois : « Ce qui finalement me dérange n’est pas la religion, mais ce que les gens font de leur foi. » En effet, la remise en question de l’utilité de la religion dans la société risque de « pousser les Eglises à devenir plus confessantes et donc en marge », argue Christophe Monnot. Il ne faut donc pas tout jeter, car « l’histoire et la dimension sociale des Eglises démontrent qu’elles ne répondent pas qu’en termes de biens spirituels. C’est un ensemble de facteurs favorisant la cohésion sociale ». Néanmoins, le processus d’effacement du religieux déjà bien entamé ne s’effectuera pas sans tensions sociales.
Analphabétisme religieux
« Nous allons inévitablement vers une rupture entre les religieux et les athées, car ces derniers n’ont presque pas d’enfants, alors que les croyants en ont plus. Au niveau mondial, les croyants seront donc beaucoup plus nombreux. Alors que les athées seront en minorité de population, mais constitueront le groupe dominant dans les pays occidentaux. Le clivage entre ces deux pôles ne peut que s’accentuer. » Le problème principal étant l’analphabétisme (a)religieux : « Les athées ne comprendront pas ce que les religieux entendent sur certaines choses et les religieux auront du mal à dialoguer avec les athées parce qu’ils auront l’impression qu’on leur sert des concepts erronés. » Pour reprendre les mots du philosophe allemand Jürgen Habermas, les religieux et les laïcs doivent entrer dans le langage de l’autre pour maintenir un espace public serein.
De Dieu aux « A-dieux »

Pour certains, Il est l’Alpha et l’Oméga. Pour d’autres, cet alpha, ou ce « A » n’est que la particule signifiant la privation, voire plus intimement la négation. Petit lexique pour s’y retrouver dans cet univers où Dieu ne fait pas loi.
Athéisme : doctrine ou attitude fondée sur la négation d’un Dieu personnel et vivant.
Agnosticisme : doctrine ou attitude philosophique qui considère l’absolu inaccessible à l’intelligence humaine.
Ignosticisme : position philosophique qui considère qu’une définition cohérente d’une doctrine théologique doit être posée avant toute discussion sur la nature ou l’existence de ce concept. Le « I » initial provenant du latin ignoro (ignorer, ne pas savoir).
Areligiosité : attitude de celui qui est étranger à toute préoccupation religieuse.
Irréligiosité : attitude de celui qui conteste ou défie la religion. Employé à tort pour qualifier une personne sans religion.
Voltairianisme : scepticisme en matière religieuse, esprit de dérision exercé à l’encontre des Eglises, notamment chrétiennes.
Libre-pensée : revendication de l’autonomie de la conscience humaine contre les règles qui prétendent la limiter.
Humanisme : attitude philosophique qui tient l’homme pour la valeur suprême et revendique pour chaque homme la possibilité d’épanouir librement son humanité, ses facultés proprement humaines.
Naturalisme : doctrine philosophique qui considère la nature comme principe unique, à l’exclusion de toute intervention divine ou idéale.
Déisme : doctrine selon laquelle la raison peut accéder à la connaissance de l’existence de Dieu, mais ne peut déterminer ses attributs.
Le prévôt, c’est quoi?
Le 19 avril 2023, les chanoines du Grand-Saint-Bernard m’ont élu prévôt. Le mot prévôt, équivalent au terme père-abbé, vient du latin prae-positus, celui qui est posé devant les autres.
Sortie des servants de messe et des lecteurs de Collombey et Muraz, samedi 6 mai 2023
Pour la sortie récréative des lecteurs et servants de messe, cette année, nous sommes allés au Parc Aventure à Aigle. Cette journée était synonyme de joie et de bonne humeur. Elle a permis de faire de nouvelles rencontres et de profiter d’une après-midi au soleil et au cœur de la nature.
Un orage va faire trembler la collégiale!
On souhaite évidemment que Phoebus soit au rendez-vous pour
le Festival des Roses des 17 et 18 juin à Estavayer. Demeure que la météo annonce avec certitude un « orage » pour le dimanche sur le coup de 11h ! Un événement musical signé par Philippe Marchello.
Athées ou chercheurs de Dieu ?
Par François-Xavier Amherdt | Photo: DR
Cela peut nous rassurer et nous donner élan : même le grand prédicateur Paul connaît un échec cuisant dans sa prédication sur le Christ ressuscité d’entre les morts, à l’aréopage d’Athènes (voir le passionnant épisode en Actes 17, 16-34). Cela veut dire que nous aussi, dans notre pastorale « en sortie », nous pouvons affronter des réticences sans que nous nous en culpabilisions. Nous semons et proposons, les personnes croisées disposent, en totale liberté.
Mais sur l’agora centrale de la capitale hellène, l’apôtre des nations a-t-il rencontré des athées ? Les philosophes qui l’ont abordé étaient-ils opposés à toute conviction religieuse ? Ne se reconnaissaient-ils pas plutôt d’une forme de polythéisme, selon un « panthéon très humain » ? Paul d’ailleurs commence par leur parler du Dieu universel et créateur en qui nous avons la vie, le mouvement et l’être, de la race duquel nous sommes (Actes 17, 28), plutôt que des idoles semblables à de l’or, de l’argent ou de la pierre taillée (v. 29). Et il en arrive à les interpeller à propos de « l’autel au dieu inconnu » qu’il a rencontré dans la cité et dont il est venu annoncer le vrai visage, en Jésus-Christ Sauveur.
Retour du paganisme
De nos jours aussi, nous constatons que les athées au sens strict sont relativement peu nombreux, alors que nous assistons à un retour du paganisme et du poly-théisme qui redivinise la nature, les astres, l’homme augmenté, les stars du sport et du show-business, les dictateurs et les gourous. C’est donc une prédication à la saint Paul qu’il nous convient de déployer, nous efforçant de répondre à la quête spirituelle authentique des gens et sachant montrer combien Jésus-Christ répond aux interrogations existentielles et fondamentales de l’humanité.
C’est à une nouvelle forme d’« apologétique » positive que nous sommes conviés, capable de donner envie aux « athées, païens et idolâtres » que nous sommes tous de s’ouvrir à la vie dont le Dieu biblique veut nous combler. Cela implique de nous laisser nous-mêmes évangéliser par ceux avec qui nous échangeons.
65 ans, l’heure d’un choix crucial…
Ce message, reçu de notre curé Jean-Pascal Genoud, le 17 janvier 2023 par WhatsApp, est le dernier d’une petite série qu’il avait envoyée, un peu comme des clins Dieu, à quelques proches et amis. Il l’avait intitulé ainsi: «65 ans: l’heure d’un choix crucial entre les bras fermés de Morphée ou les mains ouvertes du Ressuscité!» En voici la teneur…
Par Jean-Pascal Genoud | Photos : Marion Perraudin
Minuit et demi, ce 17 janvier 2023. Je revêts mon pyjama en jouant plus ou moins habilement entre les tubes de la sonde nasogastrique et ceux de la pompe anti-douleurs. Je m’assoupis quelque peu et suis réveillé, comme souvent ces dernières nuits, par le retour d’une intense douleur dans le bas-ventre. A force, on m’a appris à ne pas tarder. Je sonne donc l’infirmière qui me donne un comprimé de Buscopan, un médicament spécialement conçu pour maîtriser les crampes intestinales. Je l’informe que, pour laisser le temps nécessaire au médicament de faire son effet, je sors me fumer une clope devant l’entrée principale de l’hôpital. L’agente Securitas qui surveille l’entrée toutes les nuits n’est pas surprise de me voir faire ce pèlerinage nocturne. Elle a l’habitude de mes allers et venues.
A mon retour, je passe devant la chapelle. C’est fou comme ce genre de maladie incurable dont je souffre vous donne des accès de piété totalement inhabituel ! J’avise un coussin confortable que je dérobe à l’espace méditation pour le placer sur le banc devant le tabernacle. […] Après un temps d’action de grâce pour 65 ans de vie palpitante, je tombe dans les bras de Morphée.
Mon infirmière est occupée à répondre à différents appels dans l’unité des soins palliatifs dont elle a la garde cette nuit. Après une heure, pensant que j’étais rentré dans ma chambre, elle vient contrôler et ne peut que constater mon absence. Elle se fait du souci. Constate que j’ai laissé mon portable sur place et se résout à appeler l’agente Securitas qui l’informe que je n’ai pas fait très long dehors et que je suis rentré dans l’hôpital. Pas étonnant : dehors il neige et fait près de zéro degré. S’ensuit une battue dans les dédales des corridors.
Il est 3h30 quand j’entends résonner la grosse voix italienne de la Securitas : « Il y a quelqu’un ? » Je sors violemment hébété d’une phase de sommeil paradoxal, me demandant où je suis. J’étais en train de faire un cauchemar. Nous étions très nombreux dans une grande aula en pan incliné. Notre prévôt, debout tout devant, demande qui veut bien lire un passage des Actes des Apôtres, prévu dans les lectures du jour. Comme j’ai un missel en poche – C’est étonnant de voir comment ce genre de maladie m’a réservé des accès de piété parfaitement inhabituels ! – Dans le récit de la Pentecôte, arrivant la longue énumération des différents peuples de pèlerins juifs rassemblés pour l’occasion, pour ménager l’auditoire, je choisis de simplifier et d’en omettre un grand nombre. Le prévôt, visiblement fâché par la liberté que je prenais par rapport à la littéralité du texte sacré, s’exclame à l’adresse de tous : « Ce n’est pas tout à fait la Parole de Dieu qui vous a été lue. » Et je vois le sourire de l’agente Securitas, soulagée de m’avoir enfin trouvé. Je perçois aussi le regard amusé de l’infirmière de nuit qui l’accompagne. Celle-ci me dit : « Vous avez au moins prié pour nous ? » « J’ai eu tout le temps de prier pour le monde entier », dis-je ! Et on me reconduit en chambre. L’infirmière Ophélie me fait un gentil reproche pour lui avoir provoqué une grande frayeur. Sur quoi elle m’offre un bon café bien fort et j’obtiens de sa part la grâce de pouvoir repartir brièvement pour une dernière clope d’action de grâce…
La Parole de Dieu de ce jour, de la lettre aux Hébreux (6, 15.19.20) : « C’est par sa persévérance qu’Abraham a obtenu ce que Dieu avait promis… Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l’âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur. »
La pensée du jour que m’envoie ma sœur Françoise à l’occasion de mon anniversaire, une citation du musicien Olivier Messiaen (dans « La musique de l’invisible », ndlr) : « Entendre sur cette terre le son de l’invisible est une joie extraodinaire. »
Enfin, de l’hymne que propose la revue Magnificat pour ce 17 janvier : « Dieu ma joie, tu as fait de ma pauvreté ta demeure de silence où tout être peut adorer le secret de ta présence. »
Bien à vous, Jean-Pascal

Franchir la centaine en chantant!
J’ai rencontré Lucienne chez elle autour d’un café en pensant qu’en
30 minutes le tour serait joué. Deux heures plus tard, j’étais toujours à écouter le récit passionnant de sa vie, à apprendre de sa sagesse et de sa foi qui, sans doute, lui a permis de traverser un siècle dans la sérénité, entourée de sa famille.
La confiance de l’espérance
Texte et photo par Isabelle Roulin
« Athée souhaits », voici le thème de la rubrique centrale. Comme j’ai l’esprit taquin, un peu d’humour pour commencer. En effet, si quelqu’un lit les deux premiers mots de cet article à haute voix, il ne s’agit pas d’une référence à la religion, mais d’une réponse possible à quelqu’un qui a éternué. 😉 Vive la complexité de notre langue française !
Plus sérieusement, que veut dire le mot « athée » ? Se dit d’une personne qui ne croit en aucun pouvoir divin ; contrairement à un agnostique qui refuse de se prononcer et qui émet des doutes sur une existence divine. En résumé : l’athée ne croit pas alors que l’agnostique dit : je ne sais pas.
Si, d’après les statistiques, les athées sont en voie de disparition, je peux constater dans mes connaissances que le nombre des agnostiques augmente. Par contre, il est une catégorie non répertoriée qui, à mon sens, mériterait que l’on s’y arrête. Il s’agit de celle qui correspond à toutes les personnes qui ne se laissent enfermer dans aucune catégorie existante. Elles ont soif de spiritualité, croient en quelque chose ou quelqu’un de plus grand mais qu’elles refusent de nommer ou d’enfermer dans un quelconque dogme ou religion. Ces personnes admettent ne pas savoir mais vivent dans la confiance que la vie ne s’arrêtera pas à la mort.
J’ai pu lire et entendre plusieurs témoignages de personnes ayant fait une expérience de mort imminente (EMI) ou ayant vécu le phénomène de décorporation qui démontrent que la vie ne s’arrête pas avec notre enveloppe charnelle quand le cœur cesse de battre.
Pour ceux qui le souhaitent, vous trouverez de nombreuses vidéos abordant le thème de la mort sur le site internet de Christophe Fauré, psychiatre français.
Son site : https://christophefaure.com/
Etre chrétien, c’est avoir la confiance de l’espérance et je vous la souhaite à vous toutes et tous qui me lisez.
«Mieux athée que mauvais catholique!»

Par Thierry Schelling | Photo: vatican.news
« Mieux athée que mauvais catholique !» Ça, c’est dit ! Et de la part du Pape, qui plus est ! Si ses détracteurs se tapent le front de désespoir, les lecteurs attentifs de l’Evangile reconnaîtront la raison d’une telle affirmation.
Hypocrisie
En effet, François expliquait lors de son homélie du matin (février 2017) qu’on entendait souvent dire : « Je suis très catholique, je vais toujours à la messe, j’appartiens à telle ou telle association… mais sa vie n’est pas chrétienne : les employés sont sous-payés, on ment et vole les gens, on recycle l’argent sale… » bref, tant d’occasions pour trahir ses bonnes intentions. « Le scandale, reprend le Pape, c’est dire une chose et en faire une autre… tellement de catholiques sont ainsi ! »
Et donc, l’athée est peut-être plus cohérent que le catholique hypocrite ! Car celui-ci scandalise tout un chacun, qui le fait préférer se dire athée plutôt que catholique. CQFD.
Respect de la conscience
Dès son élection, s’adressant aux médias, il avait conclu l’entretien ainsi : « Puisque beaucoup d’entre vous n’appartiennent pas à l’Eglise catholique ou ne sont pas croyants, j’adresse de tout cœur ma bénédiction en silence, respectant la conscience de chacun… » Geste inédit pour un pontife, mais très… Vatican II et sa déclaration en faveur du dialogue interreligieux Nostra Aetate !
Dialogue plutôt que diatribe
Ne pas oublier que dès 1965, le pape Paul VI avait confié aux jésuites le maintien de liens et du dialogue avec l’athéisme d’alors… et Jean-Paul II intensifiera la lutte contre l’athéisme pratique avec sa culture caractéristique du déchet, lutte reprise par François en rappelant l’ignorance crasse de bien des catholiques du trésor inestimable que représente la doctrine sociale de l’Eglise. Ce compendium se conclut notamment par ceci : « Celui qui croit se conformer à la vertu surnaturelle de l’amour sans tenir compte du fondement naturel qui y correspond et qui inclut les devoirs de justice, se trompe lui-même. »
Jubilé de saint Bernard

Le 15 juin 2023, en la fête de saint Bernard, la congrégation du Grand-Saint-Bernard ouvrira une année festive qui marquera le centenaire de la proclamation de saint Bernard comme patron des alpinistes et des habitants de la montagne, ainsi que les 900 ans de sa canonisation. Des événements sont prévus tout au long de l’année: spectacles, pèlerinages, colloque, etc. Chacun y trouvera de quoi se réjouir.
Propos recueillis par Pascal Tornay | Photo: Pecold
Simon Roduit, expliquez-nous ce qui a présidé, en 1923, à ce que saint Bernard soit nommé patron des alpinistes et des habitants de la montagne ?
Dans une lettre apostolique du 10 août 1923, le pape Pie XI « donne saint Bernard de Menthon comme patron céleste non seulement aux habitants des Alpes ou à ses visiteurs, mais à tous ceux qui entreprennent l’ascension des montagnes ». Pie XI explique avoir lui-même connu la joie de « reprendre de nouvelles forces en escaladant les cimes » alors que son esprit était fatigué par les études durant ses jeunes années. Il mentionne aussi avoir vécu personnellement l’accueil des chanoines à l’hospice. Cette lettre est adressée à l’évêque d’Annecy qui est à l’origine de cette heureuse initiative. Pourquoi ? Parce qu’ils fêtaient alors le milllénaire de la naissance du saint, placée selon la légende, en 923 au château de Menthon, au bord du lac d’Annecy. Nous savons à présent qu’il est né plus tard, à l’orée du onzième siècle. 1923 était aussi le jubilé des 800 ans de sa canonisation par l’évêque de Novare. Ces anniversaires montrent combien saint Bernard n’est pas l’apanage d’une congrégation, mais appartient au trésor de toute l’Eglise.
Qui sait-on réellement de saint Bernard ?
De sa vie, nous savons peu de choses, sinon qu’étant archidiacre d’Aoste, il a fondé des hospices sur les deux cols qui portent désormais son nom et qu’il a mené une vie de prédicateur. Il a laissé un exemple de charité, particulièrement avec l’œuvre de l’hospice du Grand-Saint-Bernard, qui est aujourd’hui encore un lieu où le Christ est adoré et nourri, selon la devise laissée par le saint fondateur aux chanoines.
Les deux aspects de ce jubilé nous rapprochent de ce saint : les 900 ans de sa canonisation sont l’occasion pour nous d’imiter sa charité et son inventivité. Les 100 ans de sa proclamation comme patron des habitants des Alpes et des alpinistes sont l’occasion de nous mettre sous sa protection. Par sa beauté, la montagne nous permet de nous tourner vers le Père dans un acte de contemplation. Par le péril qu’elle peut causer, elle nous invite à nous tourner vers le ciel pour demander, par son intercession, la protection divine.
Quelle est la signification profonde d’un jubilé ?
Dans le livre du Lévitique la manière de fêter un jubilé, chaque 50 ans, une année « sabbatique » : un temps particulièrement consacré au Seigneur. On y laisse la nature se reposer du travail de l’homme. On remet les dettes afin que les terres reviennent à leurs propriétaires. C’est une année de fête durant laquelle tous réjouissent. Depuis 1300, le jubilé est devenu une fête célébrée dans toute l’Eglise chaque 25 ans. Le pape François a déjà annoncé le prochain jubilé ordinaire en 2025 sur le thème « Pèlerins de l’espérance ». Durant un jubilé chrétien, les fidèles sont invités à se réjouir en lien à une thématique particulière, et à se mettre en marche, comme pèlerins, vers Rome ou un autre sanctuaire.
Quels objectifs avez-vous en organisant toute une année de festivités dans ce cadre ?
Durant cette année jubilaire, divers événements sont organisés pour nous aider à nous réjouir d’avoir saint Bernard comme patron des Alpes, et une démarche de pèlerinage est proposée à l’hospice. L’objectif principal c’est faire connaître et prier saint Bernard, mais aussi à inviter les fidèles à continuer son œuvre de prédication et de charité dans les milieux de la montagne et les paroisses des Alpes, en devenant comme saint Bernard des missionnaires joyeux par une charité et un accueil inconditionnel du prochain.
Prière à saint Bernard
Seigneur, tu nous as donné saint Bernard comme patron des alpinistes et des habitants de la montagne. Par son intercession protège-nous dans toutes nos ascensions. Après avoir joui de la beauté de la nature, que nous retournions à notre tâche plus sereins et plus forts dans le service de Dieu et de nos frères. Tandis que nous nous efforçons de marcher sur ses traces ici-bas, accorde-nous d’atteindre le véritable Sommet qui et le Christ.
Amen.
Le jubilé
Retrouvez le programme des festivités, qui dureront du 15 juin 2023 au 28 août 2024, sur le site internet –> centenairesaintbernard.ch
Fêtes des guides, exposition, démarches jubilaires, spectacles, manifestations alpines, colloques, célébrations… Un programme varié de découvertes et rencontres durant toute l’année !
Bénévoles: notre église vit grâce à vous!
Le bénévolat : un travail souvent dans l’ombre, qui a besoin d’être reconnu. Mais cette participation indispensable à la vie de nos paroisses est fragile et il faut, comme une plante, songer à la nourrir et à l’arroser.
Les athées, une espèce en voie de disparition?
Par l’abbé Daniel Reynard, curé | Photo: Raphael Delaloye
La proportion d’individus sans affiliation religieuse pourrait se réduire de 35% d’ici à 2050. Mais pas sûr que les athées périclitent sans résistance.
Les libres-penseurs sont de plus en plus menacés par le retour du religieux. Quand on sait que les croyants font plus d’enfants, il est légitime de s’interroger sur la survie, à terme, des athées. Vont-ils péricliter sans résistance ou bien s’organiser en communauté transnationale pour faire entendre leur voix ?
J’ose dire ici que nous avons besoin des athées, ils nous font avancer. Ils nous empêchent de tourner en rond, ils nous remettent en question, nous obligent sans cesse à nous remettre à l’établi de la foi pour nous confronter au monde, à la vie, alors dans ce sens merci.
Si quelqu’un dit : « J’ai rencontré Dieu, Il existe, fuyez. »
Si quelqu’un dit : « Je n’ai pas rencontré Dieu, Il n’existe pas, fuyez également. »
Dans les 2 cas, ils ne le font pas dans une optique spirituelle, religieuse ou métaphysique, mais dans un but politique au sens large.
Sortons du débat primaire et réducteur de « Dieu existe » ou « Dieu n’existe pas » pour entrer dans la foi qui est du domaine de l’expérience personnelle, d’une rencontre car la foi transcende ce débat pour ou contre.
Celui qui a besoin de nier Dieu devrait se poser des questions sur lui-même tout comme celui qui cherche absolument à convaincre que Dieu existe.
Je crois que nous sommes tous des chercheurs de l’au-delà, d’un monde meilleur. Dans ce sens, on n’est jamais aussi athée qu’on le croit ni aussi croyant qu’on le prétend.
Alors sachez que Jésus entend votre questionnement, Il est vivant et veut venir à votre rencontre, car Il sait que vous avez besoin d’une rencontre personnelle. Il se peut que vous doutiez, que vous soyez dans un temps de déception ou de découragement, que la présence de Dieu vous semble si lointaine. Jésus vous donnera ce rendez-vous que vous attendez. Cherchez-Le et répondez-Lui comme Thomas l’a fait : mon Seigneur et mon Dieu.
Vocations, où êtes-vous ?
Les vocations religieuses et sacerdotales dans les pays occidentaux sont en baisse constante. S’il n’est pas facile de discerner les causes d’une telle situation, il est important de ne pas tomber dans des considérations simplistes et de rechercher les origines de la dévalorisation d’un idéal si apprécié et si recherché dans la vie de l’Eglise.
Par Calixte Dubosson | Photos : Bernard Hallet/cath.ch, DR
A la question de la baisse des vocations un peu partout en Suisse, le regretté Mgr Genoud *, a eu cette réponse surprenante : « Pour le nombre de pratiquants, il y a encore assez de prêtres. » Il ajoutait que les paroisses doivent devenir mères pour engendrer les pères dont elles ont besoin. Il faut qu’elles manifestent le désir d’une présence sacerdotale et religieuse, il importe qu’elles disent si oui ou non elles ont besoin d’un berger pour les conduire. Cette constatation plutôt réaliste n’empêche pas une réflexion sur la baisse des vocations religieuses et sacerdotales en Europe.
Un constat
Le nombre réduit de vocations dans la vie religieuse a des motivations de divers ordres. Motivations sociologiques tout d’abord : la diminution des naissances et le fait qu’il est toujours plus rare de trouver des familles nombreuses. Des études ont montré que nombre de vocations à la vie presbytérale et religieuse sont issues de familles ayant beaucoup d’enfants. Il est évident que sur un taux de naissance en Suisse qui frôle le 1.5 % par famille, on ne voit pas comment égaler le flux des générations précédentes.
Le moine italien Enzo Bianchi y voit aussi une dimension économique avec l’amélioration spectaculaire des conditions de vie. « Au niveau économique, dit-il, l’aisance généralisée a transformé radicalement le panorama par rapport aux années d’après-guerre qui ont vu naître de nombreuses vocations presbytérales et religieuses dans un contexte de pauvreté et de besoin. » Le confort actuel ne permettrait pas d’entendre l’appel de Dieu, car une société qui a tout ce qui lui faut au niveau matériel ne favorise pas ou moins le besoin de donner sa vie pour Dieu.
Enjeux de la vocation
« Dans le vaste panorama des possibilités infinies du monde moderne (professions de tout ordre, expériences de vie volontairement limitées dans le temps, voyages), la difficulté est grande pour les jeunes de choisir et de concevoir qu’un choix soit définitif, ainsi que celle de persévérer et vivre une fidélité » m’a confié un confrère dans le sacerdoce. On peut aussi relever par ailleurs leur appréhension devant la nécessité d’une ascèse et de renoncements à tant de choses passionnantes que nous propose le monde actuel.
Il y a également l’exigence du célibat et de la chasteté qui est très difficile à vivre dans une société hypersexualisée. Même si beaucoup de catholiques pensent qu’il serait bon que le futur prêtre puisse choisir entre le mariage et le célibat et que cette option freinerait la chute inexorable des vocations, il n’en reste pas moins que la vraie raison du célibat et de la chasteté est mystique et non disciplinaire. Elle reste toujours valable : les représentants visibles du Christ invisible sont appelés à pratiquer son genre de vie.
Le message faussé
Impossible de ne pas évoquer la triste réalité des révélations d’abus sexuels ou psychologiques de la part du clergé qui impacte sérieusement et gravement le désir des jeunes de se lancer dans l’aventure du sacerdoce ou de la vie religieuse. Ce phénomène malheureux et sa médiatisation ne peuvent qu’instaurer une méfiance et un rejet inévitables. Un ami prêtre m’a confié que, dans le contexte actuel, une vocation religieuse tient carrément du miracle. A tel point qu’une mère de famille très engagée dans la pastorale de son diocèse et mère de nombreux enfants a confié à son amie : « Auparavant, je priais intensément pour que Dieu choisisse un de mes enfants pour une vie consacrée, mais depuis l’affaire des chanoines abuseurs révélée dernièrement dans la presse, je prie désormais pour que mes enfants ne choisissent pas cette voie. »
Des parents, parlons-en justement. Peu d’entre eux songent à une vocation consacrée pour leurs enfants. Jean-Marie et Geneviève Thouvenot, parents d’un prêtre du diocèse de Lyon n’y avaient pas pensé avant. « C’est comme les autoroutes. Il en faut, mais pas dans notre jardin ! »
Mais ne dit-on pas qu’une vocation peut naître, s’enrichir et se fortifier d’abord dans le terreau familial ?
Crise des vocations ou crise de la foi ?
La vocation est pour moi liée à la foi. Avant de réclamer des prêtres, des religieux, des religieuses, il faut demander au Seigneur, des croyants qui deviendront par la suite capables de faire le grand saut de la vocation. Aimer le Christ et le faire aimer doit être la préoccupation principale de tout chrétien, des parents jusqu’aux responsables d’Eglise. Une foi sincère et rayonnante est donc nécessaire. Pourtant, Jésus a posé la question : « Quand le fils de l’homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la Terre ? » Notre monde occidental a-t-il perdu la foi ? Alain Houziaux, pasteur de l’Eglise protestante unie de France affirme : « Le plus souvent, on « perd la foi » quand on ne l’a jamais vraiment eue. On a fréquenté l’instruction religieuse, on a fait sa première communion, on a été enfant de chœur, éventuellement on a même eu quelques élans mystiques. Mais, par la suite, la foi est devenue une forme d’adhésion à une tradition et à une éducation. Adhérer à une religion et avoir la foi, ce sont deux choses très différentes. »
Depuis des millénaires, beaucoup de gens demandaient à Dieu ce que désormais ils peuvent, en partie, se procurer par eux-mêmes. Ils ne voient plus ce qu’une foi et une pratique religieuse apportent. Sans doute aspirent-ils, dans leurs attentes profondes, à passer d’une relation d’utilité à une relation de gratuité et d’amour avec le Dieu de l’Evangile. Mais ce passage est loin d’être réalisé. Le but de la catéchèse pour les enfants, c’est précisément de nourrir une relation d’amour avec le Christ qui a commencé au baptême.
Comment dépasser la crise ?
C’est une tâche difficile. Si nous n’avons pas prise sur la mutation de la civilisation, nous pouvons tout de même agir en Eglise pour enrayer certaines causes internes de la crise. Que toute l’Eglise soit convaincue que les prêtres sont et seront irremplaçables. Il ne peut y avoir d’Eglise, telle que le Christ la veut, sans ministres ordonnés (prêtres et évêques) qui la rattachent, elle qui est le Corps du Seigneur, à la Tête. Contrairement au slogan nocif des années 80 qui a causé beaucoup de tort, nous n’allons pas « vers une Eglise sans prêtres ». Que toute l’Eglise retrouve confiance, sans être ni culpabilisée ni prétentieuse. Aucune personne, aucune institution ne peut se réaliser sans confiance. La nôtre s’appuie non sur nous-mêmes, mais sur la vitalité du Christ Ressuscité et sur son Père, dans l’Esprit d’Amour. C’est le développement chez beaucoup de catholiques d’une authentique vie spirituelle, au sens fort, qui permet d’être et d’agir dans cette confiance reçue de Dieu.
Concrètement, nous pouvons :
Prier, car le Saint-Esprit n’a déserté ni l’Eglise ni notre monde. Malgré tous les obstacles actuels, des jeunes sont capables de répondre à son appel avec dynamisme, générosité et joie. Des réseaux de prière pour les vocations existent (cf. encadré).
Soutenir les jeunes qui s’interrogent sur une possible vocation. A l’heure actuelle, il faut beaucoup plus de temps pour choisir sa voie et mûrir une décision ferme. Sans doute, nous faut-il prendre des initiatives variées pour accompagner, de manière personnalisée, les jeunes qui se demandent comment discerner un éventuel appel de Dieu.
Parler, car tout ce qui est humain passe par la parole et ce qui ne se parle pas finit par dépérir. Il est important d’oser parler des vocations et de proposer aux jeunes d’y répondre, dans le respect de la liberté de conscience, bien entendu.
Encourager les vocations par la prière

En Suisse romande, nous avons la grâce de compter plus d’une quinzaine de communautés religieuses contemplatives et monastiques. Ces hommes et ces femmes prient aussi pour la vocation de tous les baptisés. Au sein du Centre romand des vocations, une délégation assure l’édition d’un petit fascicule trimestriel, qui s’appelait autrefois le « Monastère invisible » et qui se nomme désormais « Kairos ». Son but : encourager la prière pour les vocations et nourrir la réflexion autour de l’engagement en Eglise. Kairos est également un lien entre toutes les personnes qui, dans les paroisses, portent devant Dieu la prière pour les vocations.


Vocation autrement ?
Par Jean-François Bobillier | Photo : Myicahel Tamburini/Pexels
Selon son étymologie, le mot « vocation » fait référence à l’« appel ». Face à ce que l’on nomme la crise des vocations, je me questionne : sommes-nous vraiment en situation d’une baisse des appels de Dieu adressés aux femmes et aux hommes de notre temps ?
A chacun d’y répondre, mais nul besoin d’entreprendre une étude sociologique poussée pour percevoir en nous et chez nos contemporains une immense soif de sens, d’absolu, de bonheur, d’amour. L’homme est-il donc assoiffé mais incapable de percevoir la Source, autrement dit d’identifier l’auteur de l’appel ? En toute sincérité je n’y crois pas.
Je suis très impressionné par la capacité qu’ont les personnes rencontrées, notamment à l’hôpital, à dire quelque chose de Celui que je nomme Dieu. Récemment, goûtant aux paroles d’une grande et profonde sagesse prononcées par une petite dame toute fragile, je ne pus m’empêcher de lui poser la question : « D’où cela vous vient-il ? » – « C’est la vie qui me l’a appris » me répondit-elle.
Je cite, en écho, ces paroles de Maurice Zundel : « Dieu ne se démontre pas, Il est la Vie et, dès que l’homme est attentif à sa propre vie, il se heurte à cette Présence merveilleuse, invisible, qui le dépasse infiniment. » Aujourd’hui, les cœurs humains habités de cette « Présence » seraient-ils moins nombreux ? N’y a-t-il pas en réalité abondance de vocations ? Et ne cherchons-nous pas trop à démontrer Dieu ?
A l’écoute de cette parole de Simone Weil : « Chaque être crie en silence pour être lu autrement », je m’interroge encore : les appels ressentis doivent-ils être écoutés, de notre part, autrement ? Sommes-nous encouragés à répondre à ce cri, à cette soif, autrement ? L’accès à la Source peut-il se dessiner autrement ? En somme, l’Eglise est-elle appelée à vivre sa vocation autrement ?
Les Rogations, une pratique désuète?
Pourquoi parler des Rogations ?
Parce que récemment, j’ai lu un article d’un journal français « Valeurs actuelles » qui a attiré mon attention.
Une à une
Par François-Xavier Amherdt | Photo : Pxhere
« Le berger appelle ses brebis une à une et il les mène au dehors. Elles le suivent parce qu’elles connaissent sa voix. » (Jean 10, 3-4)
Le discours du « beau » Pasteur, (selon le grec) dans le 4e évangile, constitue le texte de référence lors du 4e dimanche de Pâques chaque année liturgique, où nous prions spécialement pour les « vocations » religieuses, sacerdotales, diaconales et laïques. Jésus berger n’a qu’une préoccupation : celle de toucher le cœur de chaque être humain, car le Père les lui a tous confiés, de nous permettre de déployer nos potentialités dans l’Esprit et ainsi de cheminer à sa suite vers le véritable bonheur. Car mettre nos pas dans les siens nous conduit vers notre épanouissement selon la volonté divine.
Un appel sans exception
Y a-t-il une baisse des vocations, en Europe notamment ? Pas du côté de Dieu en tout cas, qui continue inlassablement d’appeler chacun(e) sans exception, de manière parfois inattendue. Ce qui manque, c’est la possible « re-connaissance » de sa voix : elle est brouillée par les multiples contre-témoignages ecclésiaux, elle est perdue dans le brouhaha de l’indifférence, elle disparaît face aux sirènes technologiques et consuméristes, elle ne trouve plus place au milieu du concert des néo-paganismes de toutes sortes, elle est étouffée par les idéologies et les autocrates, elle paraît trop humble face aux défis postmodernes…
Le loup dans la bergerie
Il revient donc à chaque disciple-missionnaire que nous sommes tous et toutes de la faire retentir. Les mercenaires pullulent. Ils ne chassent pas le loup, mais le laissent entrer dans la bergerie et s’enfuient. Répondre à notre vocation, c’est ainsi nous laisser connaître en profondeur par le Christ, comme il connaît le Père (v. 15) et aller jusqu’à donner comme lui notre vie pour ceux que nous aimons.
Les enclos sont nombreux, les pâturages abondent. Prions donc le Maître du troupeau d’envoyer des gardes pour ses moutons, brebis, agneaux et boucs (Matthieu 9, 37-38), partout à travers le monde, y compris dans nos contrées.
Sonia Pierroz, plus de dix ans au service des enfants
Sonia est sage-femme. Le don, la générosité et le partage font partie intégrante de son métier. Ces valeurs, elle les transpose dans son activité de catéchiste auprès des enfants du secteur de Charrat avec un plus : la native de Bourgogne a « un p’tit côté artiste ».
Jubilaires de mariage: jubilez, car voici un exemple
Lisse, lumineux et immuable comme l’ivoire, c’est ainsi que l’on peut présenter le mariage de Gilberte et Jean-Paul Kurmann. Ils vont fêter cet automne leurs noces d’ivoire, c’est-à-dire 62 ans de mariage.
« Contre l’hypocrisie de la médiocrité »
Par Thierry Schelling | Photo : Grégory Roth/cath.ch
« Quand on me dit qu’il y a une congrégation qui attire beaucoup de vocations, je l’avoue, cela me préoccupe », déclarait François au symposium des religieux et religieuses en 2017, car « je m’interroge sur ce qu’il s’y passe ».
De quoi être clair quant à la « crise » des vocations religieuses en Europe notamment : pas le nombre, mais la qualité, condamnant fermement la « traite des novices » : ces congrégations qui, face à la chute des postulants autochtones, partent dans des pays du Sud recruter des jeunes qui n’avaient pas vraiment de vocation religieuse. C’est aussi une forme d’abus !
Qualité !
Il a mis en garde contre « l’hypocrisie de la médiocrité, de ceux qui veulent entrer au séminaire, car ils se sentent incapables de se débrouiller par eux-mêmes dans le monde ». Une hypocrisie qui est « une peste », a-t-il encore asséné.
Réalisme
« Le jour où il n’y aura plus assez de vocations sacerdotales pour tout le monde, le jour où… le jour où ce jour viendra, avons-nous préparé les laïcs, avons-nous préparé les gens à continuer le travail pastoral dans l’Eglise ? », interroge François avec lucidité. D’ailleurs, à prier pour les vocations depuis tant et tant d’années, Dieu a répondu au vu du nombre de femmes et d’hommes qui s’engagent en Eglise, en théologie, en pastorale spécialisée et plus seulement comme catéchistes 1 !
Le pape François élargit la notion de vocation : « Un proverbe de l’Extrême-Orient dit : « l’homme sage regarde l’œuf et voit l’aigle ; il regarde la graine et voit un grand arbre ; il regarde un pécheur et voit un saint ». C’est ainsi que Dieu nous regarde : en chacun de nous, il voit des potentialités, parfois inconnues de nous-mêmes et tout au long de notre vie, il travaille sans relâche pour que nous puissions les mettre au service du bien commun. C’est ainsi que naît la vocation… »
Il y a donc plus que de l’espoir…
1 400 laïcs et 235 prêtres pour le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, à titre d’exemple de la réponse de Dieu à nos prières !