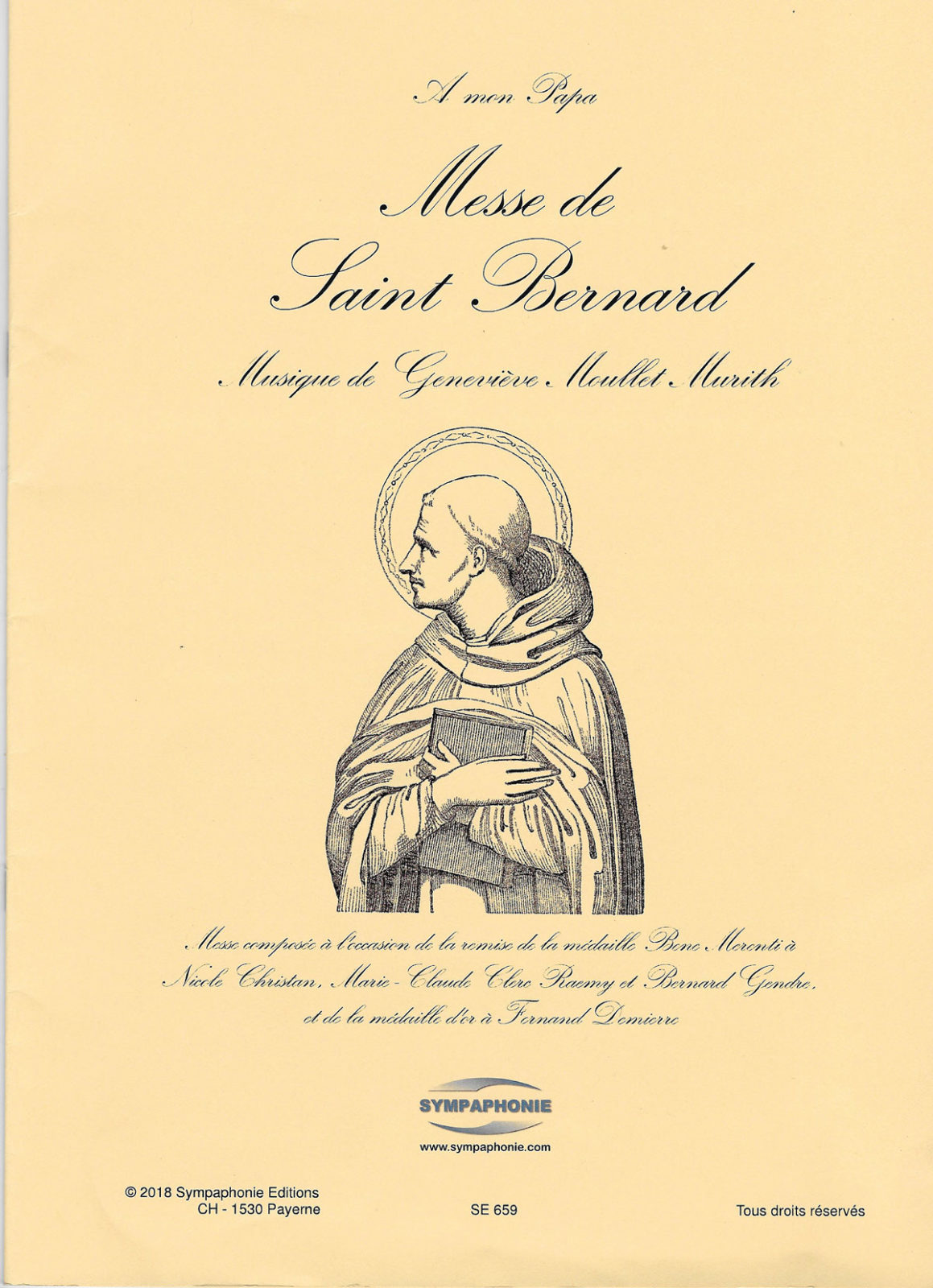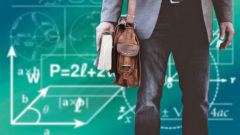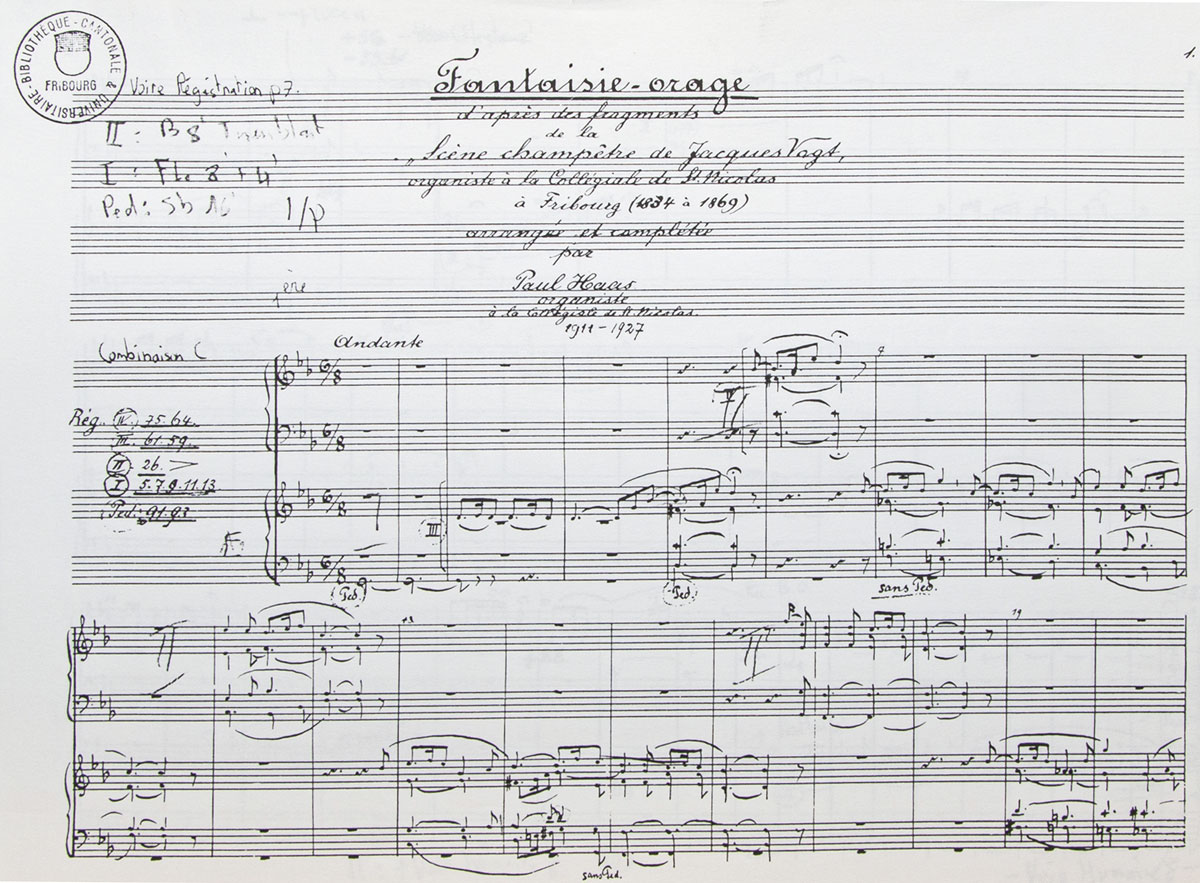La traditionnelle assemblée paroissiale ordinaire, dite des comptes, s’est déroulée le 26 avril dernier au Centre des Focolari à Montet. Une assemblée rondement menée sous la présidence d’Alexandre Duc, qui a vu la soixantaine de membres présents avaliser à l’unanimité l’ensemble des comptes de fonctionnement pour l’année 2022 et plusieurs comptes d’investissements. Ce fut aussi l’occasion de remercier les conseillers de paroisse sortants et d’accueillir les trois nouveaux membres qui ont été assermentés le samedi 29 avril et sont entrés officiellement en fonction le 1er mai.
Par Claude Jenny | Photo: Georges Losey
Une excellente santé financière
Il appartint à Daniel Baudin de présenter pour la dernière fois les comptes détaillés de la paroisse pour 2022. Des comptes qui attestent d’une excellente santé financière et n’ont pas appelé la moindre question ou objection de la part de l’assemblée. La commission financière, par la voix de son président, Michel Losey, s’était exprimée dans le sens d’une acceptation sans condition. Les comptes de fonctionnement pour 2022 ont dès lors été votés à l’unanimité. Des comptes qui, hormis quelques petits écarts inévitables, sont en quasi conformité avec les montants budgetés.
Ces comptes, s’ils bouclent avec un tout petit bénéfice, attestent néanmoins que tout va bien dans « le ménage financier paroissial » ! Avec des charges pour 3,760 millions et des recettes pour 3,776 millions. Donc un mini bénéficie de Fr. 16’000.– environ. Mais il faut interpréter ce résultat en sachant qu’un montant impressionnant de Fr. 900’000.– a été affecté aux réserves : Fr. 600’000.– pour l’entretien des lieux de cultes et Fr. 300’000.– pour les travaux aux autres biens patrimoniaux de la paroisse.
Les chiffres du bilan sont tout aussi bons avec notamment des actifs circulants de 7,036 millions et des actifs immobilisés de 2,21 millions et un total d’actif global de 11,204 millions. Le poste des réserves grimpe au bilan à 2,388 millions. De quoi financer avec les fonds paroissiaux les 2 millions de travaux votés lors de l’assemblée de l’automne dernier.
Une situation financière très enviable pour la paroisse Saint-Laurent Estavayer. Et si elle a versé 1,093 million à la Caisse des ministères et à la Corporation ecclésiastique cantonale, elle a par contre encaissé pas moins de 2,830 millions d’impôts sur le revenu et la fortune des paroissiens et des entreprises. A Fribourg, l’impôt ecclésiastique offre une manne confortable aux paroisses.
Des remerciements et des applaudissement sont venus signifier l’excellent travail accompli par le Conseil de paroisse et en particulier de la boursière, Séverine Rey-Pillonel qui a dû compiler des milliers de chiffres pour, tout au long de cette législature, réaliser l’intégration de douze comptabilités paroissiales en un seul « package comptable ».
Conseil de paroisse : sortants fêtés…
Cette assemblée de printemps a été l’occasion de prendre congé et de remercier les six membres du Conseil de paroisse qui quittent cet organe suite à l’élection tacite de cette automne (voir le magazine paroissial de février 2023). Fleurs et bouteilles sont venues récompenser Fabienne Bondallaz, de Vuissens ; Denyse Chanex, de Cheyres ; Véronique Christinaz de Nuvilly et Marie-Madeleine Marcuard de Cugy ainsi que Daniel Baudin d’Estavayer et Denis Rossier, de Font-Châbles.
… et nouveaux accueillis
Passant de 12 à 9 membres, le nouveau Conseil de paroisse est composé de 6 anciens membres et de 3 nouveaux qui ont été officiellement accueillis. Il s’agit de Marie-Christine Mota, d’Estavayer ; Alexandre Bersier, de Cugy et Michel Clément d’Estavayer. Le nouveau Conseil de paroisse in corpore a été assermenté le samedi 29 avril lors d’une célébration présidée par l’évêque du diocèse et qui a réuni pas moins de 520 conseillers en l’église de Siviriez. Le Conseil de paroisse a tenu sa première séance dans sa nouvelle composition le jeudi 4 mai et est donc entré en fonction pour une nouvelle législature de 5 ans.
Représentants à la CEC réélus
L’assemblée avait à élire pour une nouvelle législature ses deux représentants à la Corporation ecclésiastique cantonale – plus couramment appelée la CEC. Aucune nouvelle candidature ne s’étant proposée, les deux actuels délégués, Marie-Claude Fontaine, de Nuvilly, et Carlo Bonferroni, de Montbrelloz, ont accepté de rempiler et ont donc été réélus comme représentants de la paroisse dans cet important organe de l’Eglise fribourgeoise.
« Nous avons rendu possible l’impossible »
Pour cette dernière assemblée en tant que membre et vice-président du Conseil et titulaire du dicastère des finances, le Staviacois Daniel Baudin a tenu à adresser un message touchant à l’assemblée. Dans une formule choc, il a relevé que, durant ce quinquennat faisant suite à la fusion, l’équipe du Conseil de paroisse avait « rendu possible ce qui a priori ne l’était pas » ! C’est-à-dire faire de 12 paroisses une seule entité !
Et il a relevé avec force que le Conseil de paroisse, tout en œuvrant à 12, voire 15 personnes lors de certaines réunions, était parvenu à conserver une excellente ambiance au sein de l’équipe, les représentants de toutes les communautés tirant à la même corde. « Et ce n’était pas gagné d’avance ! » lança-t-il. « Un énorme travail a été fait et la paroisse est sur de bons rails. Il s’agira pour le nouveau Conseil d’affiner le travail qui a été fait » a-t-il pu constater avec satisfaction.