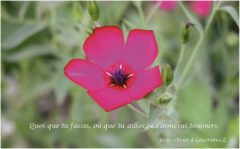« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. »
(Mt 16, 18)
PAR EMMANUEL MILLOUX, MEMBRE DE L’ÉQUIPE PASTORALE
Peu de chrétiens le savent, mais nous ne trouvons que trois fois le mot «Eglise» dans les évangiles. La première occurrence est le passage de Matthieu cité ci-dessus; les deux autres se trouvent dans le chapitre 18 du même évangile. En revanche, nous le trouvons trente-deux fois dans les lettres de Paul. Il est vrai qu’il a joué un rôle fondamental dans la fondation des premières communautés chrétiennes. Et c’est à lui que nous devons la toute première réflexion théologique sur le mystère de l’Eglise. Ce déséquilibre entre les évangiles et les lettres de Paul a donné à certains l’illusion qu’au fond, l’Eglise était plus ou moins une invention de l’apôtre. Jésus aurait prêché l’Evangile et le Royaume de Dieu, Paul aurait fondé l’Eglise.
Rare, donc précieux
Mais la rareté du mot « Eglise » dans les évangiles a peut-être une tout autre signification. Ce qui est rare n’est-il pas précieux ?
Dans la citation de Jésus qui figure en titre, ce qui est étonnant au premier regard, c’est l’adjectif possessif. Il y a de la tendresse dans ce possessif, comme un jeune époux qui parlerait de sa jeune épouse.
Jésus a donc bien voulu l’Eglise. On pourrait même dire qu’il l’a désirée. Ce n’est pas une invention des hommes. Et s’il l’a voulue, c’est qu’elle est hautement nécessaire au projet de Dieu.
De son côté, Pierre, dans sa première lettre, nous dit : « Vous-mêmes, comme pierres vivantes, prêtez-vous à l’édification d’un édifice spirituel […], vous êtes une race élue, un sacerdoce royal […] pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière » (1 P 5, 5-9).
Ce passage est d’une grande importance. Il nous montre que s’il existe un sacerdoce ministériel dans l’Eglise (prêtres et évêques), il y a aussi un sacerdoce baptismal, plus fondamental encore puisque partagé par tous les baptisés, laïcs, religieux et prêtres – on parle aussi de sacerdoce commun. C’est à partir de cette vérité théologique que le concile Vatican II a rappelé l’importance vitale de la mission des laïcs – décrets « Lumen gentium » et « Apostolicam Actuositatem ».
Bâtir l’Eglise ensemble
Jésus a promis à Pierre qu’il bâtirait son Eglise et ce dernier nous dit que nous devons tous prendre part à cette œuvre. Quelle que soit leur place dans la communauté chrétienne, tous les baptisés sont donc associés à cette édification. Nous sommes tous des collaborateurs, nous partageons tous la responsabilité d’édifier ensemble « la maison de Dieu pour tous les peuples » (cf. 1 Tm 3, 14 ; Is 56, 5-7). Non seulement nous y œuvrons mais, plus encore, nous en sommes déjà les pierres vivantes.
La prochaine conférence proposée par notre Unité pastorale, mercredi 9 mars à 19h30 dans la grande salle de la Colombière, nous aidera à approfondir notre compréhension du mystère de l’Eglise. Elle explorera la problématique de la coresponsabilité des baptisés avec Philippe Becquart, responsable du Département des adultes de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, qui abordera le thème « Vivre l’Eglise en coresponsabilité ». Une veillée de prière aura lieu jeudi 31 mars à 19h30 à la Colombière. Le 5 mai à 19h30 dans la grande salle de la Colombière, Frère Benoît-Dominique de la Soujeole, dominicain, parlera de « Marie, mère de l’Eglise ».