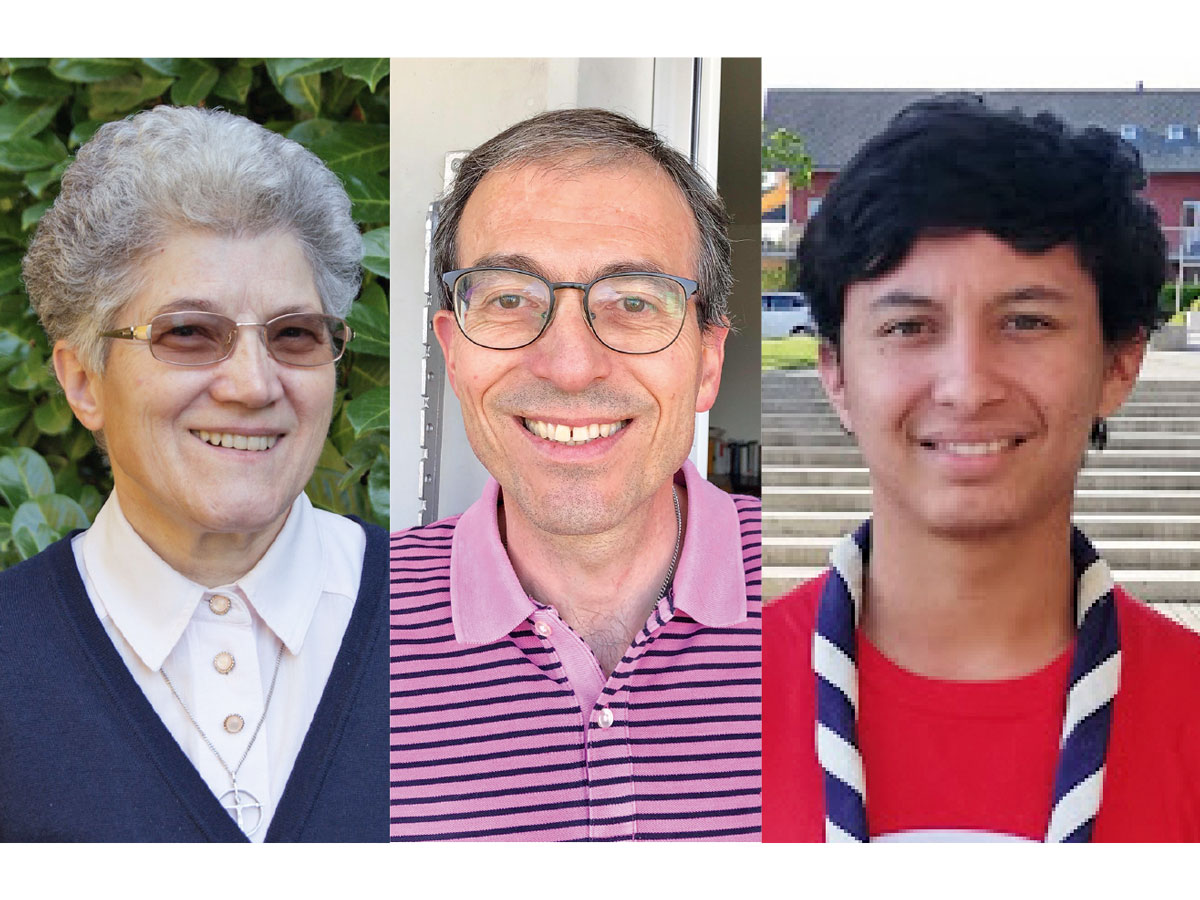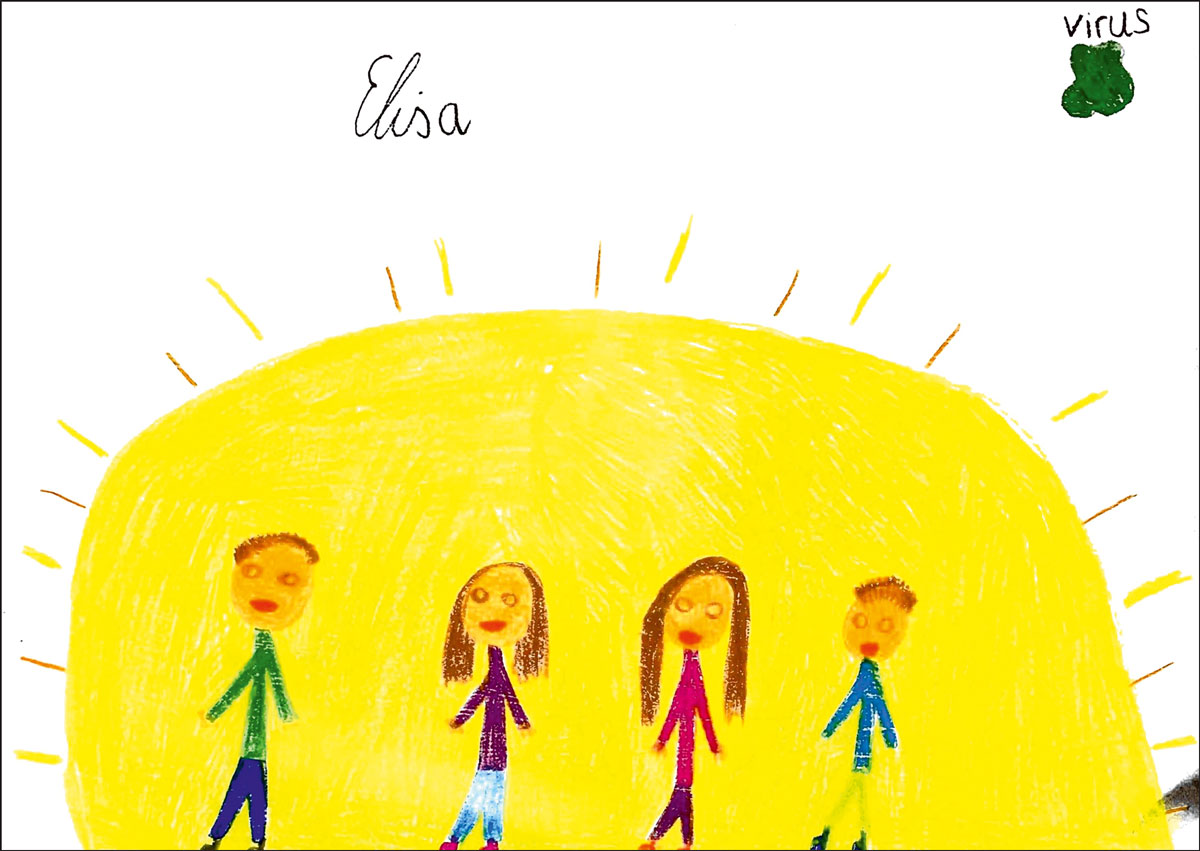Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, Unités pastorales du Grand-Fribourg (FR), septembre-octobre 2020
Par l’abbé Alexis Morard et cath.ch | Photo: Grégory Roth
Un nouvelle rubrique «La joie de l’évangile» s’invite dans votre magazine paroissial, afin d’approfondir la réflexion des équipes pastorales du décanat de Fribourg, s’agissant de l’exhortation du même nom du pape François à réformer nos structures paroissiales. Alexis Morard, doyen du décanat du Grand-Fribourg, souhaite placer la rentrée pastorale 2020 sous le thème de la «synodalité». Qu’est-ce à dire?Les équipes pastorales du décanat de Fribourg ont entrepris une réflexion sur la manière de vivre la coresponsabilité au service de la mission propre à la pastorale paroissiale. Héritées d’une vision centrée sur la figure du curé, nos paroisses sont invitées plus que jamais à se réinventer. Dans son exhortation apostolique
La joie de l’Évangile, le pape François constate que « l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la mission » (n. 27).
Nous reprenons en partie, avec l’aimable autorisation de cath.ch, une interview de Philippe Becquart. *
Philippe Becquart, vous êtes enthousiaste à l’énoncé du mot « synodalité ». Est-ce une nouveauté du pape François ?
François a véritablement thématisé le concept de synodalité. « C’est le chemin de l’église du troisième millénaire », a-t-il déclaré, en ajoutant même : « le chemin que Dieu attend de l’église », dans son discours, en octobre 2015, à l’occasion des 50 ans de l’institution du Synode des évêques. Depuis sa première exhortation La joie de l’évangile, en 2013, tous ses textes suivent une certaine herméneutique, c’est-à-dire une interprétation de la synodalité, qui éclaire ses grandes intuitions pastorales. Pour le Pape, la synodalité n’est pas une technique ou un remède, mais c’est l’être même de l’église et la voie de son renouveau. Car l’église est synodale par nature.
Mais qu’est-ce que l’on dit quand on dit cela ?
Derrière ce mot technique se cache toute une compréhension de l’église qui s’est particulièrement « désenveloppée » depuis Vatican II. Le concept n’est pas nouveau : ce qu’il veut dire, c’est que tout baptisé est un « ministre » appelé à annoncer l’évangile. Autrement dit, nous sommes chacun, prêtres et laïcs, « disciples-missionnaires », disciples appelés à marcher à la suite du Christ et à l’annoncer selon l’état de vie et les lieux existentiels de nos engagements (famille, travail, mouvements, paroisses, communautés, société…). La synodalité, c’est le Peuple de Dieu qui chemine ensemble à la suite du Christ. Ce qui fonde cet être ensemble synodal, c’est le baptême. Le reste relève d’un dévoilement de nos vocations propres, en fonction des charismes et des ministères que le Seigneur nous a donnés ou confiés.
Comment a évolué notre compréhension de l’église au fil du temps ?
La figure de l’assemblée des baptisés que l’on nomme église a largement évolué au cours des siècles. De type épiscopal dans les premiers siècles de l’église, avec ses nombreux conciles pour formaliser le contenu de la foi, elle devient de plus en plus paroissiale, avec son curé, jusqu’à la Réforme. Le concile de Trente, en réponse à la Réforme, va formaliser, dans la liturgie et dans l’organisation territoriale de la paroisse, la figure centrale du prêtre. Nous avons une église pyramidale, avec au sommet le pape, les évêques, puis les prêtres et, tout en bas, les baptisés. Mais la charge pastorale revient en propre au prêtre qui est le pivot de la structure ecclésiale.
Il faut attendre le XXe siècle pour voir les choses évoluer…
Avec Vatican II, les baptisés laïcs changent de statut et deviennent aussi des missionnaires. Mais seulement dans leur champ propre: le monde. La division – que portent peut-être encore les constitutions Lumen Gentium et Gaudium et Spes (Vatican II) – est la suivante : la charge spirituelle, le bien des âmes, revient au ministre. Et le laïc, lui, est missionnaire ad extra : le Peuple de Dieu va témoigner du Christ dans la réalité du monde. Depuis ces dernières décennies toutefois, l’apostolat des laïcs a évolué considérablement. Et dans le concept de « disciples missionnaires » que propose François, le baptisé reçoit lui aussi la charge d’annoncer l’évangile et porte avec le prêtre le bien des âmes, y compris au sein de l’église. Pour le pape, la synodalité veut dire : penser l’église à partir de ceux qui la font, hommes et femmes, tous les baptisés. C’est une théologie du baptême, du peuple de Dieu, de la sainteté.
Cette division, ministres à l’intérieur et laïcs à l’extérieur, n’est donc plus d’actualité…
Aujourd’hui, le gros de l’agir pastoral est porté par des théologiens et des laïcs formés. C’est une force pour l’église, mais c’est aussi un problème. Premièrement, car la structure canonique (droit de l’église) reste axée sur l’idée que la charge pastorale est l’affaire du prêtre. Deuxièmement, la raréfaction numérique du nombre de prêtres. Troisièmement, une déficience en termes de compétences autres que strictement théologiques.
Etre appelé au sacerdoce ne signifie pas forcément avoir des aptitudes de manager, d’organisateur d’une chaîne complexe de tâches où le prêtre s’épuise. Le ministre devient administrateur et beaucoup de prêtres se retrouvent dépossédés de leur vocation initiale. Beaucoup disent qu’ils ne vivent pas ce pour quoi ils ont choisi une vie toute donnée au Christ. C’est une souffrance et parfois même un drame.
Cela suppose de revisiter les représentations que nous avons du ministère…
La vision synodale oblige, en quelque sorte, à passer de la figure du « prêtre-père » qui dirige – ou de l’époux qui commande –, à celle du frère qui chemine. Fondamentalement, c’est une libération, à la fois au niveau affectif, psychologique et humain. Un frère chemine dans la communauté, il fait confiance et il délègue. Parfois, il demande de l’aide, parfois il chute, parfois il est devant, derrière ou dehors. Il n’est pas dans une représentation qui l’oblige à être ce qu’il n’est pas. D’ailleurs, j’ai moi-même constaté que certains prêtres, dans leur manière d’exercer leur ministère, s’inspirent de cette figure du frère qui chemine avec. C’est alors une grâce pour le prêtre, mais aussi pour la communauté qui ne peut vivre sans le pasteur.
N’est-ce pas contradictoire avec le fait que le prêtre représente Jésus ?
C’est justement une des lumières fondamentales du christianisme: Jésus est le Fils et il nous apprend à être des fils et des frères. Il est le Fils qui nous apprend la vraie filiation et la vraie fraternité. La façon dont Jésus chemine avec ses apôtres, ses disciples, hommes et femmes, nous montre comment vivre la fraternité du Fils. Être frères et sœurs dans le Christ. Il n’y a pas autre chose à inventer, que la vraie filiation que nous apprend le Fils.
Et n’est-ce pas aussi l’attitude du pape François ?
Mais bien sûr ! Si vous voulez savoir ce qu’est la vision synodale de François, observez-le lors des Synodes. Que ce soit lors des synodes sur la famille, en 2014-2015, sur les jeunes, en 2018, ou sur l’Amazonie, en 2019, le pape François adopte un comportement et de père et de frère, et il dévoile ce qu’est la synodalité. C’est-à-dire, il permet à l’Esprit Saint de parler à son Eglise. Cela suppose de sortir des textes préparés, d’accepter de remettre en cause les schémas préconçus, et d’oser faire autrement que comme on a toujours fait. La synodalité exige de l’audace, parce qu’elle crée de l’inattendu, du différent, de l’inconfort…
Cela suppose donc de changer, voire de bousculer les structures ?
Changer les structures ne change pas les problèmes. Je ne pense pas que la synodalité passe d’abord par des changements de structures, mais plutôt par des conversions personnelles. La transformation pastorale passe avant tout par une conversion, dont la première condition est d’accepter de se laisser regarder par le Seigneur. Les prêtres, les baptisés ne peuvent espérer une église qui écoute, qui parle vrai, qui accompagne, qui discerne, qui sert les plus pauvres… sans une conversion de toute la communauté.
C’est la responsabilité que nous avons chacun à assumer en conscience et devant le Seigneur. Le risque serait de passer du cléricalisme des prêtres au cléricalisme des laïcs. Cela ne m’intéresse pas spécialement. C’est même ce que je redoute, comme on le voit d’ailleurs avec plusieurs revendications au sein de l’église en Allemagne. Que l’on arrive à plus de désunions, voire à une forme de schisme pratique, ce n’est pas ce que je souhaite.
Que préconisez-vous alors ?
Les laïcs, hommes et femmes, doivent redécouvrir leur baptême : c’est cela le grand défi. Si l’église aujourd’hui, avec le peu de moyens qu’elle a, devait s’atteler à une tâche, ce serait de permettre aux laïcs de redécouvrir toute la potentialité de leur baptême. De cette tâche-là naîtra un renouveau de la mission, de la famille, de la diaconie. Faire confiance aux femmes, aux pauvres, par exemples. Et il ne faut pas avoir peur de penser l’altérité : l’altérité dans les ministères, l’altérité homme-femme, l’altérité pauvre-riche, etc. Ce qui constitue également un grand chantier de la synodalité.
* Philippe Becquart est un théologien français, natif du Vaucluse (France). établi à Fribourg depuis plus de vingt ans, après une formation en droit et en sciences politiques, il y a effectué ses études de théologie. Il a enseigné la philosophie pendant dix ans.
Marié et père de famille, il a été engagé en 2016 à la tête du département des Adultes de l’église catholique dans le canton du Vaud (ECVD).
 Cette lettre, le pape François en a eu l’intuition pendant la première vague de la pandémie. Il a vu en Joseph le modèle de toutes celles et tous ceux qui ont sauvé notre société par leur travail et leurs services et qui passent en temps normal inaperçus : « Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en « deuxième ligne » jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. »
Cette lettre, le pape François en a eu l’intuition pendant la première vague de la pandémie. Il a vu en Joseph le modèle de toutes celles et tous ceux qui ont sauvé notre société par leur travail et leurs services et qui passent en temps normal inaperçus : « Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en « deuxième ligne » jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. »





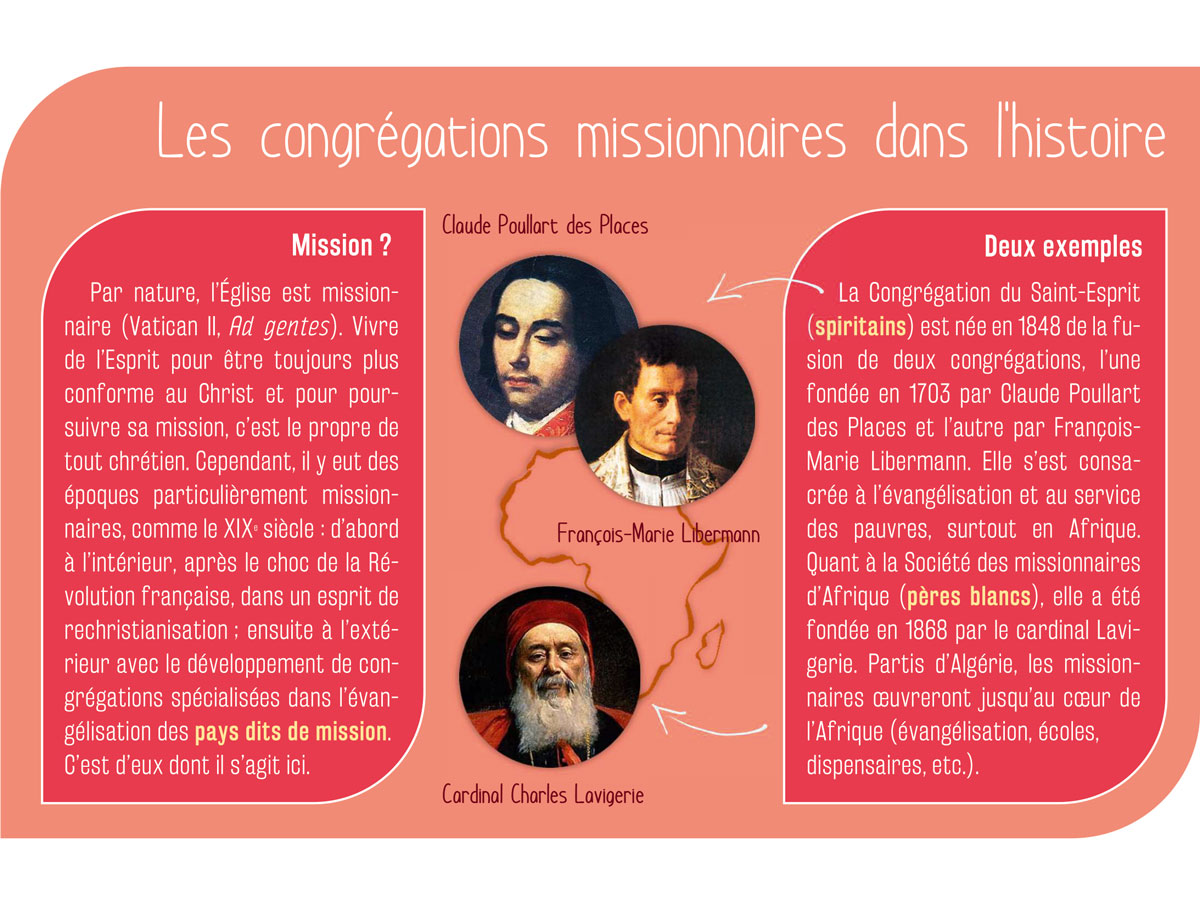
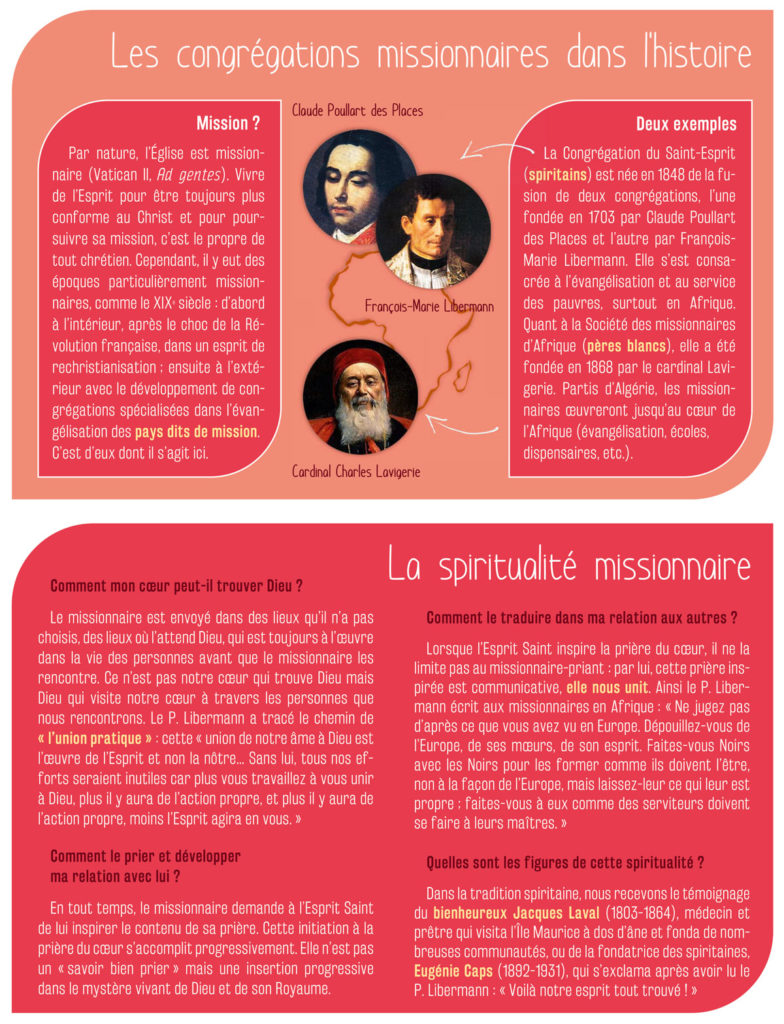
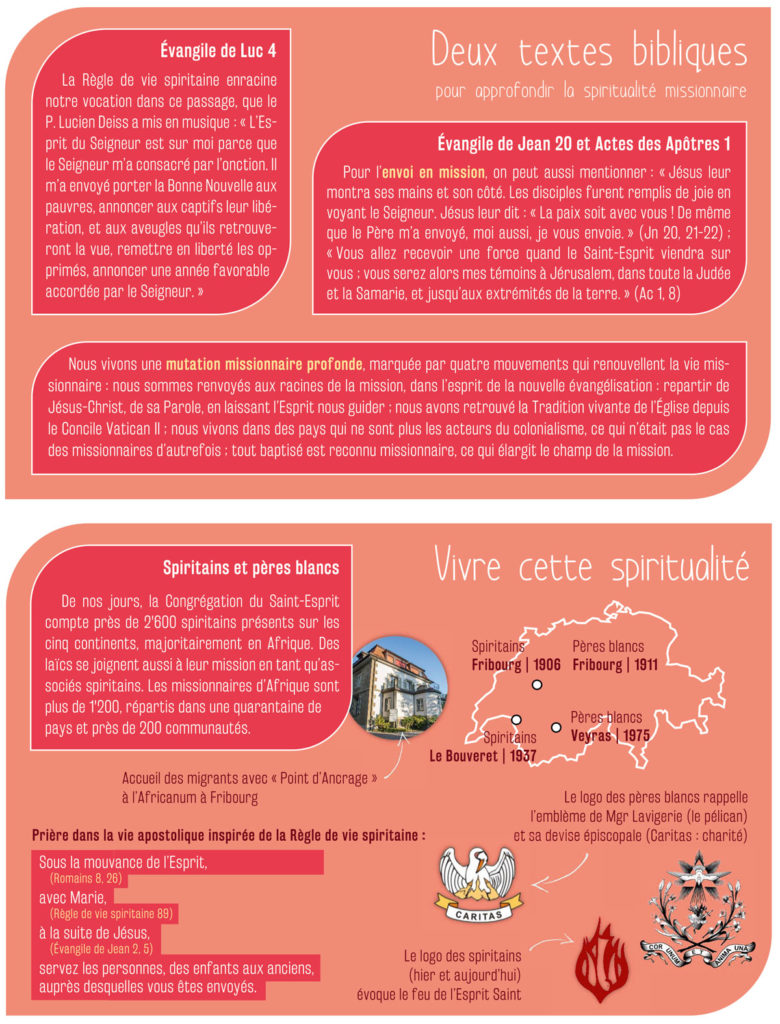

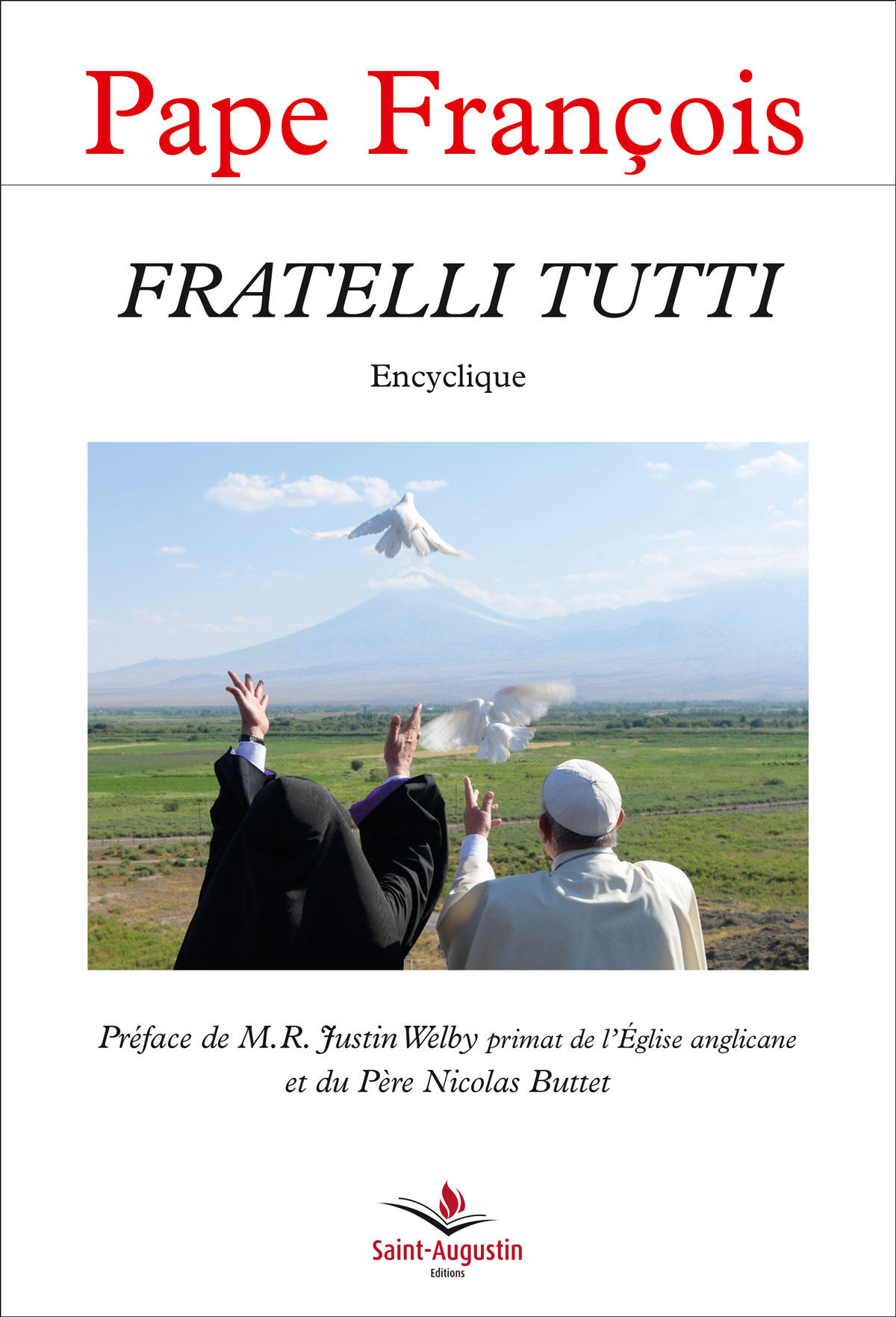 Citant de manière surprenante une chanson de l’auteur-compositeur brésilien Vinicius de Moraes, avec renvoi en note à son disque de 1962 (no 215), ainsi que le cinéaste Wim Wenders (no 203), le théologien Karl Rahner (no 88), beaucoup saint Thomas d’Aquin, des philosophes reconnus tels un Gabriel Marcel (no 87) ou Paul Ricoeur (no 102) ou même le controversé Georg Simmel (no 150), le futur pape Karol Wojtyla (no 88) encore jeune évêque dans son ouvrage « Amour et Responsabilité », mais aussi un maître de spiritualité tel René Voillaume (no 193), le Pape aime surtout se référer aux saintes écritures, à ses prédécesseurs, aux conférences épiscopales du monde entier, à ses propres écrits ou interviews, et en particulier à son ami le grand imam de l’université d’Al Azhar Ahmad Al-Tayyeb, avec qui il a signé le « document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune » à Abou Dabi en février 2019. Le Pape conclut d’ailleurs ses réflexions en reprenant leur appel commun. Mais le Pape dit aussi sa redevance à Martin Luther King, Desmond Tutu, Gandhi, et en particulier à Frère Charles de Foucauld qui inspire la prière proposée en conclusion de l’encyclique.
Citant de manière surprenante une chanson de l’auteur-compositeur brésilien Vinicius de Moraes, avec renvoi en note à son disque de 1962 (no 215), ainsi que le cinéaste Wim Wenders (no 203), le théologien Karl Rahner (no 88), beaucoup saint Thomas d’Aquin, des philosophes reconnus tels un Gabriel Marcel (no 87) ou Paul Ricoeur (no 102) ou même le controversé Georg Simmel (no 150), le futur pape Karol Wojtyla (no 88) encore jeune évêque dans son ouvrage « Amour et Responsabilité », mais aussi un maître de spiritualité tel René Voillaume (no 193), le Pape aime surtout se référer aux saintes écritures, à ses prédécesseurs, aux conférences épiscopales du monde entier, à ses propres écrits ou interviews, et en particulier à son ami le grand imam de l’université d’Al Azhar Ahmad Al-Tayyeb, avec qui il a signé le « document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune » à Abou Dabi en février 2019. Le Pape conclut d’ailleurs ses réflexions en reprenant leur appel commun. Mais le Pape dit aussi sa redevance à Martin Luther King, Desmond Tutu, Gandhi, et en particulier à Frère Charles de Foucauld qui inspire la prière proposée en conclusion de l’encyclique.
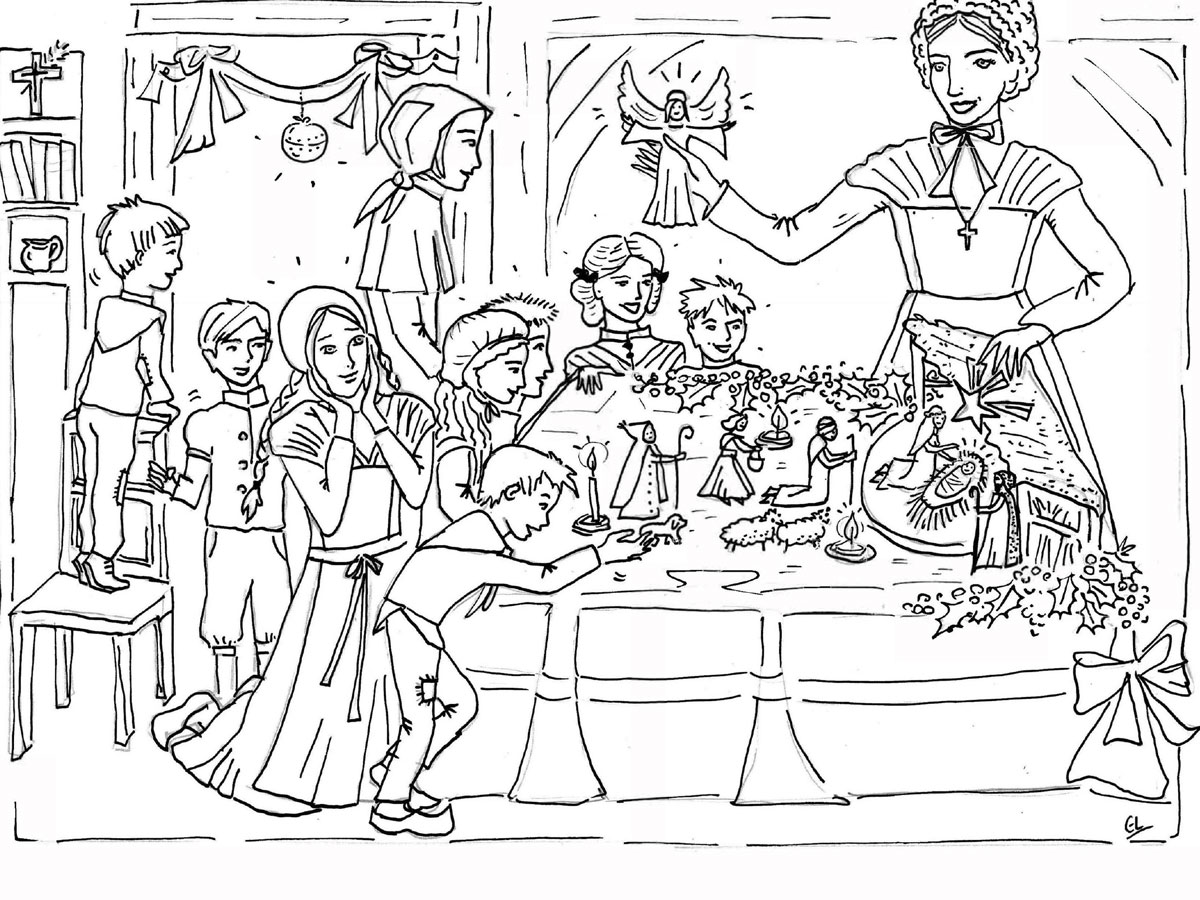











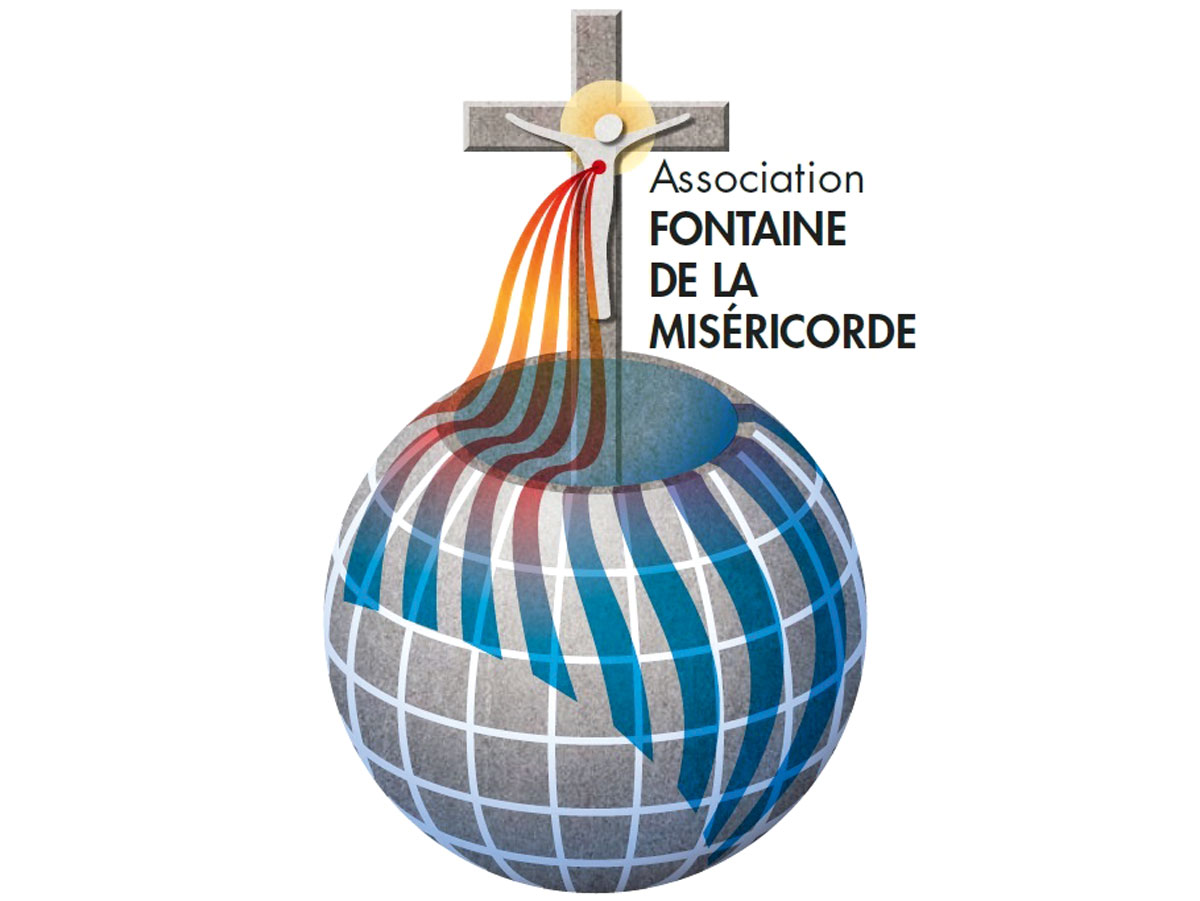
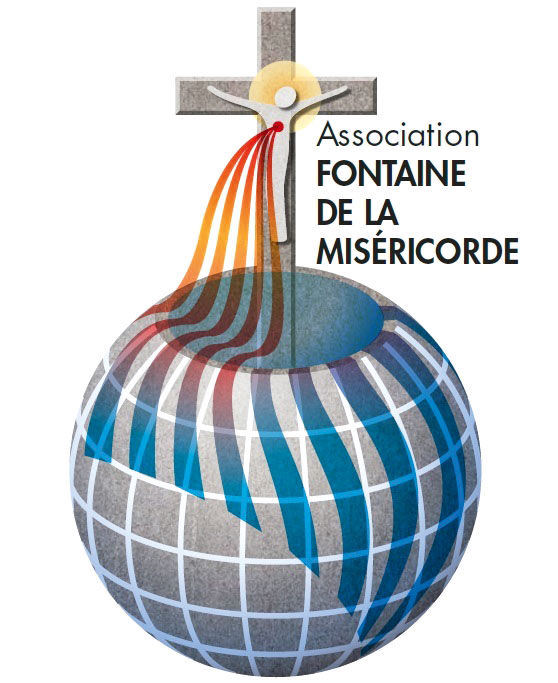 L’Association Fontaine de la Miséricorde propose à Fribourg, un parcours d’initiation à l’oraison, une « rencontre et union à Dieu dans le silence ». Dès la rentrée 2020, des rencontres mensuelles sont organisées le lundi à 16h. Les séances d’une heure et demie permettent un approfondissement de la prière personnelle et silencieuse. Chaque rencontre se vit en quatre temps : accueil, enseignement, temps d’oraison ensemble et partage.
L’Association Fontaine de la Miséricorde propose à Fribourg, un parcours d’initiation à l’oraison, une « rencontre et union à Dieu dans le silence ». Dès la rentrée 2020, des rencontres mensuelles sont organisées le lundi à 16h. Les séances d’une heure et demie permettent un approfondissement de la prière personnelle et silencieuse. Chaque rencontre se vit en quatre temps : accueil, enseignement, temps d’oraison ensemble et partage.