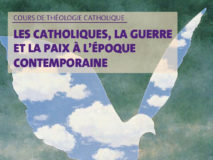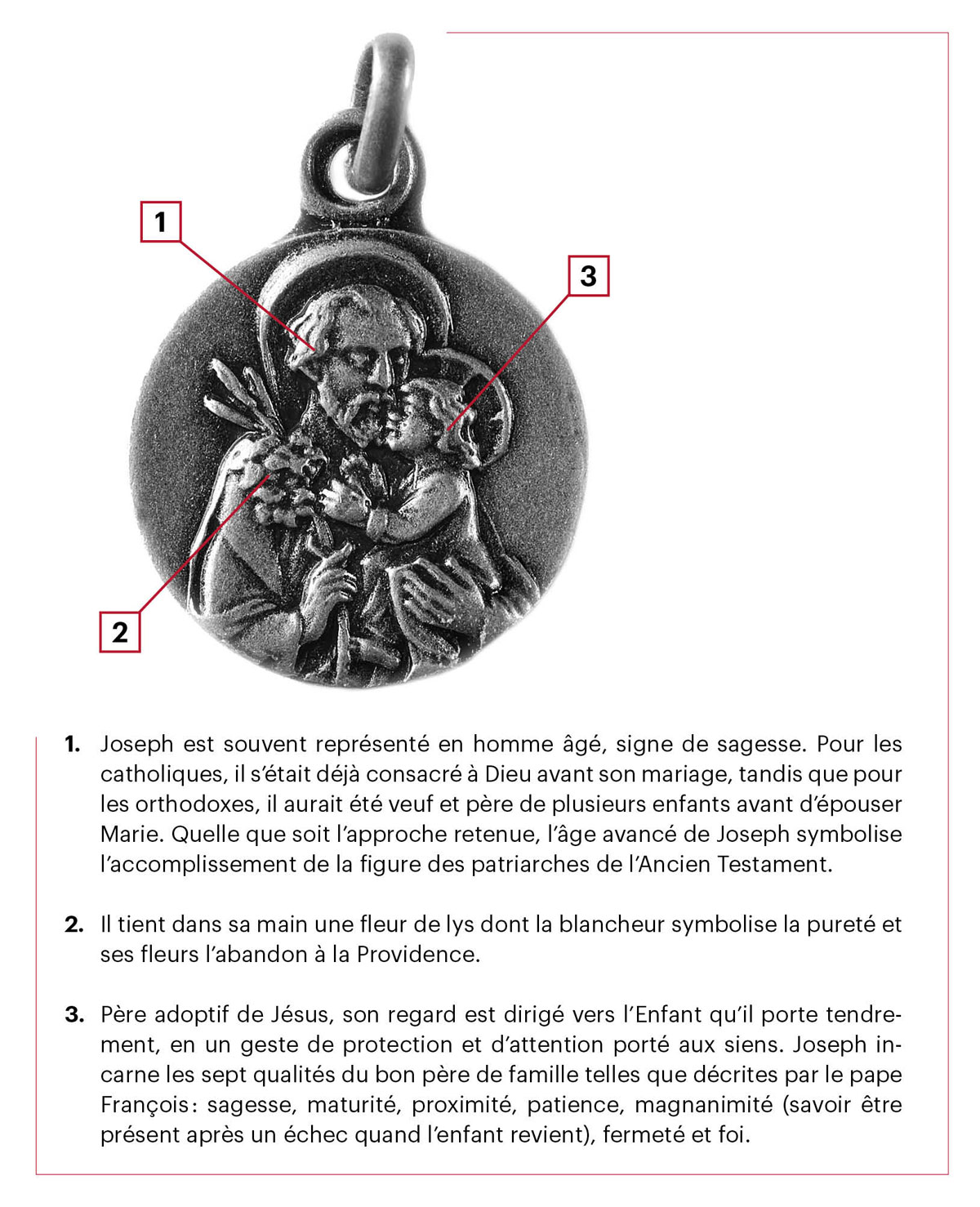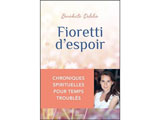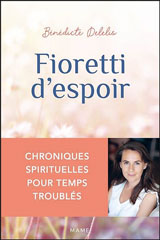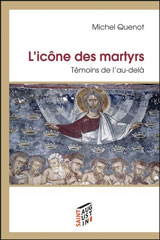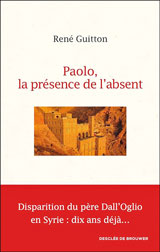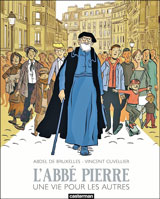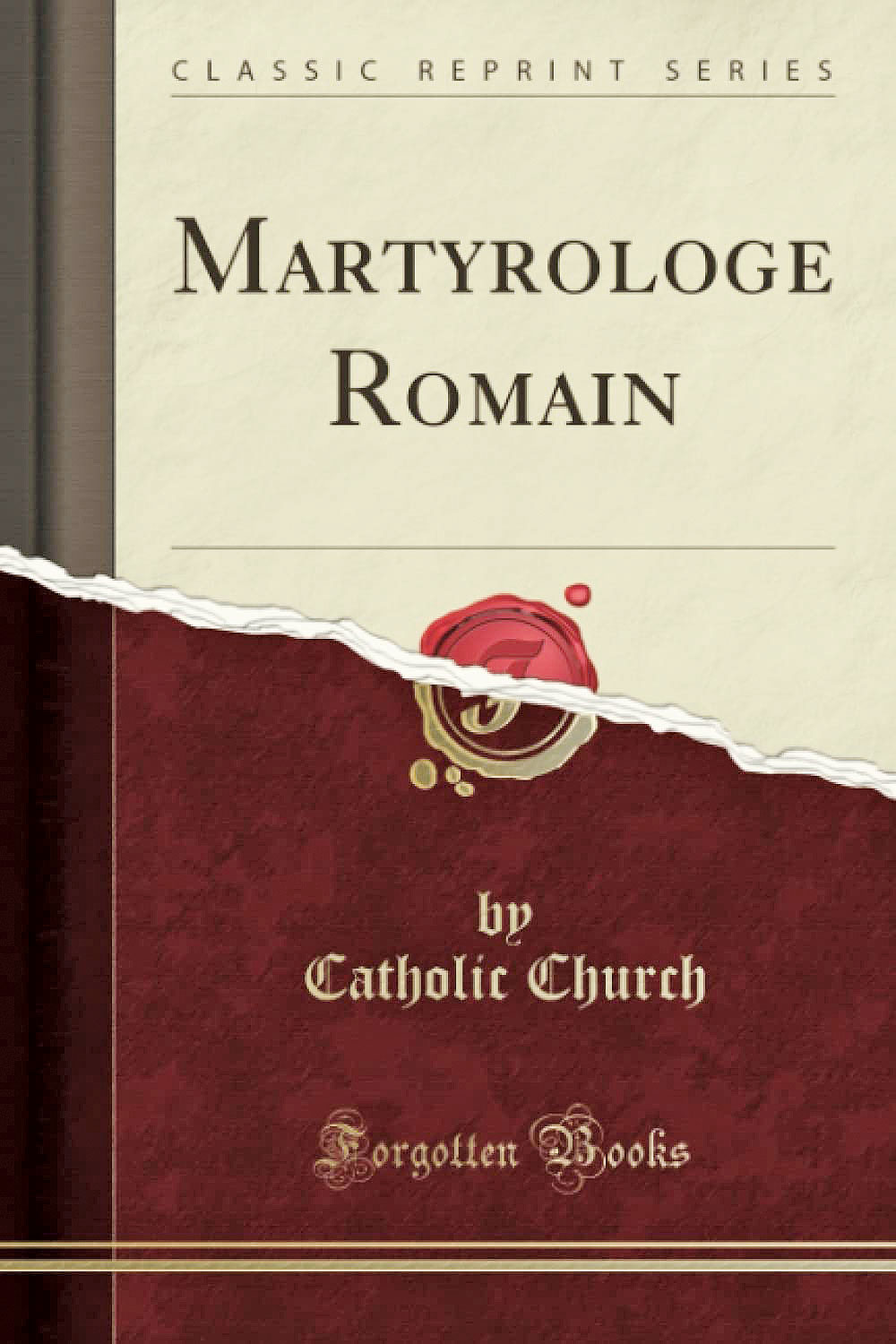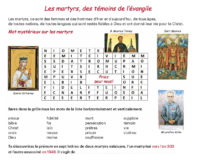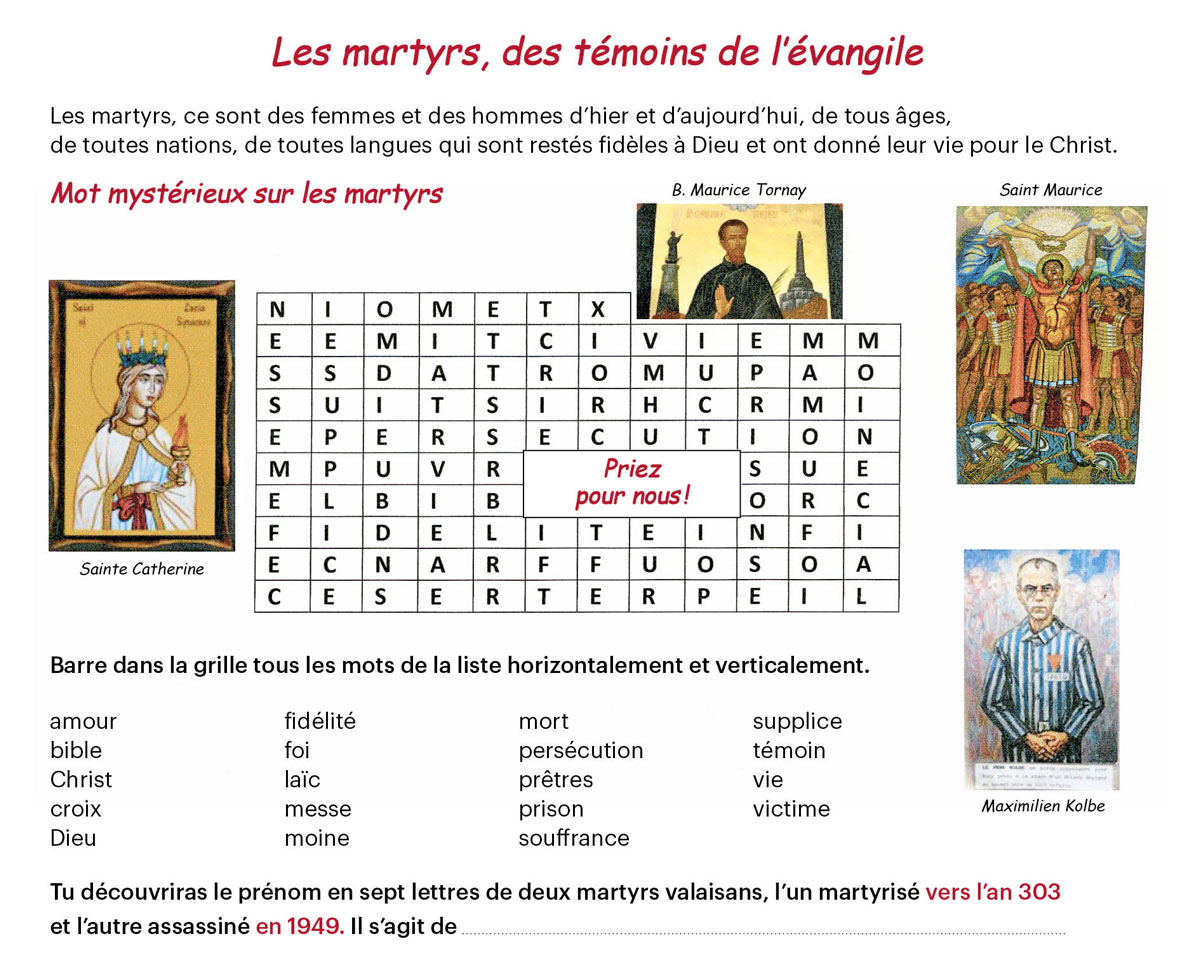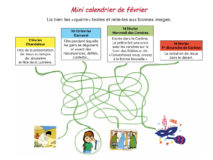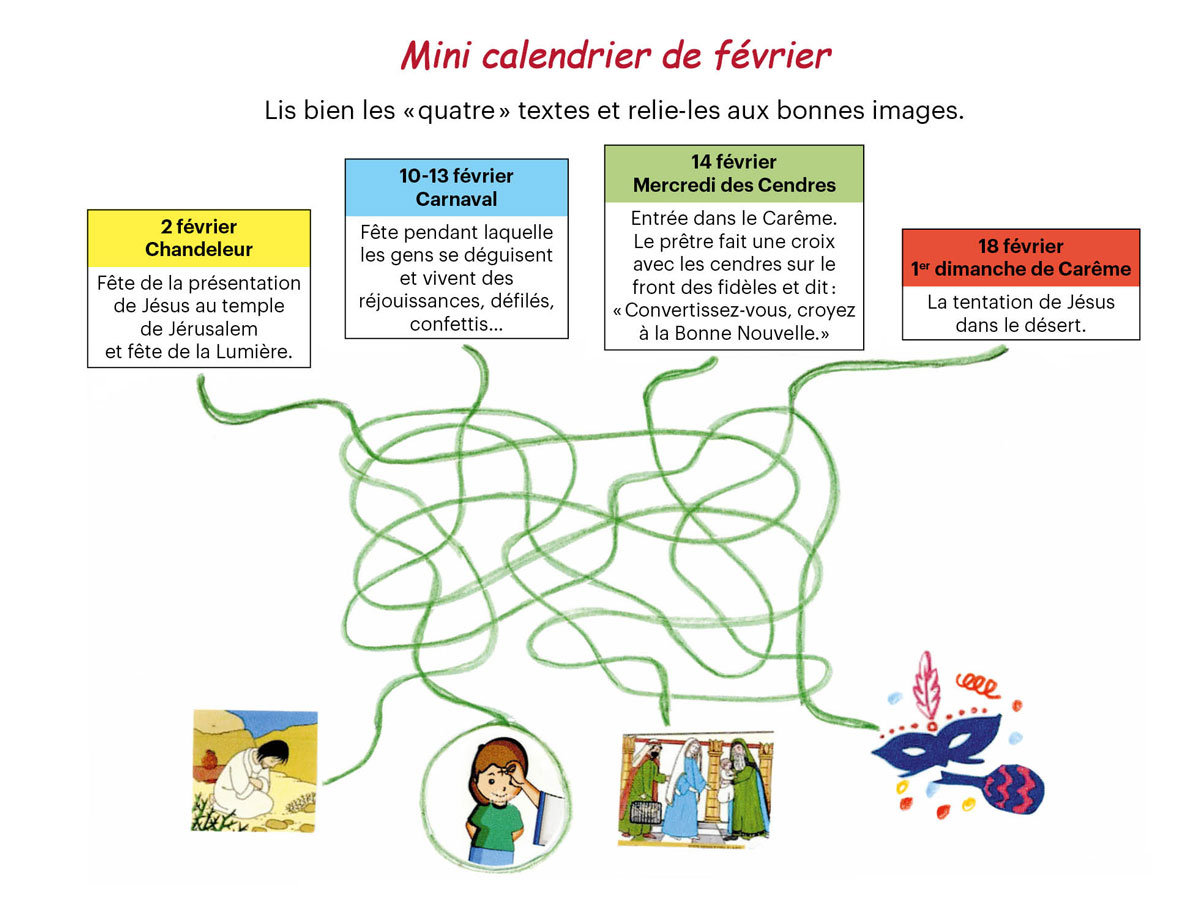L’intelligence artificielle (IA) grignote chaque jour un peu plus d’espace dans nos vies. Porteuse de promesses dans certains domaines tels que la recherche médicale, elle ne cesse de générer craintes et mises en garde, et ce, jusqu’au Vatican. Eclairage avec Ezekiel Kwetchi Takam, dont les travaux explorent les enjeux éthiques de l’intelligence artificielle.
Par Myriam Bettens | Photos : Jean-Claude Gadmer

Cette année, les débats du Forum économique mondial (WEF) portaient sur l’intelligence artificielle et sa régulation. L’IA est considérée comme l’un des principaux risques de la prochaine décennie. Qu’en pensez-vous ?
L’intelligence artificielle est bien l’un des plus grands dangers de la prochaine décennie, mais pas pour les raisons apocalyptiques et extinctionnistes auxquelles nous pensons. Ce discours-là est essentiellement articulé autour d’un questionnement existentiel de l’intelligence artificielle, alors que les enjeux concrets se déploient déjà. Elle est dangereuse, non pas parce qu’elle anéantirait la civilisation humaine suivant un schéma de science-fiction, mais en raison de ses impacts écologiques, économiques et humains. Prenons l’écologie. L’énergie nécessaire à la puissance de calcul pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle populaire aujourd’hui représentera 14 % des émissions totales de CO2 en 2040.
L’ONU souhaite la création d’un pacte mondial pour le numérique, or il existe aujourd’hui au moins sept cents politiques d’encadrement de l’intelligence artificielle avec des priorités et des systèmes de valeurs différentes. On s’en sort comment ?
L’existence d’une pluralité de chartes éthiques n’est pas véritablement un problème, à condition qu’il existe une réelle redistribution de ses chartes dans les différentes régions du monde. En d’autres termes, il faudra que toutes les régions du monde puissent produire des chartes qui s’inscrivent dans leur réalité socioculturelle. L’initiative de l’ONU serait alors fructueuse, d’une part, si elle se libère de cette naïveté de croire qu’elle pourra produire un pacte mondial et d’autre part en capabilisant toutes les régions du globe afin qu’elles puissent penser des réflexions éthiques sur l’intelligence artificielle et les partager sur une plateforme gérée par l’ONU où ces différentes visions pourraient entrer en dialogue.
OpenAI [développeur de ChatGPT] vient de révéler le démarrage d’une collaboration avec le département américain de la défense. Les sept péchés capitaux rapportent apparemment plus que le développement d’une IA « éthique » ?
Absolument et c’est très révélateur de cette idéologie accélérationniste et technocapitaliste qui sous-tend le développement des intelligences artificielles. Au sein de OpenAI, deux visions du futur de l’intelligence artificielle se confrontent. Ceux qui souhaitent la ralentir, car elle pourrait poser de grands défis à l’avenir et ceux qui la considèrent comme une possible solution à tous les maux de l’humanité. Le CEO, Sam Altman, semble faire partie de cette catégorie. Certes, dans ce discours, on peut ressentir une certaine tonalité altruiste, mais au fond c’est une idéologie qui s’inscrit simplement dans un capitalisme néolibéral.
A l’occasion de la journée mondiale de la paix, le Pape a exhorté à un développement éthique de l’intelligence artificielle. Est-ce un vœu pieux de sa part ?
Je trouve cette réflexion du Pape très pointue d’un point de vue conceptuel et très riche au niveau propositionnel. Ce n’est pas la première initiative du Pape en ce sens. Le Vatican a toujours été très précurseur dans les réflexions autour de l’éthique de l’intelligence artificielle. Déjà en 2020, l’Académie pontificale pour la vie avait publié L’appel de Rome pour une éthique de l’IA, entérinée par plusieurs entreprises dans le domaine dont IBM et Microsoft. Ce n’est donc pour moi pas un vœu pieux, car dans notre société, le futur nous appartient, il est le résultat de notre volonté. Le plus important est d’avoir des volontés réalistes, innovantes et disruptives et cet appel s’inscrit dans ce dynamisme-là. L’essentiel serait maintenant de savoir si nous avons la volonté de porter ce dessein à son stade de réalisation et là, c’est un choix qui nous appartient.
Bio express
Ezekiel Kwetchi Takam est né en 1998 à Bertoua (au Cameroun). Il est doctorant en éthique théologique à l’Université de Genève. Ses travaux explorent, sous une perspective théologique, les enjeux éthiques de l’intelligence artificielle. Outre ses recherches, il propose conférences et accompagnement des entreprises souhaitant répondre éthiquement aux problématiques posées par ces nouvelles formes d’intelligence.