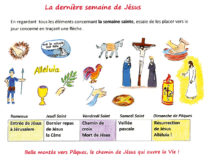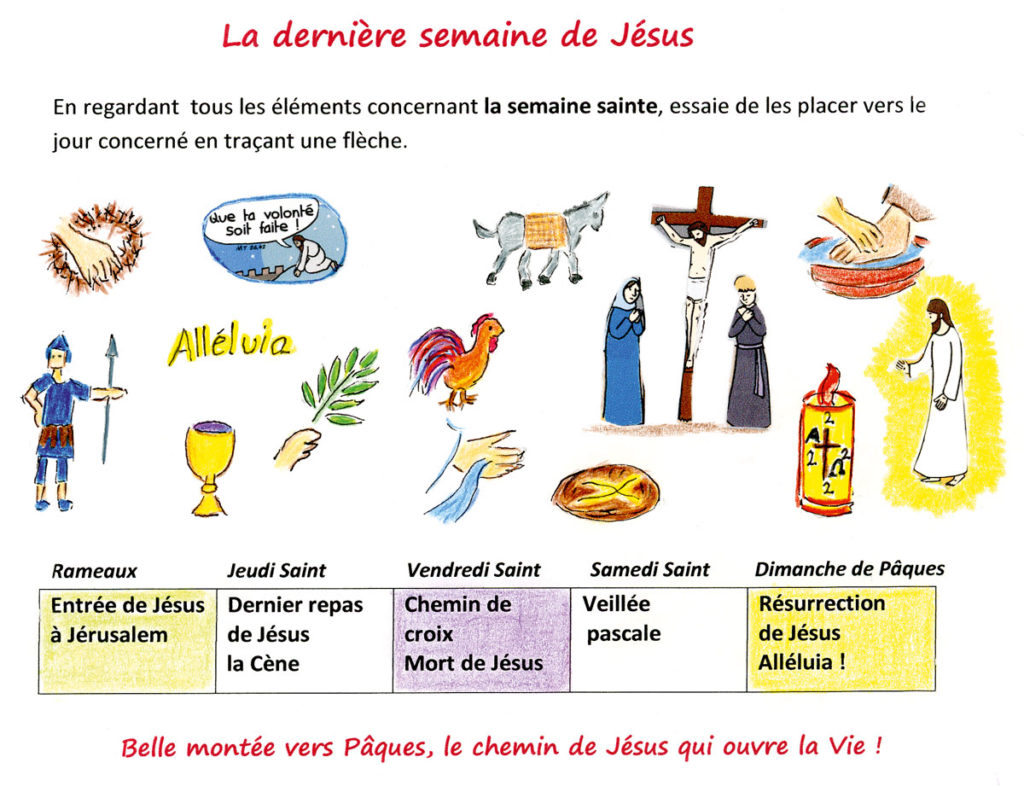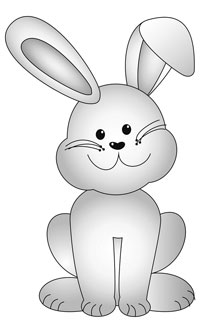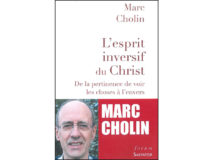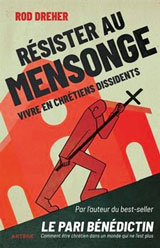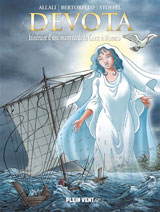De nombreuses communautés composées de religieux ou de laïcs sont présentes en Suisse romande, comme autant de témoins de la vitalité et de la diversité de l’Eglise. Ce mois-ci, cap sur les Focolari.
PAR PASCAL ORTELLI | PHOTO: DR
Fondatrice: Jeune institutrice, Chiara Lubich (1920-2008) initie, en pleine guerre, un nouveau style de vie au service de l’unité et d’une fraternité universelle renouvelée, en s’inspirant des principes de l’Evangile, en écho avec les valeurs présentes dans d’autres religions et cultures.
Dates clés:
1943 : une première communauté démarre à Trente. Les habitants l’appellent focolare (de l’italien « foyer »), car l’amour y circule comme dans une famille. Le nom est resté;
1948 : l’écrivain et journaliste Igino Giordani devient le premier focolarino (sorte de laïc consacré) marié et un grand promoteur du mouvement à l’internationale;
1962 : le pape Jean XXIII reconnaît officiellement le mouvement;
1987 : les Focolari, par le biais de leur organisation « Humanité Nouvelle » sont reconnus comme ONG par l’ONU ;
1998 : Chiara Lubich reçoit le Prix européen des droits de l’homme.
Organisation: Le mouvement, présidé par une femme d’après ses statuts, est présent dans 182 pays. En Suisse, il compte environ 1000 membres et est en contact avec quelque 20’000 personnes. Les formes d’engagements sont variées (rassemblement de jeunes, journée de formation pour les familles et groupes locaux de partages, volontariat, etc.). Les focolarini s’engagent à maintenir le « feu » allumé et vivent en petite communauté de laïcs, tout en travaillant dans le monde et en mettant en commun ce qu’ils possèdent.
Mission: Vivre l’unité dans la diversité, en contribuant à davantage de fraternité dans le monde.
Présence en Suisse:
A Zurich s’ouvre un premier focolare en 1961 puis à Genève, Lugano et Berne.
A Baar démarre en 1975 un centre de formation qui regroupe aujourd’hui la cité pilote «Pierre angulaire».
A Montet, un centre international assure depuis 1981 la formation des jeunes qui souhaitent entrer dans un focolare.
Une particularité: En 1962, en voyant l’abbaye d’Einsiedeln, Chiara Lubich a l’idée de créer des cités-pilotes composées de maisons, lieux de travail et d’école témoignant de l’idéal d’unité du mouvement.
Pour aller plus loin: focolari.ch
« Le mouvement des Focolari, c’est… »
par Paul Legrand, focolarino à Montet
… répondre à l’appel du Christ : « Viens, suis-moi ! Laisse tout pour moi ! Vis ce que j’ai demandé : « là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » » (Mt 18, 20). Après l’avoir vécu en Italie, Belgique, Kenya, Congo, je le vis maintenant avec une centaine de personnes de 35 nations à Montet dont la moitié, des jeunes, porteront ce feu de l’Evangile vécu dans les différents continents au terme de leur année vécue ici.









 Vendredi saint, l’an dernier. J’entre dans une église valaisanne pour l’office. Je prends au passage le petit livret proposé aux fidèles pour accompagner la liturgie. Quelle n’est pas ma surprise? L’illustration qui accompagne les textes liturgiques n’est pas une icône, une croix ou quelque autre symbole religieux, mais le dessin mignon d’un enfant tenant un ballon en forme de cœur.
Vendredi saint, l’an dernier. J’entre dans une église valaisanne pour l’office. Je prends au passage le petit livret proposé aux fidèles pour accompagner la liturgie. Quelle n’est pas ma surprise? L’illustration qui accompagne les textes liturgiques n’est pas une icône, une croix ou quelque autre symbole religieux, mais le dessin mignon d’un enfant tenant un ballon en forme de cœur.