Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Nyon-Founex (VD), mai-juin 2020
Par Olivier Cazelles et Françoise de Courten | Photo: Frédéric Charles, Olivier Cazelles
Formation des animateurs
Invités par l’Equipe pastorale, le 19 février, nous étions plus d’une vingtaine, animateurs, organistes, responsables en catéchèse et prêtres, à participer à une rencontre consacrée à l’animation liturgique sur notre Unité pastorale à la buvette de la Colombière. Elle était animée par l’abbé Jean-Claude Dunand, curé modérateur.L’abbé Dunand a présenté un projet d’animation pour le Carême 2020 en lien avec l’année des bénévoles et pour l’ensemble des communautés afin qu’il y ait une certaine cohérence sur l’Unité pastorale (UP). Il a souligné l’importance d’une procession pour entrer dans l’église au début de la messe : derrière la croix, les enfants de chœur, les lecteurs, quelques bénévoles et l’officiant s’avancent jusqu’à l’autel.
Cette procession est un geste fort qui met en évidence l’engagement des paroissiens dans la vie de nos communautés au service de l’Eglise. La croix est le symbole de notre passage vers la résurrection du Christ. Elle restera en évidence à côté de l’autel pendant toute la célébration.
Après l’homélie, il est proposé un temps de silence (ne pas craindre le silence !), puis on chante « Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, nous vivons de sa vie de ressuscité, proclamons notre foi » avec un couplet en lien avec les textes de chaque dimanche de Carême.
Cette liturgie doit nous parler, et elle sera affinée en communauté.
Des rites qui ont du sens
Comme l’a affirmé l’abbé Dunand, à la messe nous célébrons un mystère dans lequel nous entrons. La liturgie de la messe est un chemin vers le Christ, vers la vie éternelle. Il y a un mouvement, un rythme, on se laisse porter en profondeur par le mystère qui est célébré.
En réponse aux questions pertinentes des participants, le curé modérateur a repris chaque élément de la messe. Il a fait remarquer que ce rite est très codifié, très structuré, mais qu’à l’intérieur de ce cadre, nous disposons d’une grande liberté.
Il a rappelé la dignité et la beauté de la liturgie, un patrimoine à préserver. La cérémonie doit porter à la prière et nous devons toujours avoir en vue la qualité et la beauté à travers les gestes posés. La rencontre nous a ressourcés et a nourri notre réflexion.
Quelques points qui ont retenu notre attention
Préparation : la préparation des célébrations avec le célébrant est essentielle afin qu’il puisse être au diapason de ce qui a été choisi par les communautés.
Procession : l’assemblée se lève non pour accueillir le prêtre, mais le Christ.
Salutation : « Le Seigneur soit avec vous. » Si le célébrant le dit tête baissée, ça n’a pas de sens. Il s’adresse à l’assemblée. On entre dans le mystère à travers le prêtre, l’animateur, l’organiste, le lecteur.
Kyrie : c’est un acte d’humilité et de reconnaissance pour le pardon reçu. Je reconnais, Seigneur, ton amour, ta miséricorde.
Gloria : maintenant que nous sommes pardonnés, nous louons Dieu. C’est une prière de pure louange.
Lecture de l’évangile : l’alléluia accompagne la procession du prêtre jusqu’à l’ambon. « Ecoute ! » : obéir à la Parole. Renoncer à soi-même pour suivre le Christ. Ecouter pour grandir.
Psaume : beauté et importance des psaumes qui sont des prières très anciennes et d’une grande profondeur remises en valeur par Vatican II. Le psaume est en quelque sorte une réponse du peuple de Dieu à sa Parole. Nous pouvons le lire ou le chanter.
Silence : il convient de respecter un temps de silence après l’homélie et l’offertoire et après l’élévation pour permettre aux fidèles de contempler le mystère.
Offertoire : on offre le pain et le vin, fruits du travail des hommes. Les paniers de la quête sont l’offrande de la communauté : on les dépose au pied de l’autel.
L’anamnèse peut être chantée par le prêtre ou le diacre ; l’assemblée répond. Ce doit être un dialogue.
Doxologie : « Par lui, avec lui et en lui » fait partie de l’élévation. C’est un moment très fort : on proclame le Christ maintenant. Les paroissiens disent leur accord, amen, avec force.
Annonces orales : elles doivent être courtes et mentionner ce qui manque au feuillet dominical. Il faut laisser se terminer le rite de la communion avant.
L’ambon étant le lieu de la proclamation de la Parole et de l’homélie, il faudrait trouver un autre lieu pour les annonces orales.






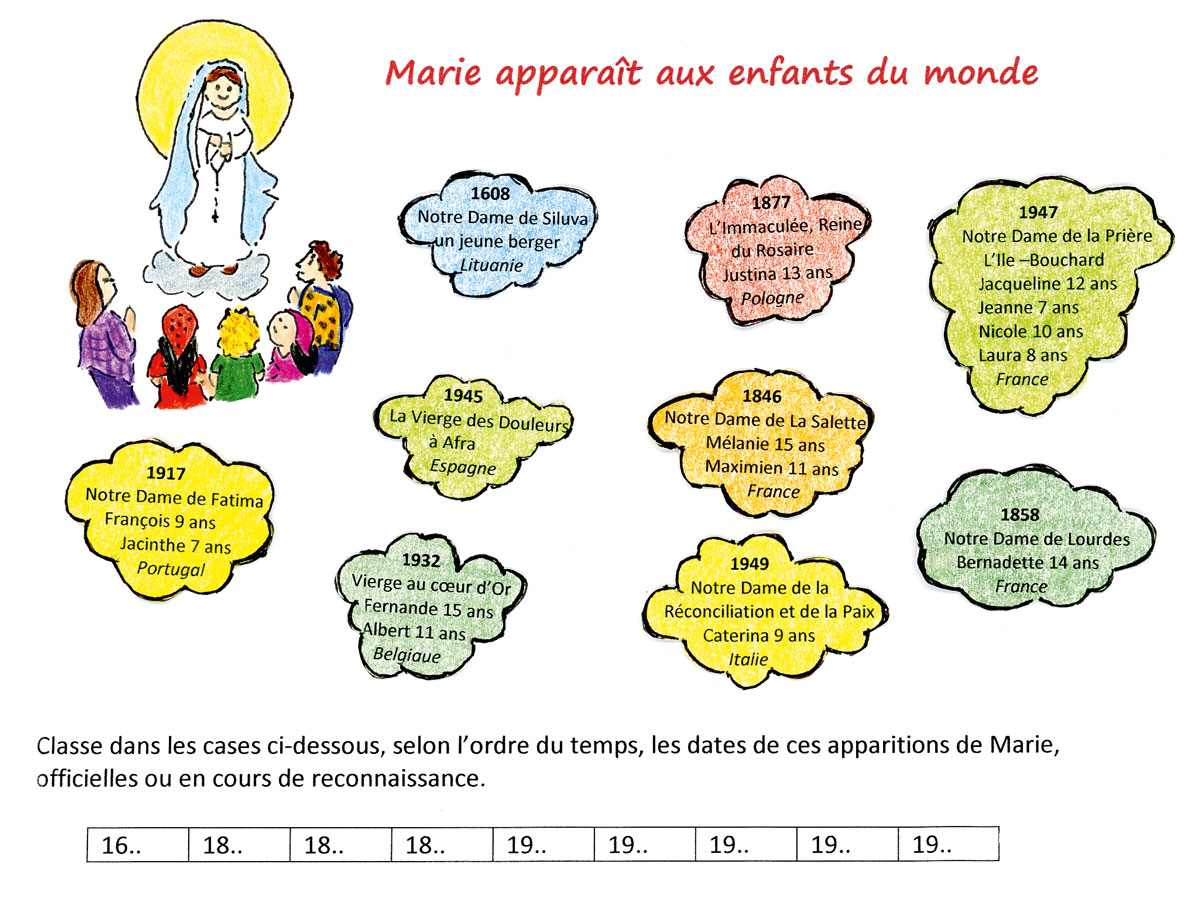
 Une grand-maman qui garde Camille parce que ses parents sont à l’hôpital pour l’accouchement de leur deuxième enfant, vient toute heureuse annoncer la nouvelle à la petite fille de 5 ans : « Cette nuit, un ange t’a apporté un petit frère ! Veux-tu que nous allions le voir ? – Nan ! dit Camille, Ze veux voir l’anze. »
Une grand-maman qui garde Camille parce que ses parents sont à l’hôpital pour l’accouchement de leur deuxième enfant, vient toute heureuse annoncer la nouvelle à la petite fille de 5 ans : « Cette nuit, un ange t’a apporté un petit frère ! Veux-tu que nous allions le voir ? – Nan ! dit Camille, Ze veux voir l’anze. »

















 Voilà bientôt un an que j’ai rejoint l’équipe de L’Essentiel et je ne me suis pas encore présentée : Audrey, 22 ans, nouvelle rédactrice de votre bulletin. Enchantée !
Voilà bientôt un an que j’ai rejoint l’équipe de L’Essentiel et je ne me suis pas encore présentée : Audrey, 22 ans, nouvelle rédactrice de votre bulletin. Enchantée !
