«Un barbu grisonnant à la grosse voix!» répond Alicia, 7 ans, à la question: «Dieu, c’est qui pour toi?» Héritage de siècles de phallocratie judéo-chrétienne, et ce n’est ni Augustin ni Thomas d’Aquin qui nous contrediraient! Et pourtant, Dieu créa la femme. Certes. Mais pour la chrétienne, la croyante, la théologienne, la canoniste, voire la servante de messe, quelle place en Eglise aujourd’hui?
Par Thierry Schelling
Photos : Jean-Claude Gadmer, LddOui, il y a amélioration depuis le Concile Vatican II. 1 Et il convient d’affirmer haut et fort que « historiquement, c’est dans le christianisme que s’est accomplie une véritable égalité spirituelle entre les hommes et les femmes, base d’une véritable égalité sociale », 2 grâce aux principes du mariage : absolue égalité des deux oui et des deux libertés de choix. Mais le pape François a reconnu encore récemment (2016) que « l’histoire porte les marques des excès des cultures patriarcales où la femme était considérée de seconde classe » 3, rappel tonitruant contre le machisme encore latent.
1 Même si elles n’y furent que 24 auditrices pour les deux sessions de 1964 et 1965.
2 L’entretien avec L. Scaraffia de B. Révillion, dans : Prier no 388, janvier-février 2017, p. 21.
3 Amoris Laetitia no 54.
Quelle égalité pratique ?
La Déclaration universelle des droits humains, et nous avec, reconnaissons aux deux sexes des droits égaux et inaliénables, « fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». D’où la difficulté grandissante de devoir s’accommoder dans l’Eglise de ce qui s’apparente à un traitement unfair de la femme. Oui, mouvements féministes catholiques, monographies sur les abbesses, diaconesses 4 et autres béguines, proclamation de Thérèse d’Avila ou Catherine de Sienne comme docteurs (doctoresses ?) de l’Eglise, commission d’étude du diaconat féminin voulue par le pape François ou théorie du genre ponctuent l’actualité, et des femmes sont nommées chancelière d’évêché, adjointe de vicaire épiscopal, rectrice d’instituts académiques et pontificaux, vice-porte-parole du Saint-Siège, directrice des Musées du Vatican. Mais à l’ère des cheffes du FMI, des fondées de pouvoir, des premières ministres et présidentes d’Etats, l’institution ecclésiale n’éluderait-elle pas le vrai sujet – la femme catholique en position de décision – à force de mettre en avant le concept de « rôles complémentaires », de magnifier la maternité, et à multiples reprises 5 de sublimer le génie féminin ?
4 A. Jajé, Diaconesses. Les femmes dans l’Eglise syriaque, Domuni Press, Paris, 2016.
5 En 1995 avec la Lettre aux femmes, en 2015 dans Evangelii gaudium (nn. 103-104).
Peut mieux faire !
« Un peu beaucoup d’encens pour moi », me confie une amie croyante pratiquante mais plus que désillusionnée sur le catholicisme : « Quand la seule réponse à l’ordination des femmes est un non possumus, aujourd’hui, au XXIe siècle, ce n’est plus tenable ni crédible. Il y a d’autres résistances inavouées ou inavouables à l’œuvre dans cet immobilisme obscurantiste. Comment des célibataires mâles peuvent-ils avoir une opinion éclairée sur la femme, l’amour, la famille, la sexualité ? » Le verdict est sévère, tout comme celui de Lucetta Scaraffia, historienne invitée au Synode sur la famille en 2015 : « L’approche (des prélats) souvent assez cérébrale […] m’a semblé coupée du réel. Je me suis dit que, décidément, il manquait une parole de femme dans cette assemblée d’hommes ! » 6 Rosetta Tomaselli-Carbonara, agente pastorale à la Missione cattolica Losanna-Renens, renchérit: « Le temps n’est pas encore venu d’un traitement égalitaire dans l’Eglise. Je ne me sens nullement reconnue ni pour mon travail ni pour mes paroles par l’institution, qui s’intéresse aux chiffres comme une usine de production, alors que j’appelle mon travail une vocation. Et je n’entre pas dans ce jeu-là. Ce qui m’intéresse et me gratifie, ce sont les personnes rencontrées sur ma route, leur sourire, leur regard, leur Grazie ! » Pas d’angélisme, même dans la vie religieuse féminine, nous assure sœur Claire, une cheffe d’entreprise (voir le livre qui lui est consacré 7) chez les Sœurs de Saint-Augustin à Saint-Maurice : « L’esprit de ma formation de religieuse n’était pas à l’émancipation mais au renoncement. » Même si elle reconnaît qu’avec le temps, l’atmosphère a changé.
6 L’entretien de Bertand Révillion, idem, p. 18.
7 O. Toublan, Religieuse et chef d’entreprise, Saint-Augustin, 2015.
Pas si mâle !
Myriam Stocker, membre du Conseil épiscopal du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, explique : « Il a fallu un certain temps pour que ma parole soit prise en compte », soit par les autres membres, tous hommes et majoritairement clercs. « Toutefois, au fil des séances et des sujets à traiter, (ils) ont commencé à respecter mes avis parfois bien différents des leurs, à apprécier que mes réflexions nous orientent vers d’autres points de vue lors de certaines décisions à prendre, à accepter que la femme que j’étais puisse apporter parfois un témoignage qui bouscule ! » Et de conclure : « L’idéal serait que nous y soyons plusieurs femmes : alors que nous y sommes plutôt nombreuses la plupart des décisions d’Eglise continuent à être prises sans les femmes. » Son ministère d’accompagnement d’équipes et de groupes de travail l’a mise en contact avec d’autres engagées avec lesquelles elle a créé un réseau pour toute consœur intéressée à les rejoindre !
Pia Zimmerli, secrétaire de catéchèse à Renens, raconte : « Je ne me suis jamais sentie mise à l’écart ni posé la question si j’avais vraiment ma place. Pour moi, c’était clair que oui. » Célébrant des funérailles depuis 2012, elle constate : « Etre femme, laïque et veuve dans ce genre de ministère nous donne plus de liberté pour montrer notre compassion. On est crédible en quelque sorte. » Même si porter une aube fait encore cligner les yeux d’aucuns. Un bémol cependant : « Comme j’aimerais que tous les prêtres disent hommes et femmes, et frères et sœurs dans la liturgie… »
Astrid Belperroud, coordinatrice en catéchèse pour l’Unité pastorale Renens-Bussigny, se sent « intimement convoquée, impliquée, appelée » en Eglise, « non pas d’abord en tant que femme, mais comme baptisée ». Tout comme Florence Delachaux, à la fois Marthe (secrétaire et seule membre femme du Conseil de paroisse) et Marie (catéchèse et funérailles), qui résume : « J’ai toujours eu à l’esprit la réalisation de ma mission indépendamment de mon sexe. » Certaines, même, très librement, comme Nicole Andreetta à l’AGORA de Genève : « Au moment de mon envoi, l’évêque m’a dit : « Tu devras obéir au Christ, pas à l’Eglise ! » Cela m’a rassurée en tant que femme et laïque et même pas mal libérée du carcan hiérarchique. Jésus n’a pas dit seulement « Faites ceci en mémoire de moi » ! Cherchons une autre partie de son héritage à vivre et
à transmettre. » Mission, ministère, vocation, l’Eglise est et sera toujours (au moins) un mot féminin. Et est bien plus déjà !
Quels engagements ?
Il y a, dans le fond comme pour les hommes – à une exception près : par l’ordination –, divers modes d’engagement pour la baptisée en Eglise : le plus répandu est le bénévolat, de la catéchèse à la solidarité, de la sacristie à l’autel, de Vie montante aux visites de malades ; la bénévole peut se former et s’instruire de façon plus poussée (AOT, Siloé, etc.), pour elle-même et pour son ministère ; puis il y a celles qui décident, après discernement en famille et avec les autorités compétentes, de se former sur plusieurs années (IFM…) pour être engagées sur mandat épiscopal comme agentes pastorales, au même titre qu’un prêtre quant au service rendu à une communauté.
Et il y a la consécration à vie, les religieuses (moniales, missionnaires, vierges…) qui sanctifient le corps tout entier en complément de l’indispensable apostolat au féminin.









 Marianne, maman de deux garçons, vous terminez votre parcours de formation à l᾿Atelier œcuménique de Théologie (AOT) ici à Genève. Vous êtes aussi catéchiste dans notre paroisse de Saint-Joseph. Quelle joie vous apporte cet engagement ?
Marianne, maman de deux garçons, vous terminez votre parcours de formation à l᾿Atelier œcuménique de Théologie (AOT) ici à Genève. Vous êtes aussi catéchiste dans notre paroisse de Saint-Joseph. Quelle joie vous apporte cet engagement ? Diana, maman de deux enfants, vous venez de terminer les procédures d᾿adoption de ces deux bouts de chou. Vous êtes aussi secrétaire dans notre paroisse de Sainte-Thérèse. Quelles joies vous apportent ces engagements ?
Diana, maman de deux enfants, vous venez de terminer les procédures d᾿adoption de ces deux bouts de chou. Vous êtes aussi secrétaire dans notre paroisse de Sainte-Thérèse. Quelles joies vous apportent ces engagements ? Maristane, maman de deux grands enfants, vous avez accompli votre première année de catéchiste à Sainte-Thérèse. Quelles sont les joies que vous ont apportées ces nombreuses années de participation aux activités de l᾿Eglise genevoise ?
Maristane, maman de deux grands enfants, vous avez accompli votre première année de catéchiste à Sainte-Thérèse. Quelles sont les joies que vous ont apportées ces nombreuses années de participation aux activités de l᾿Eglise genevoise ?



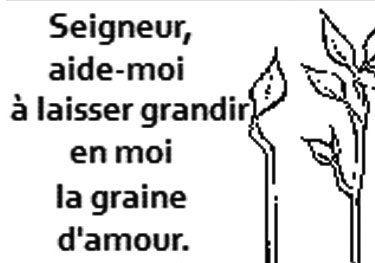
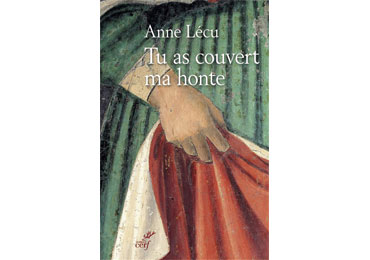
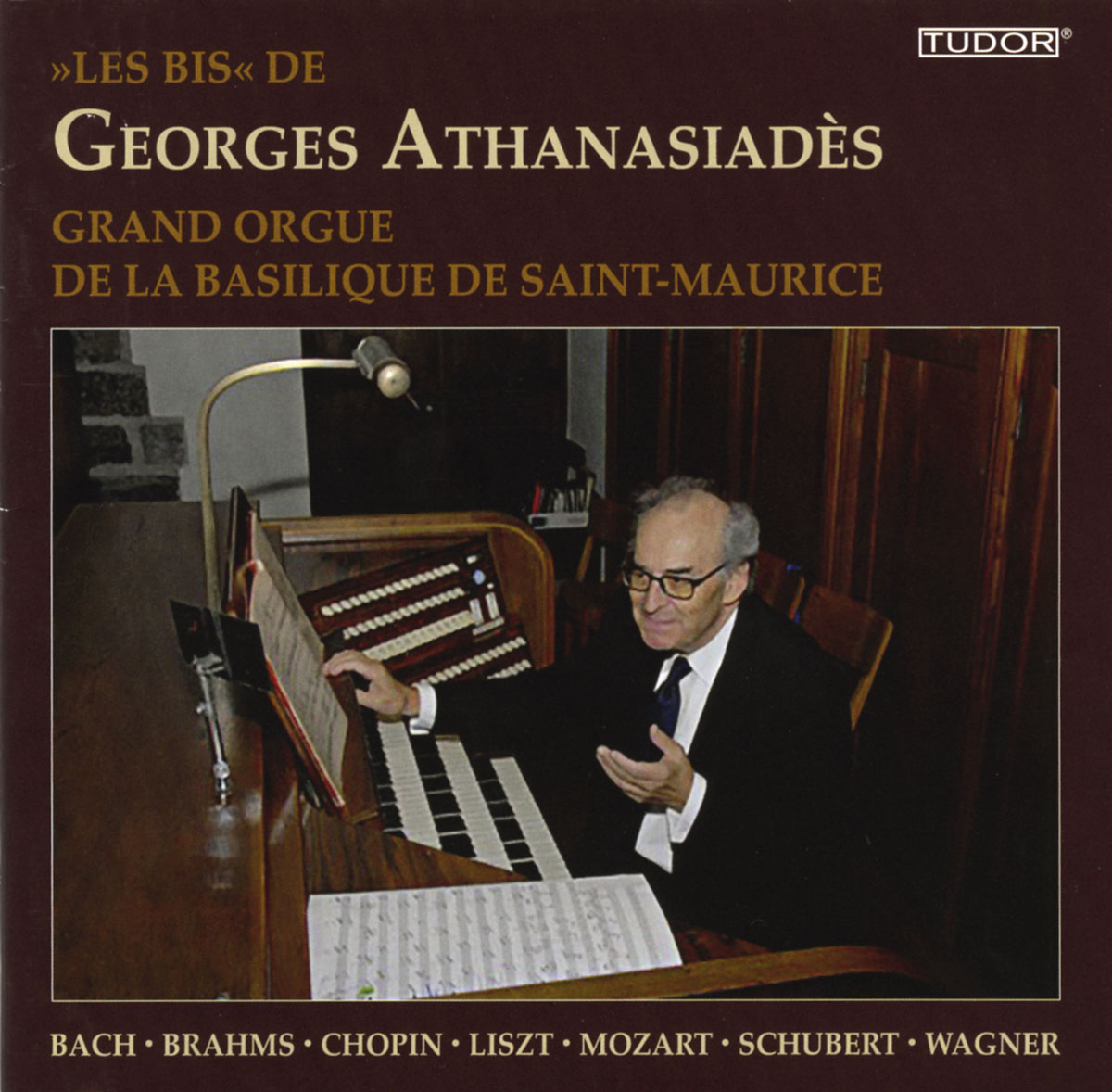 « Les bis » de Georges Athanasiadès
« Les bis » de Georges Athanasiadès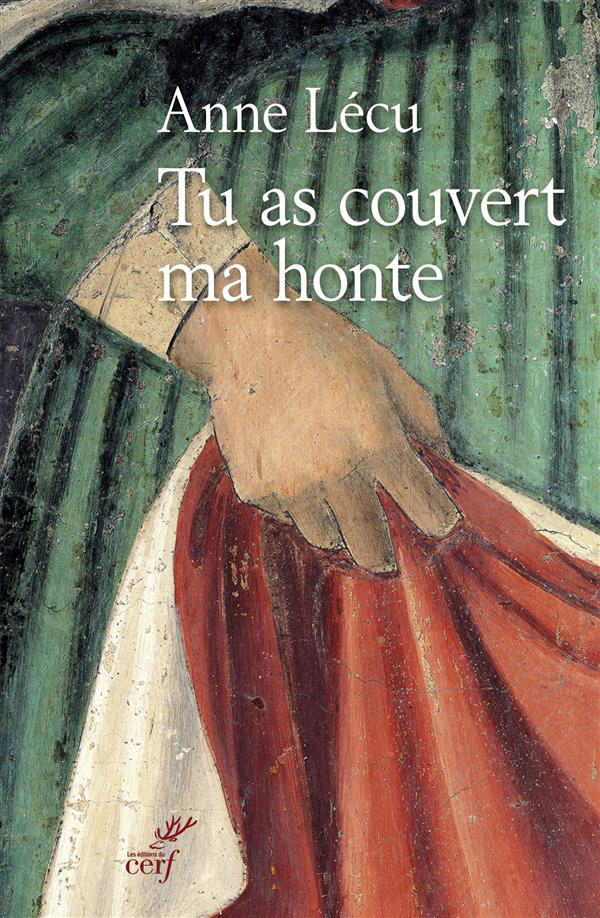
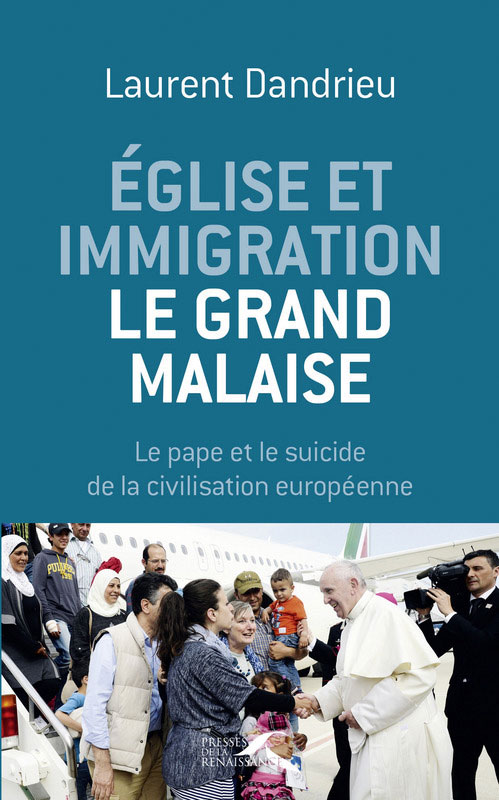
 « La prière dans tous ses états »
« La prière dans tous ses états »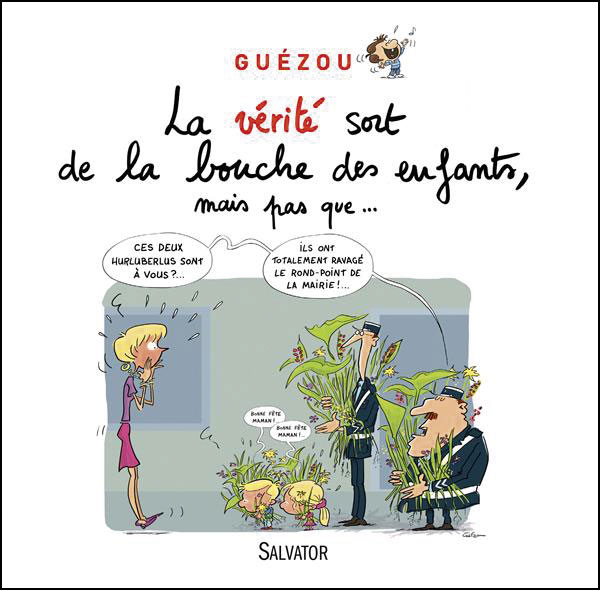


 Oecumenica est un label de qualité national attribué pour distinguer et mettre en évidence des projets par rapport à l’œcuménisme. Il met aussi en évidence les lignes directrices de la Charta œcumenica3 signée par les principales Eglises de Suisse. Le label encourage enfin les Eglises à poursuivre le chemin de l’unité, car malgré les différences issues des traditions, des actions communes sont possibles !
Oecumenica est un label de qualité national attribué pour distinguer et mettre en évidence des projets par rapport à l’œcuménisme. Il met aussi en évidence les lignes directrices de la Charta œcumenica3 signée par les principales Eglises de Suisse. Le label encourage enfin les Eglises à poursuivre le chemin de l’unité, car malgré les différences issues des traditions, des actions communes sont possibles !



 Un homme : bien que qu’il soit silencieux, le personnage de Joseph est mentionné à dix-neuf reprises dans l’Evangile. Il ne parle pas, mais il agit, il fait ce que l’ange lui prescrit. En effet « ce premier il fit devient le commencement du chemin de Joseph »1. C’est un homme, dans toute sa masculinité, issu de la lignée de David (cf Lc 3, 23-38 ; Mt 1, 1-17). Si nous pensons au texte de la Genèse, Dieu a créé l’homme et la femme, c’est-à-dire qu’il y a une différence sexuelle. Jean-Paul II a écrit « l’homme (adam) créé du limon du sol est défini comme homme (is = mâle) seulement après la création de la première femme »2. Cela signifie que Adam a besoin du vis-à-vis d’Eve pour pouvoir se définir comme un homme masculin. De même Joseph a besoin de Marie pour être un homme viril.
Un homme : bien que qu’il soit silencieux, le personnage de Joseph est mentionné à dix-neuf reprises dans l’Evangile. Il ne parle pas, mais il agit, il fait ce que l’ange lui prescrit. En effet « ce premier il fit devient le commencement du chemin de Joseph »1. C’est un homme, dans toute sa masculinité, issu de la lignée de David (cf Lc 3, 23-38 ; Mt 1, 1-17). Si nous pensons au texte de la Genèse, Dieu a créé l’homme et la femme, c’est-à-dire qu’il y a une différence sexuelle. Jean-Paul II a écrit « l’homme (adam) créé du limon du sol est défini comme homme (is = mâle) seulement après la création de la première femme »2. Cela signifie que Adam a besoin du vis-à-vis d’Eve pour pouvoir se définir comme un homme masculin. De même Joseph a besoin de Marie pour être un homme viril.

