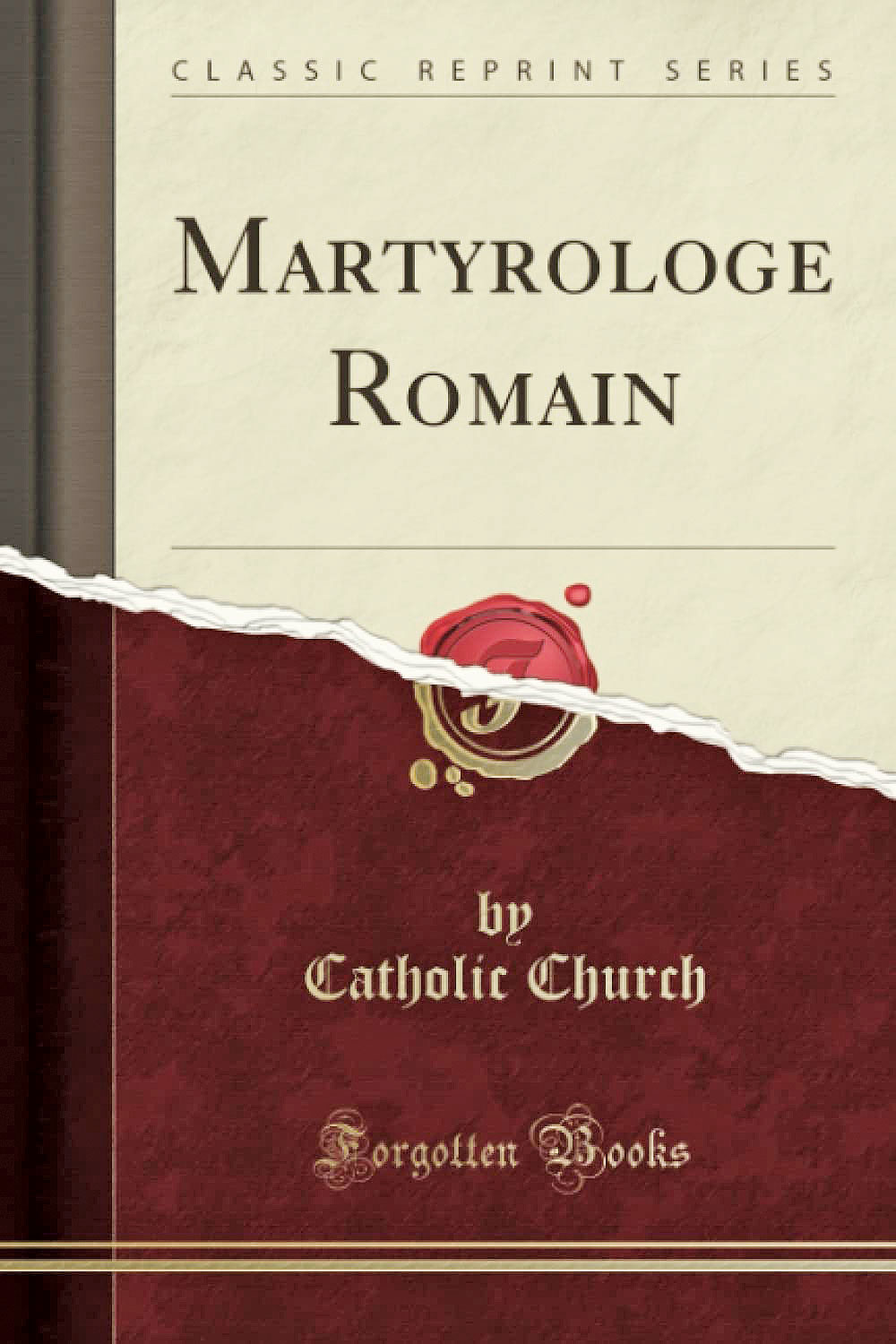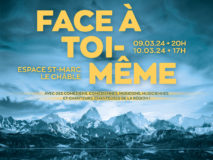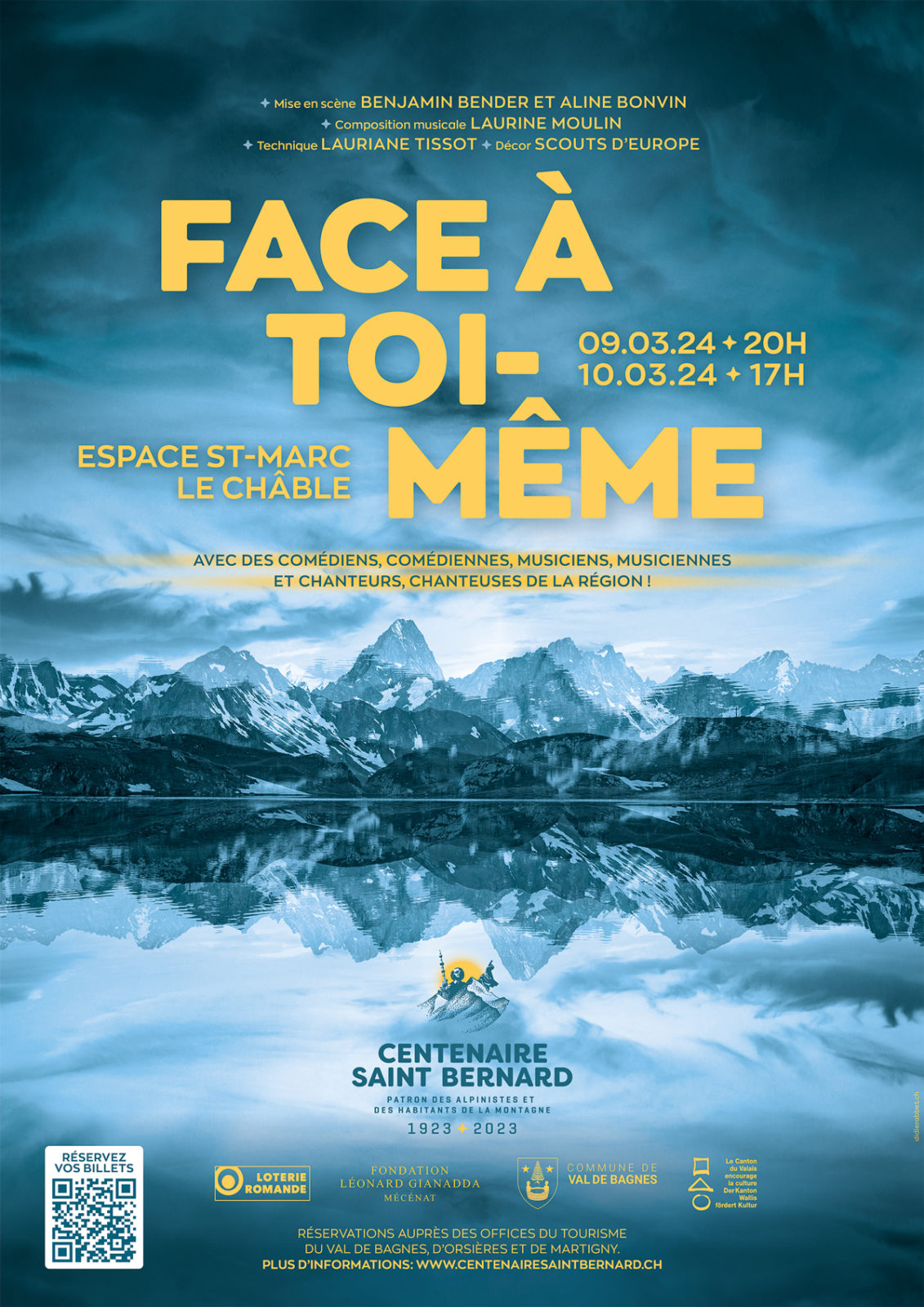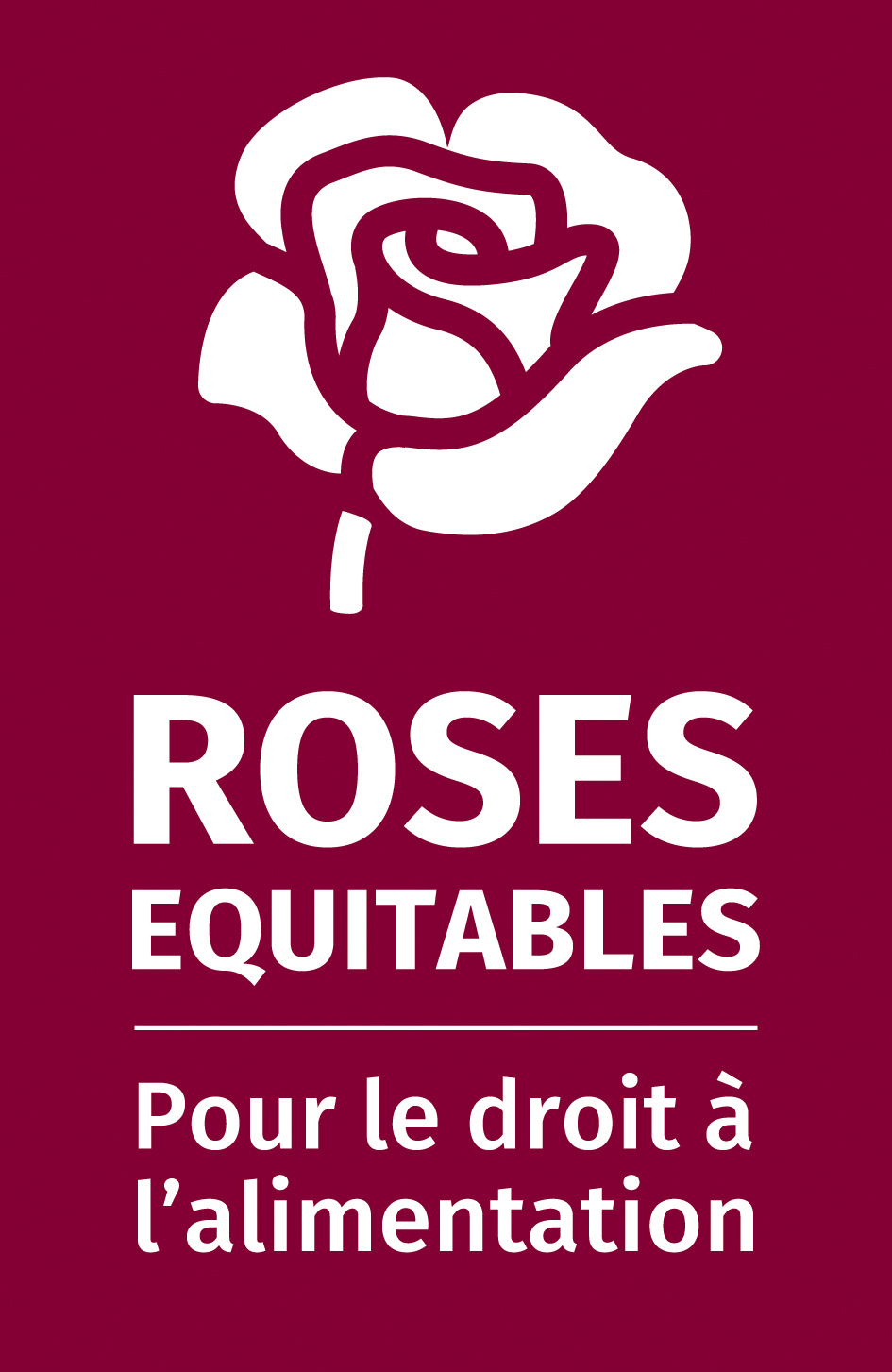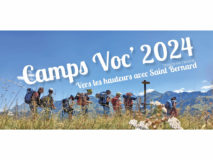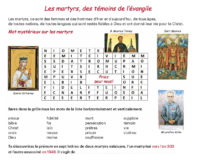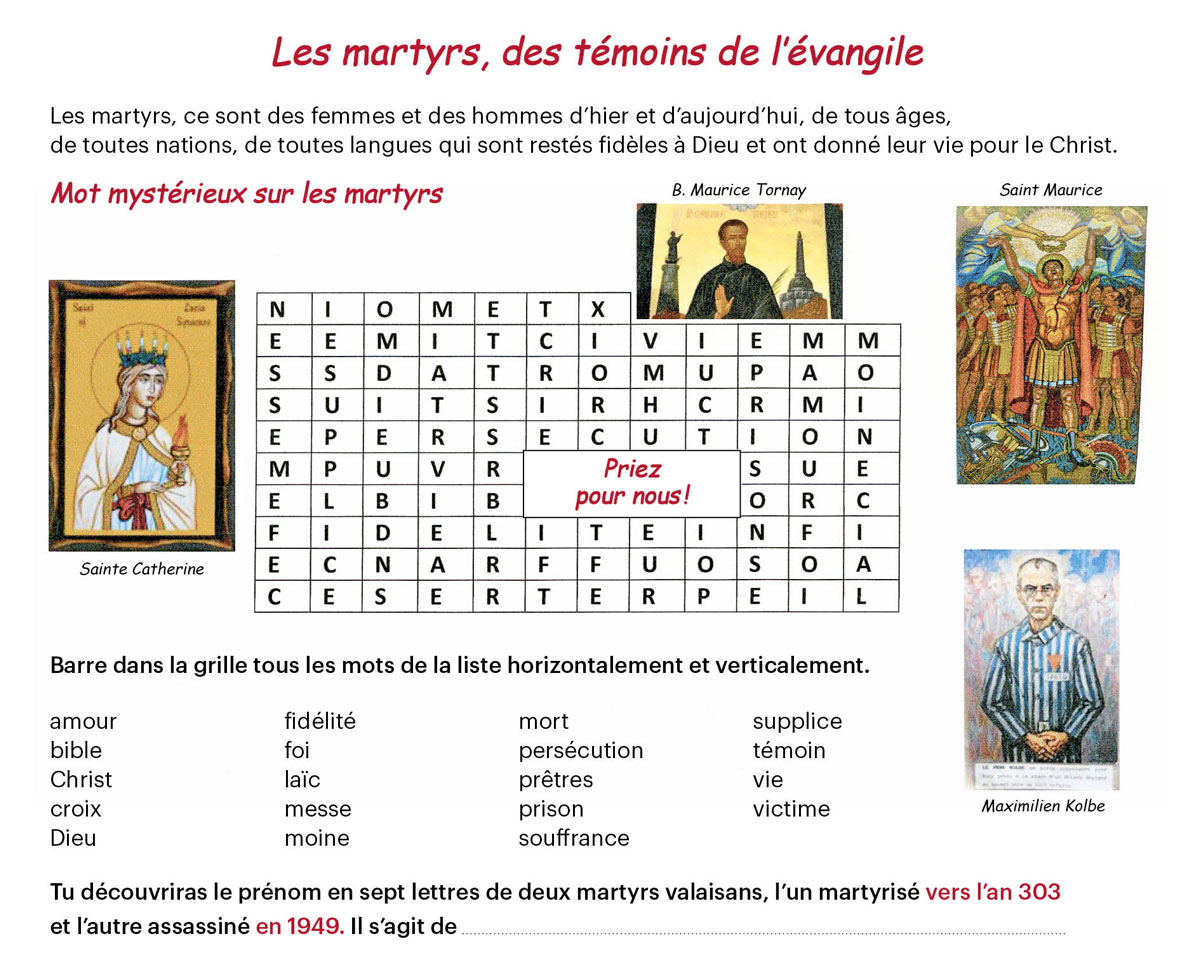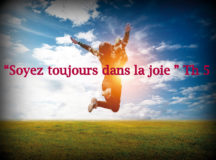L’invitation de Dieu pour chacun de ses enfants, est d’être un signe qui indique le chemin, comme les disciples de Jésus l’ont été pour la génération de leur temps.
Par Olivier Taramarcaz | Photos : DR
Lors d’un périple de 90 jours sur les hauts-plateaux de Norvège, je me suis retrouvé un jour devant un rare poteau indicateur. Un point crucial. Là, je devais trouver des précisions pour continuer mon chemin. Les panneaux avaient tous été arrachés. Le poteau n’indiquait dès lors aucune direction. Ce jour-là, j’ai été interpellé par ce passage de la Bible : « Ils ont établi pour signes leurs signes, pour emblèmes leurs emblèmes. Nous ne voyons plus nos signes. » (Ps 74, 4) Comme chrétien marchant dans les pas de Jésus, qu’est-ce que ma vie indique comme direction ? Quel signe je suis pour les autres ? Au début de ma vie chrétienne, plusieurs ouvrages m’ont nourri, devenant des bornes, des poteaux indicateurs, reflétant l’amour de Dieu répandu comme un parfum.
Les paroles que tu m’as données – « Les paroles que tu m’as données » 1 d’Odette de Benoît (1899-1953), fondatrice de l’Institut Emmaüs, a été une profonde source d’ancrage spirituel. En plongeant dans cet ouvrage, j’ai été bouleversé, comme traversé par la présence de Dieu. Je me suis senti invité à passer des devantures à l’aventure de la vie. Il recueille des notes consignées dans des carnets, reflétant sa vie d’intimité avec son Seigneur. Le titre est tiré d’un passage de la Bible : « Les paroles que tu m’as données » (Jn 17, 8), suivi de cette note en frontispice : « Non pas celles que l’on obtient à force d’étude, d’attention, de réflexion, mais les paroles que tu donnes, qui jaillissent au fond de l’âme, qui sont esprit et vie et désaltèrent vraiment. » Ces petites notes discrètes, écrites au quotidien, comme des semences de vie, ont germé dans mon cœur. J’ai commencé alors à tenir un journal personnel, que j’aborde davantage sous la forme d’un carnet poétique, mettant en mots les pas de ma vie avec Christ.
Porter la vie comme un parfum – « Le Sadhou Sundar Singh. Un témoin du Christ» 2 m’accompagne depuis mon adolescence. Ce récit raconte la transformation du jeune indien sikh, visité par Jésus-Christ. Il engage alors sa vie à partager l’Evangile en Inde, dans l’Himalaya, au Tibet. Il a exprimé cette pensée : « Il faut beaucoup de temps, en botanique, pour étudier la structure d’une fleur et ses divers organes, mais il ne faut qu’un instant pour en sentir l’odeur » (1944, 88). La vie du Sadhou Sundar Singh (1889-1929) a été un puissant encouragement à laisser respirer le parfum de la présence de Dieu, répandu dans mon cœur, soit à le partager : « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. » (2 Co 2, 14-15) La vie qui vient de Dieu se reçoit comme une semence dans la terre, comme de l’eau qui désaltère, comme un courant d’air frais qui change l’air ambiant.
Etre une source pour d’autres – J’ai compris, par ces deux témoignages, que Dieu m’appelle aussi à vivre mon histoire dans un cœur à cœur avec Lui. En prolongement de ces lectures, un texte retient mon attention : « Vous êtes manifestés comme une lettre de Christ. » (2 Co 3, 3) Cette lettre n’est pas destinée à rester scellée, à l’image du poteau indicateur, en Norvège, qui n’indiquait rien. L’apôtre Paul écrit : « Il a mis en nous la parole de réconciliation. » (2 Co 5, 19) A l’instar d’Odette de Benoît et du Sadhou Sundar Singh, chacun de nous est appelé à se tourner vers le Messie, à mettre en pratique la Parole, à partager la Bonne Nouvelle de la réconciliation, à « être une source pour d’autres » (Jn 4, 14).
Bibliographie
1 Odette de Benoît, Les paroles que tu m’as données, Emmaüs, Vennes-sur-Lausanne, 1956.
2 Alice van Berchem, le Sadhou Sundar Singh. Un témoin du Christ, Emmaüs, [1944], Emmaüs, St-Légier, 2013.