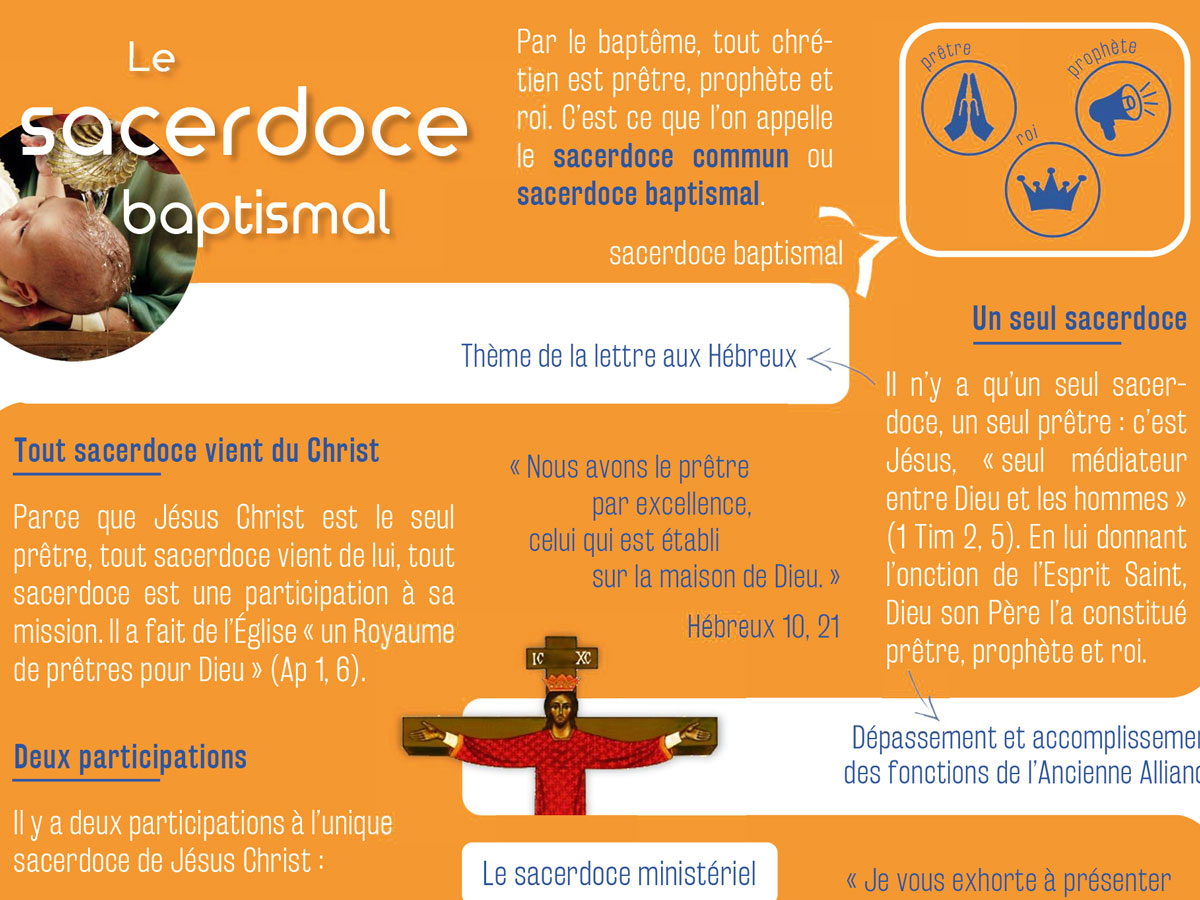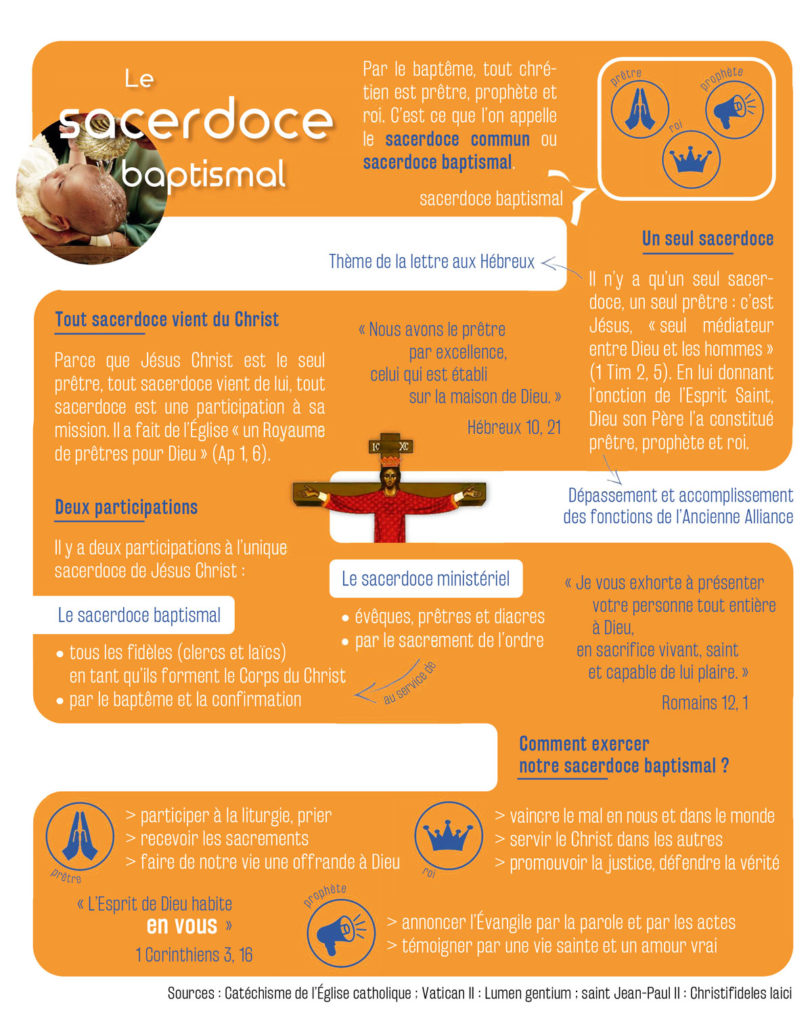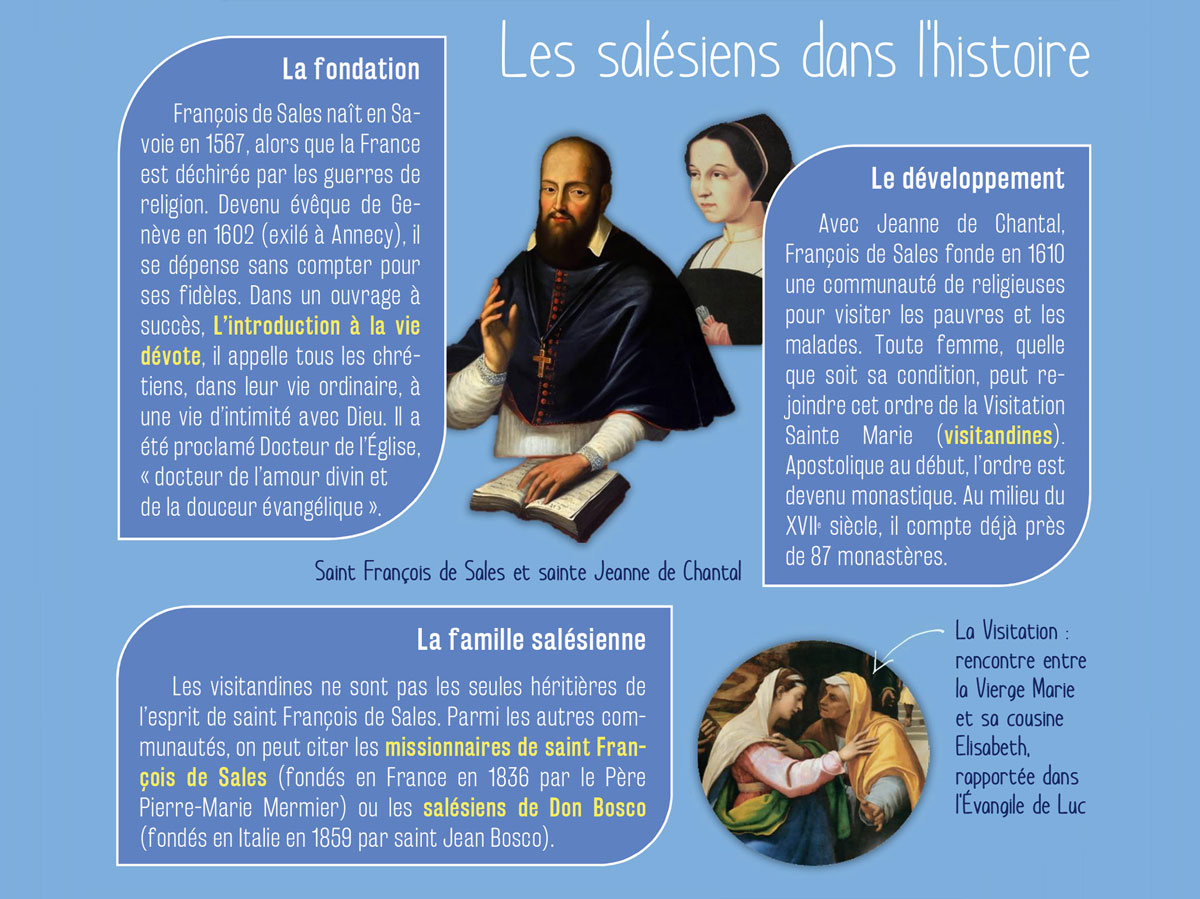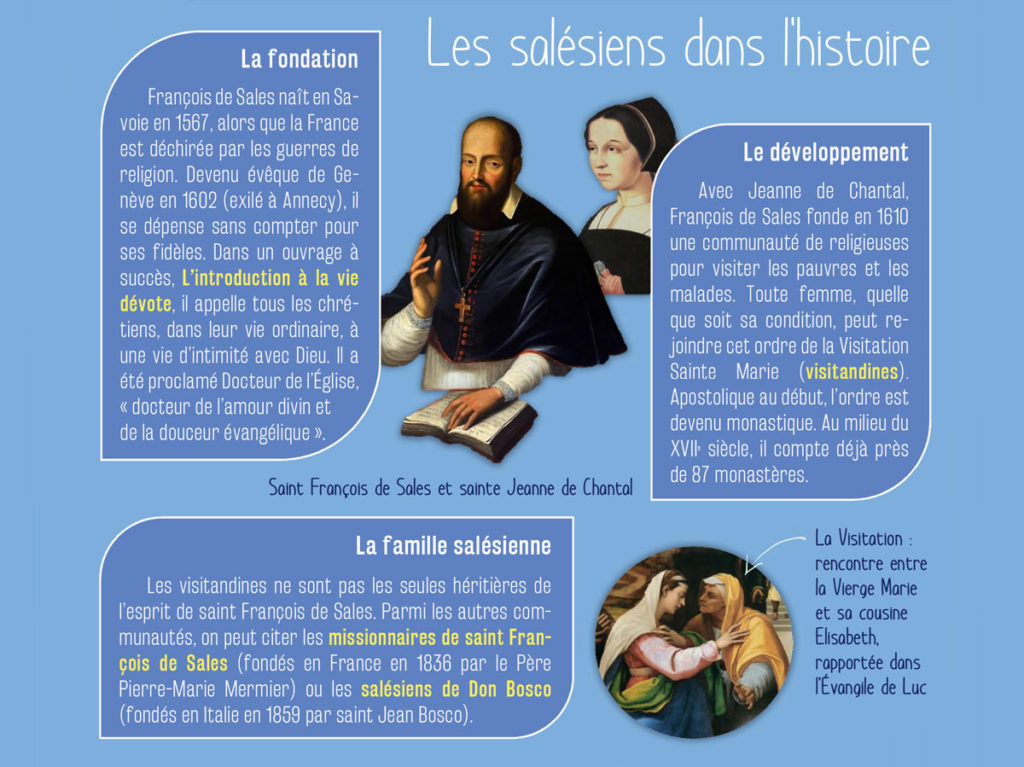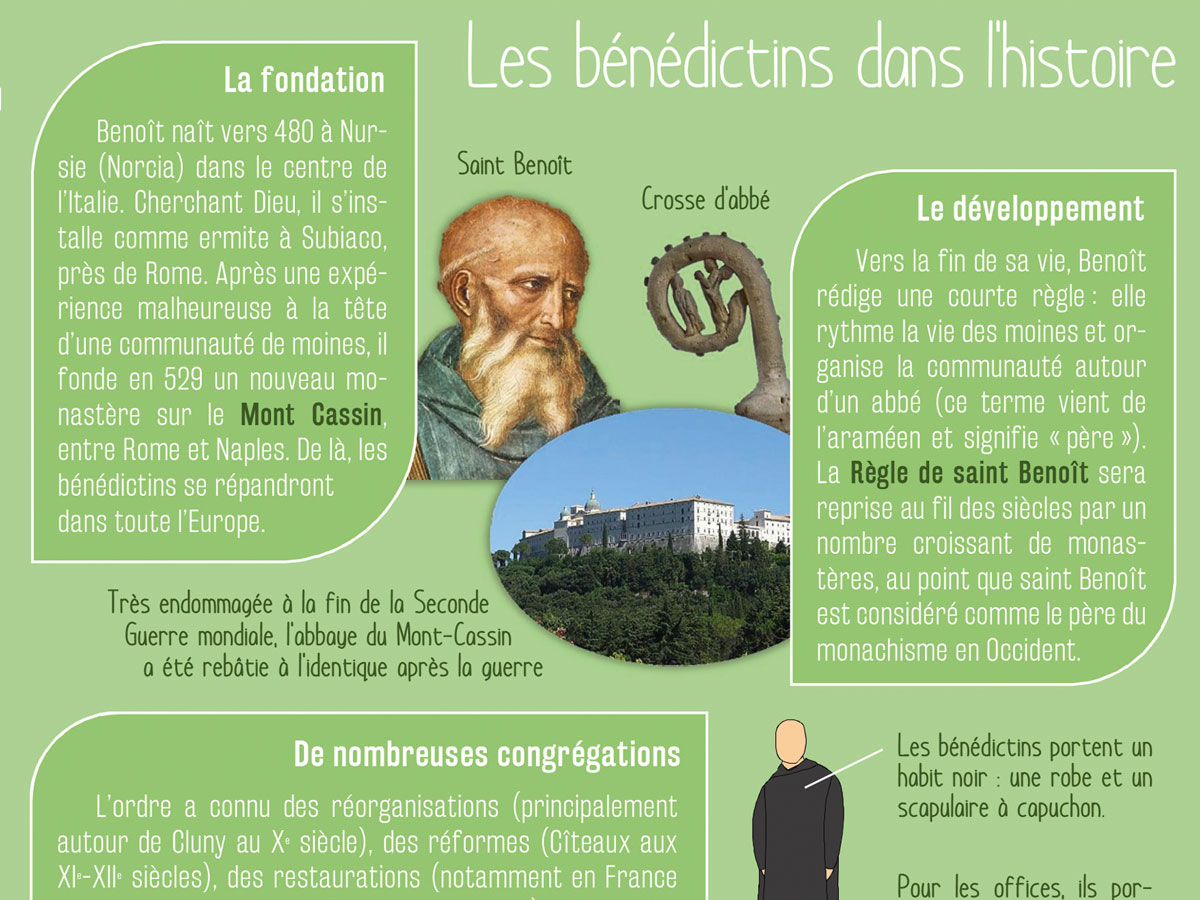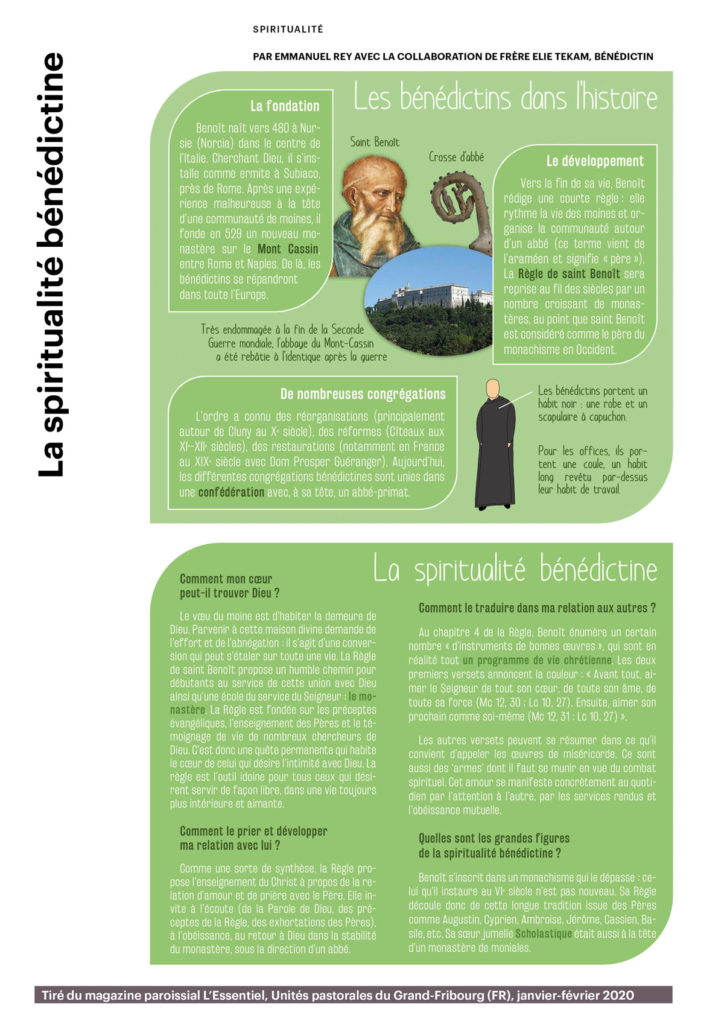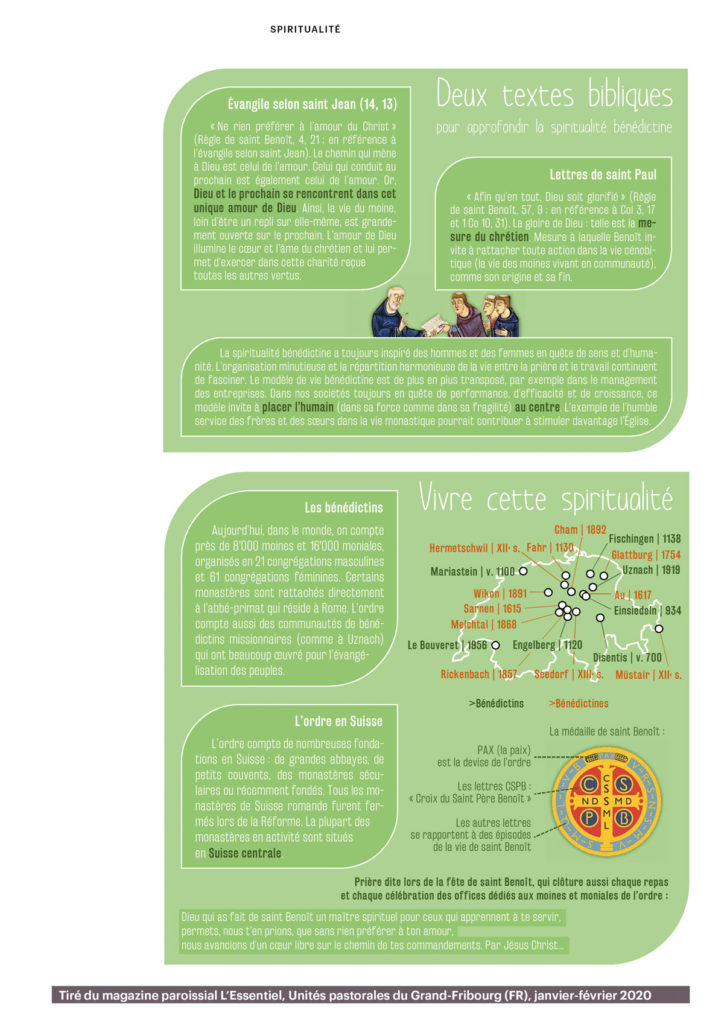Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, Unités pastorales du Grand-Fribourg (FR), juillet-août 2020
Par Véronique Benz | Photo: DR
Durant ce temps de crise sanitaire, pour suivre les recommandations du Conseil fédéral, les messes ont été supprimées et les activités pastorales annulées. Alors comment l’Église a-t-elle été présente auprès des personnes qui en avaient besoin durant ce temps de confinement ?Tout comme les autres institutions, l’Accueil Ste Elisabeth a dû fermer ses portes à la mi-mars. « Les instructions du Conseil fédéral ont entravé notre mission directe d’accueil et de soutien », relève Olivier Messer, responsable de l’Accueil Ste Elisabeth. Cependant, dès le 21 mars, une hotline a été mise en place sur le décanat de Fribourg. Plusieurs personnes se sont relayées pour répondre aux appels. Du 21 mars au 24 mai, près de 160 personnes ont appelé la hotline. Les demandes reçues étaient très variées.Il y avait les demandes liées aux sacrements (baptême, mariage, onction des malades, funérailles), les demandes de contact avec un prêtre ou pour recevoir la communion, les demandes pratiques liées à la situation de crise, notamment des demandes d’aide pour les courses.
Certaines personnes ont appelé la hotline simplement pour parler et parer à la solitude. Il y a eu également de nombreuses demandes d’aide matérielle et financière.
Toutes les demandes de la hotline étaient relayées auprès de personnes référentes dans les unités pastorales et les paroisses. La majorité des demandes étaient traitées par les Conférences Saint-Vincent-de-Paul. Des bénévoles étaient également à disposition pour faire les courses.
« Cette crise a révélé des besoins et des situations que nous ne soupçonnions pas », souligne Olivier Messer. Le responsable de l’Accueil Ste Elisabeth cite les « working poor », ces personnes qui s’en sortent tout juste financièrement avec leur revenu. Le moindre souci, la perte du job d’appoint, un pourcentage de travail réduit… et elles se retrouvent dans les difficultés financières. Pour Olivier Messer cette crise sanitaire doit nous inviter à repenser notre offre de solidarité.
Unir ses forces
Il faut reconnaître que cette crise a eu des aspects positifs. Les prêtres, les agents pastoraux, les catéchistes se sont mobilisés. Ils ont fait preuve d’une grande créativité pour essayer de rejoindre chaque paroissien. Les deux unités pastorales ont uni leurs forces et proposé des projets communs notamment la hotline et le « Bulletin hebdo des paroisses » de Fribourg envoyé par mail. Plusieurs personnes estiment que des offres, mises en place durant ce temps de crise, qui devraient être maintenues, par exemple faire les courses pour les personnes âgées ou isolées.
Les Conférences Saint-Vincent-de-Paul
La situation du coronavirus ne semble pas avoir engendré pour l’instant davantage de demandes auprès de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul. « à part un couple dont les deux travaillaient dans le domaine de la restauration, nous n’avons pas eu de demande liée spécifiquement à la situation sanitaire », relève Francesco Foletti, président de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul du Christ-Roi.
« Les demandes d’aide que nous recevons nous arrivent à travers l’Accueil Ste Elisabeth. Pour chaque personne à aider, Olivier Messer prépare un dossier présentant la situation et l’aide financière demandée », explique Daniela Favre, économe de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul du Christ-Roi.
« Les Conférences Saint-Vincent-de-Paul ont pour but d’offrir des aides ponctuelles », précise Francesco Foletti. « Nous orientons souvent la personne vers d’autres instances sociales, mais nous sommes parfois le dernier recours possible, lorsque les instances sociales n’entrent pas en matière. »
Les deux membres de la Conférence soulignent que la plupart des personnes qui sont aidées financièrement sont également accompagnées par l’un des membres de la Conférence. Derrière la précarité financière se cache souvent une pauvreté humaine. « Pouvoir offrir de son temps est quelque chose d’inestimable », estime Daniela Favre. Un des rôles de la Conférence est ce soutien humain que n’offrent peut-être pas les instances sociales.
Mon Dieu, qu’est-ce qui nous arrive ?
Et toutes ces angoisses ! Et toutes ces questions ?
Mais nous croyons que tu es toujours là,
Seigneur, avec nous quoiqu’il arrive,
comme un Père prend soin de ses enfants.
Nous pouvons nous abandonner en toute confiance
dans les bras de ton amour.
Donne-nous la grâce de garder au cœur
la certitude de ta tendresse, en particulier
à l’égard de celles et ceux qui sont les plus éprouvés
dans leur corps et dans leur âme.
Accorde-nous de demeurer reconnaissants
pour toutes les personnes qui luttent
contre le mal sans ménager leurs forces.
Évite-nous la tentation du repli sur soi,
alors que tant de personnes ont besoin
de notre solidarité par des paroles et
des gestes d’amitié au jour le jour.
Que la prise de conscience de nos fragilités humaines,
au lieu de nous conduire dans la tristesse
et la désespérance, nous rapproche de toi
par la méditation de ta Parole et par la prière.
Dans nos épreuves rayonne déjà la lumière pascale.
Claude Ducarroz
Être solidaires
Mgr Charles Morerod nous appelle à exercer concrètement la solidarité auprès des personnes tombées en précarité. Nous récoltons des denrées non périssables et produits d’hygiène aux endroits suivants :
– l’église Saint-Paul au Schoenberg (de 7h30 à 12h) ;
– l’église du Christ-Roi (de 7h à 18h) ;
– la chapelle de Villars-Vert (tous les jeudis de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30).
La marchandise est redistribuée en collaboration avec REPER et les Cartons du Cœur.
Si vous désirez faire un don financier : Banque cantonale de Fribourg, 1701 Fribourg
CCP 17 – 49 3, IBAN : CH 090076830013631720 2
Toute personne qui a besoin d’aide peut contacter l’Accueil Ste Elisabeth : accueil.ste.elisabeth@bluewin.ch, 026 321 20 90.