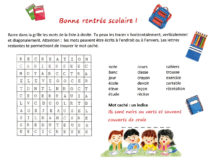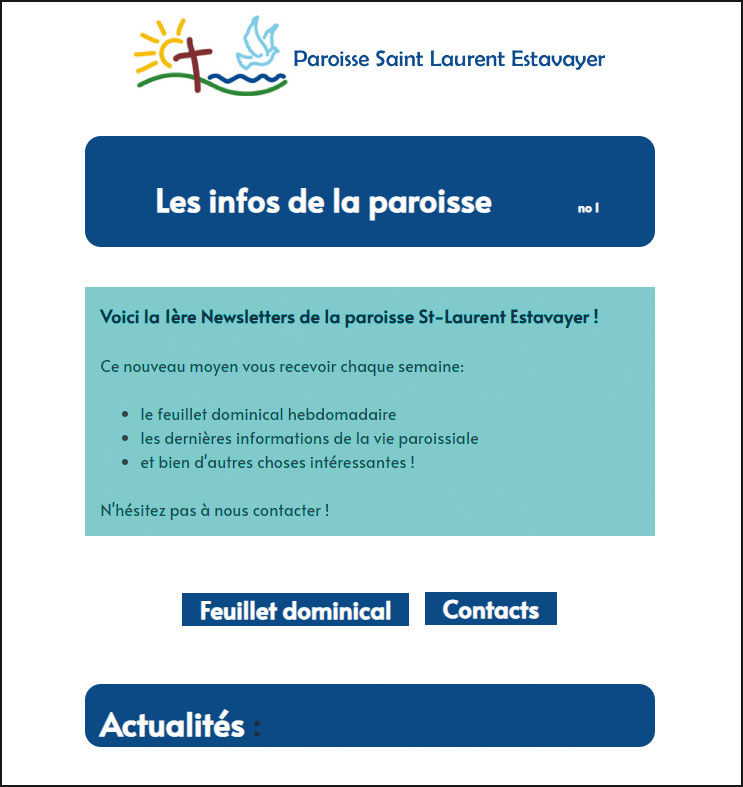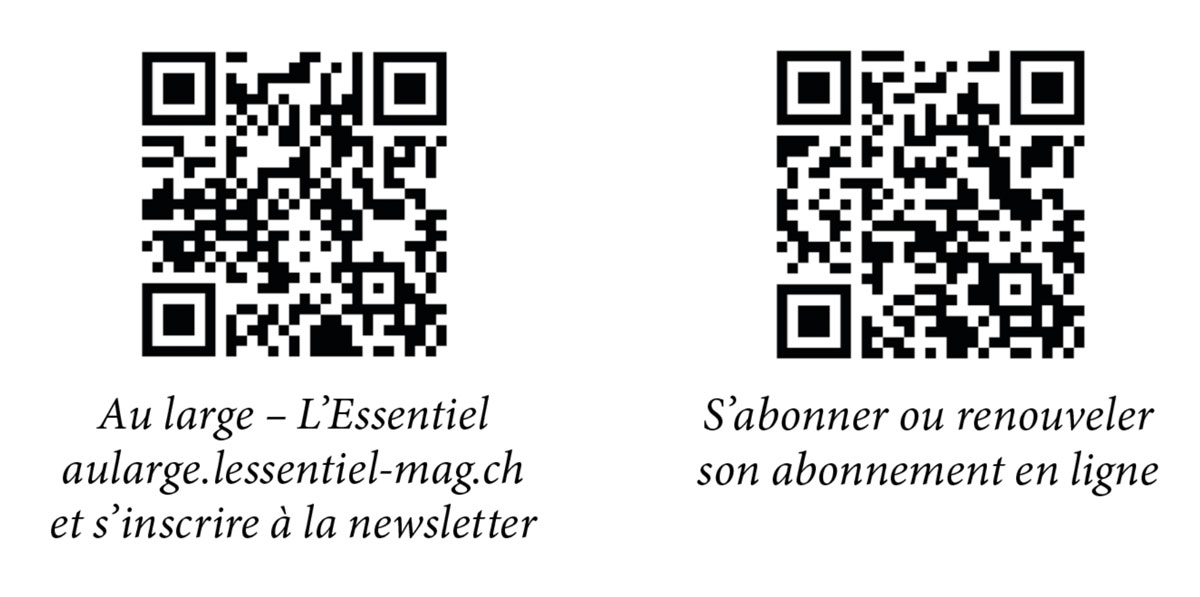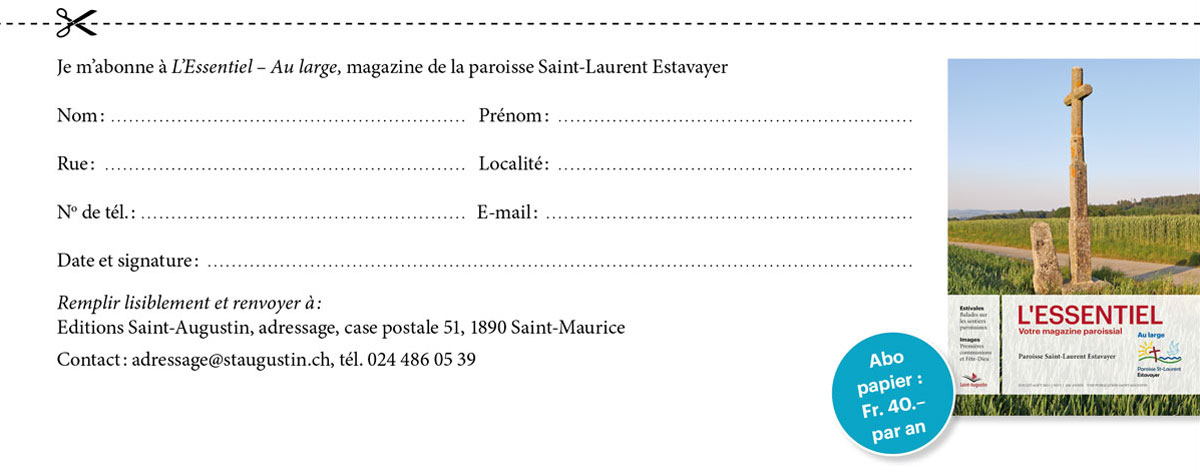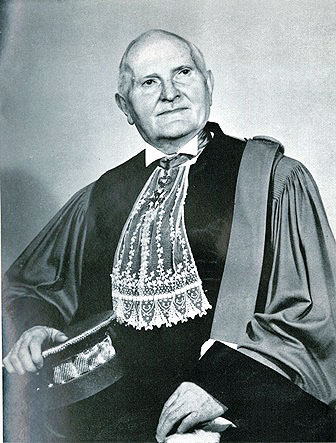Nous annonçons des merveilles

Par l’abbé Darius Kapinski, curé-modérateur
Celui qui est à l’origine de tout, m’a donné la vie. A moi de découvrir son sens et de goûter à sa saveur… de l’apprécier et m’en réjouir. Le Créateur fait de moi son collaborateur, son partenaire…
Par son Fils Jésus, le Christ, je reçois une dignité plus grande encore : désormais, celui par qui tout existe, cet Absolu, permet que je l’appelle « Père » ; il fait de moi son enfant, m’offrant plus qu’une aventure terrestre. Jésus, qui a donné sa vie pour moi et qui a vaincu la mort, m’assure d’une vie pour toujours. Quelle merveille ! Et quelle magnifique mission de la proclamer !
L’Eglise – la communauté fondée par le Christ – est chargée depuis des siècles de proclamer les merveilles de Dieu, de sa création et des humains, ses enfants. Par le baptême, je suis plongé dans la Vie de Dieu et je suis envoyé pour dire… pour crier, ou pour murmurer… à temps et à contretemps : « L’homme, tu vaux plus que tu penses ! »
C’est superbe d’être une communauté pour vivre ensemble des mêmes grâces : célébrer le Seigneur de tout, se donner pour les autres ou encore annoncer les merveilles…
Aujourd’hui, nous présentons la vie de notre grande paroisse, en te souhaitant, chère lectrice / cher lecteur de te sentir accueilli et chez toi. Engage-toi pour proclamer les merveilles, et tu deviendras encore plus joyeux !
Les dons sont variés… les services sont variés… les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous.
S’engager pour la communauté

Par Alexandre Duc, président du Conseil de paroisse
Les cinq premières années de la nouvelle paroisse Saint-Laurent Estavayer se sont écoulées, cinq années de présidence durant lesquelles beaucoup d’éléments, d’informations ont été regroupés et naturellement des décisions à prendre.
Mes motivations à être conseiller de paroisse ou… comment j’en suis arrivé là ? Un peu par hasard et beaucoup de désirs de faire quelque chose pour ma communauté. C’est suite aux Céciliennes organisées à Lully, où je faisais partie du comité d’organisation, que Benoit Pillonel, président de paroisse de Lully, m’a approché pour me demander de siéger au conseil et prendre sa place de président. D’un côté, la joie et l’honneur que l’on ait pensé à moi et, de l’autre, je ne le cache pas, l’inquiétude de l’inconnu.
La flamme pour s’investir
Mais finalement, au fil des années et des rencontres, on s’aperçoit que toutes les personnes qui œuvrent pour notre paroisse ont le même but, « le bien-être de la communauté, l’entretien et la mise en valeur de nos bâtiments, que les Fêtes soient belles, réussies, porteuses de joie et de satisfaction ». Je ne peux que remercier les paroissiens de la confiance qu’ils portent au Conseil de paroisse.
Je rajouterais que les défis de la préparation de la fusion de nos 12 anciennes paroisses fut également une grande motivation pour continuer. La mise en place de la nouvelle Paroisse Saint-Laurent Estavayer représenta également un gros challenge vu les attentes de nos communautés. Il y a encore du travail. et c’est ça qui me fait garder la flamme de l’investissement pour la communauté.
Des visites appréciées des personnes seules

Par Christiane Pochon, visiteuse à domicile
Il y a environ 20 ans, le prêtre de notre paroisse m’a proposé d’exercer le service d’auxiliaire de la communion. D’abord étonnée par cette demande, je me suis engagée avec conviction.
Après une journée de formation, j’ai contacté quelques personnes seules pour leur proposer une visite afin de leur offrir le sacrement de l’eucharistie. Quelle joie pour ces gens qui n’avaient plus la possibilité d’assister à la messe !
Partager ce temps d’amitié est très important. Pour moi, ces moments sont très enrichissants. Toutes ces personnes sont maintenant décédées et je regrette de ne plus continuer ce mandat pour le moment. Je reste toujours à disposition pour de nouvelles demandes.
Le Conseil de paroisse me sollicite également pour visiter les ainés de notre communauté qui résident dans les homes ou à leur domicile. Pour ces paroissiens, c’est essentiel de maintenir le contact avec les habitants de nos villages. J’ai aussi beaucoup de plaisir et de satisfaction à passer un moment avec eux.
Un sacristain de 15 ans ou… quand l’engagement n’attend pas !

Portrait de Mikel-Ange Sancho, sacristain à Seiry
L’image d’un sacristain est souvent celle d’un monsieur âgé et bedonnant. Mais détrompez-vous, chez nous ce n’est plus le cas depuis longtemps ! La preuve : plusieurs jeunes sacristains sont actifs dans nos communautés. Et à Seiry, Mikel-Ange œuvre depuis le début de l’année et du haut de ses 15 ans, il est certainement un des plus jeunes sacristains du canton !
Il a commencé son engagement à l’église comme servant de messe vers l’âge de 8 ans, sur recommandation de son papa. Mais il participait déjà à la messe auparavant avec sa famille.
Cet automne, de nouveaux jeunes servants sont venus renforcer la cohorte de Seiry. C’est ainsi qu’il répond à l’appel de Julien Messer de prendre le relais comme sacristain. Et Mikel-Ange accepte volontiers cette nouvelle mission ! Pour lui, ça ne change pas grand-chose, si ce n’est qu’il découvre la messe sous un autre angle.
Comme sacristain, il se rend avant tout le monde à l’église pour préparer le matériel nécessaire pour le prêtre ainsi que les micros. Il accueille, conseille les servants et veille sur eux pour que tout se passe bien durant l’office.
Malgré un peu de stress, il trouve beaucoup de satisfaction dans cette nouvelle fonction.
Faire que l’Eglise soit là quand il faut !

Par Gery Stuart, membre du Conseil de communauté de Cheyres
Je viens de… Whitefield, Manchester. La messe avait lieu chaque dimanche d’abord dans une salle, puis à l’église Saint-Michael ; mes parents étaient les membres fondateurs de cette communauté. Je suis arrivée à Cheyres en 2017 après plusieurs autres lieux de résidence et ai découvert que je vivais à 2 minutes de la belle église Saint-Nicolas. Etant catholique pratiquante, il n’a jamais été aussi facile pour moi d’assister à la messe et de fréquenter la communauté paroissiale.
Je suis maintenant à la retraite et j’ai du temps à redonner à l’Eglise qui m’a soutenue tout au long de ma vie.
Je me suis sentie honorée d’avoir l’opportunité de rejoindre le Conseil de communauté et de pouvoir faire ce que je peux, selon mes moyens – car le français n’est pas ma langue maternelle – pour aider et développer notre communauté de Cheyres.
Nous vivons dans un monde très matérialiste, mais je veux que l’Eglise soit là quand les gens ont des besoins.
Voilà le motif de mon engagement paroissial.
Ensemble pour faire grandir l’esprit de fraternité

Par Rachel Jeanmonod, animatrice pastorale et membre de l’équipe pastorale
En tant que membre de l’équipe pastorale, je fais partie du groupe de personnes qui se partagent la charge pastorale. Cette équipe est mandatée par l’évêque pour coordonner et animer la pastorale. Sa mission consiste à permettre aux différentes communautés chrétiennes locales de vivre et de célébrer leur foi. Dans notre paroisse, elle est composée de deux prêtres et de cinq agents pastoraux laïcs.
Ensemble, nous cherchons à faire grandir l’esprit de fraternité au sein des communautés et veillons à préserver l’unité. Nous accompagnons les différents conseils de communauté afin que ceux-ci puissent, à leur tour, susciter et accompagner l’engagement d’autres fidèles. Nous sommes tous envoyés pour une même mission : celle de faire fructifier l’annonce de l’Evangile, la prière et la célébration, la solidarité et l’œcuménisme.
Une source de joie
Pour moi, le travail en équipe est source de joie. J’apprécie énormément les relations fraternelles et amicales qui nous lient les uns aux autres. A l’image de toute la communauté, chaque équipe est riche des différents charismes des personnes qui la composent. Ainsi chacun de ses membres, comme l’ensemble des baptisés, peut apporter sa pierre à l’édifice afin de témoigner ensemble de la vie du Christ et de rayonner de son Amour.
« Etre membre d’un groupe de l’Evangile à la maison me fait du bien »

Par Nadia Buffat, membre du groupe de Vuissens
Notre groupe de lecture de l’Evangile à la maison est composé de huit personnes qui, comme moi, avons vécu notre baptême ou notre confirmation il y a quelques années. Nous nous réunissons environ tous les mois. J’avais déjà vécu une première expérience dans un autre groupe il y a quelques années. Quand on m’a demandé de rejoindre celui-ci, j’ai hésité, car je ne connaissais pas les gens. Mais j’ai osé faire le pas et je ne le regrette pas du tout !
Ce qui m’attire, c’est le fait de nous retrouver entre personnes croyantes souhaitant échanger et partager sur notre foi. ça fait du bien d’être entre frères et sœurs en Christ ! On ne peut pas forcément partager ce genre de choses avec notre entourage.
Ce qui est génial avec la Bible, c’est qu’on peut toujours faire un lien avec notre vécu du moment et qu’on revient toujours à l’essentiel.
Et de plus, ces temps d’échanges et de partages se font toujours dans la bonne humeur !
Les chœurs d’Eglise : une belle découverte

Par Marion Pagin, directrice du chœur mixte d’Aumont-Nuvilly
La musique fait partie de ma vie depuis mon enfance et j’ai su très vite que j’en ferai mon métier. J’ai d’abord étudié la flûte traversière et le piano au conservatoire d’Orléans (France) d’où je suis originaire ; puis le chant classique, en parallèle de mes études de musicologie à l’université de Tours.
C’est à l’université que j’ai découvert avec enthousiasme la direction de chœur. Après un passage par le conservatoire de Lyon, je suis arrivée en Suisse en septembre 2014 pour y poursuivre mes études de chant lyrique et obtenir ainsi un master d’interprétation concert en 2019. Depuis, je chante comme soliste et choriste au sein de chœurs professionnels ou renfort au sein de chœurs amateurs.
Ah, le beau répertoire fribourgeois !
Sans oublier bien sûr les chœurs d’église que j’ai grand plaisir à diriger. En France je ne connaissais que les chœurs profanes, et cela a été une belle découverte et un nouvel apprentissage de travailler avec des chœurs paroissiaux. Quelle joie également de découvrir la tradition chorale fribourgeoise et son magnifique répertoire !
Je me réjouis déjà de retrouver, après la pause estivale, les paroisses d’Aumont-Nuvilly ainsi que mes chers choristes, tout autant sympathiques qu’excellents chanteurs, pour les nouvelles aventures qui nous attendent, à commencer par les Céciliennes en novembre. Et, bien sûr, pour l’animation des messes, que nous avons toujours à cœur de chanter avec enthousiasme pour magnifier la célébration et accompagner les fidèles tout au long de la liturgie.
« J’ai le sentiment de semer des petites graines »

Par Mélanie Hutter, catéchiste
Je m’appelle Mélanie Hutter, j’ai 37 ans. Avec mon mari, nous avons trois enfants âgés de 4, 10 et 13 ans. La paroisse Saint-Laurent a toujours fait partie de ma vie depuis ma petite enfance grâce à l’engagement de mes parents et aujourd’hui grâce à ma propre mission de catéchiste auprès des enfants des classes staviacoises de 3H et 4H. Je vais entamer ma 8e année de catéchèse après avoir commencé lorsque mon aînée était en 3H.
On dit que les parents sont les premiers éducateurs de la foi de leurs enfants. Pour moi, pouvoir combiner ce rôle d’éducatrice et de catéchiste a été un déclic. C’est une joie de rencontrer ces enfants semaine après semaine et de vivre un moment de partage et de prière avec eux. J’ai le sentiment de semer de petites graines dans leur cœur. Peut-être que celles-ci ne germeront pas tout de suite, peut-être même jamais – cela ne nous appartient pas – mais elles sont là ! Et un jour, qui sait, ces enfants auront envie d’en prendre soin. Ils sauront alors qu’ils ont un compagnon de vie inconditionnel avec qui ils peuvent partager les bons moments comme les moins bons…
Un appel aux jeunes à s’engager

Par Colette Tettamanti, présidente du Conseil de communauté d’Estavayer-le-Lac
C’est depuis mars 2004 que je suis au service de notre communauté, et ceci jusqu’à la fin 2017 comme conseillère paroissiale et depuis le 1er janvier 2018 en qualité de présidente du Conseil de communauté d’Estavayer-le-Lac.
Lorsque j’ai accepté ces mandats, je ne me rendais pas compte du travail que cela impliquait et du temps que cela me prendrait. Toutefois, j’ai eu beaucoup de plaisir à accomplir, en premier lieu, la fonction de conseillère qui m’a fait découvrir la vie paroissiale.
De multiples et riches contacts
Les contacts ont été très enrichissants tant avec les prêtres et toutes les personnes qui s’impliquent dans la vie paroissiale qu’avec les maîtres d’état impliqués dans l’entretien de la Collégiale Saint-Laurent. J’ai beaucoup appris en collaborant avec le service culturel, le conservateur d’art, les tailleurs de pierre et les différents corps de métier, les contacts ont toujours été très cordiaux. A cela s’ajoutaient l’organisation des apéritifs, la mise sur pied de certaines fêtes, telles que la Fête-Dieu, la Saint-Laurent, en collaboration avec les sacristains et les personnes impliquées dans l’événement.
Depuis le 1er janvier 2018, la présidence du Conseil de communauté est également très prenante et je peux compter sur mes collègues qui collaborent avec une grande efficacité dans l’organisation des différents événements religieux et qui font le lien entre les personnes engagées et la paroisse.
Mon souci est la relève et j’encourage les jeunes à se mettre au service de nos communautés, qui sont, il faut le dire, vieillissantes. Ayons confiance en l’avenir.
« Etre active dans notre Conseil de communauté est un enrichissement »

Par Bernadette Joye-Losey, membre du Conseil de communauté du secteur Est de la paroisse
Je suis engagée depuis longtemps dans la paroisse de Bussy d’abord comme caissière et concierge de l’église. « Après la fusion des paroisses, j’ai commencé à être active dans le Conseil de communauté du secteur Est de la nouvelle paroisse.
La vie de la paroisse m’est très chère. D’ailleurs j’aime être au service des paroissiens et faire le lien avec la grande paroisse. Mon engagement découle de ma foi reçue durant mon enfance. Je me rends compte que chaque petit rôle a son importance pour la vie de la communauté locale. Donner de mon temps pour les paroissiens me donne beaucoup de joie. Cela me permet d’être en contact avec les personnes et de créer des amitiés.
Dans les rencontres du conseil, je me sens concernée pour préparer les cérémonies spéciales du secteur. J’ai du plaisir à travailler ensemble car il y a une bonne ambiance. Je ne peux qu’encourager les personnes à oser s’engager pour dynamiser encore plus la paroisse. Durant le Covid, nous avons été très sollicités (traçage et désinfection). Je me suis rendu compte de l’importance du lien avec ma famille et les autres. C’est un enrichissement réciproque ! Croire m’aide pour la vie de tous les jours et plus intensément lors de moments difficiles.
Une présence chrétienne auprès des résidents en EMS

Par Régine Giacomotti-Mafunu, aumônière
En tant qu’aumônière, je suis formée et envoyée par l’Eglise catholique au sein d’institutions médicalisées pour être une présence chrétienne avec une dimension spirituelle et pastorale. Depuis 2010, j’assure cet accompagnement auprès de personnes âgées dans les 4 EMS de la Broye fribourgeoise.
Il s’agit, en effet, d’une présence humaine précédée par la présence divine. Cet accompagnement consiste à prendre en compte les détresses et les ressources spirituelles des résidents tout en respectant leurs convictions confessionnelles respectives. Cette prise en charge comprend principalement une écoute tant active qu’attentive des questions spirituelles et existentielles pour mieux les soutenir au quotidien.
A part cet accompagnement spécialisé et personnalisé, je participe aux activités liturgiques et essaie, selon la volonté des familles, de répondre aux éventuelles demandes religieuses en organisant des célébrations adaptées. La dimension essentielle de mon travail est d’assumer une présence pastorale au service des aînés fragilisés afin de leur apporter réconfort et espérance.
Un engagement aux multiples facettes

Par Laura Pochon, présidente du Conseil de communauté du secteur sud
Voici quelques lignes pour me présenter. Je m’appelle Laura Pochon, j’habite à Montet. Je suis mariée à Michael Pochon et nous avons trois enfants de 14, 9 et 5 ans. J’ai 37 ans et je travaille à l’accueil extrascolaire à Aumont pour la commune de Les Montets.
Au sein de notre Unité pastorale Saint-Laurent, je m’occupe de différentes tâches. Il y a 5 ans, j’ai commencé à transmettre ma foi à travers la catéchèse aux enfants de 3 et 4e harmos à Nuvilly dans le cercle scolaire de Les Montets-Nuvilly. Par la suite, j’ai accepté la mission de la présidence du conseil de ma communauté. Il m’est confié d’animer les conseils, de m’occuper des servants de messe avec Mme Reggiani-La Faci, de sonner les cloches lors des décès à l’église de Montet mais également d’assister aux conseils pastoraux de notre paroisse.
Tout cela m’apporte énormément dans ma vie au quotidien. Le partage, l’amitié, donner du temps au service des gens, rassembler les paroissiens de ma communauté mais aussi « semer la parole de Dieu » aux enfants du caté toutes les semaines, tous ces échanges sont pour moi de grands moments de réconfort proche du Seigneur pour vivre ma foi.
Nous avons besoin de l’engagement de tous !

Par l’abbé Bernard Alassani, prêtre de la paroisse
Il est souvent difficile de décrire ses sentiments ou de les exprimer parce que c’est quelque chose d’inexplicable et ils changent au jour le jour. Alors à chaque fois que quelqu’un me demande comment tu vas ? Ou comment ça va dans la paroisse ? Je réponds toujours ça va et ça va très bien, spécialement en été parce que le soleil vient illuminer encore plus nos activités et notre vie.
Cette réponse n’est pas pour cacher ni le stress, ni la solitude ou les difficultés mais elle traduit mon ressenti de tous les jours ; ce que je vis chaque jour. La joie de rencontrer du monde avant et après les célébrations, la joie de donner du caté et de faire le parcours de confirmation, la joie de vivre mon ministère dans la paroisse. Cette joie, j’essaie de la communiquer dans mon vécu de chaque jour, ce qui n’est pas facile tout le temps.
Voici bientôt quatre ans que je suis dans la paroisse, nous avons cette lourde responsabilité d’être porteurs de joie et d’espérance pour le peuple de Dieu surtout dans ces périodes post Covid ; les conflits qui sont à nos portes et les situations difficiles et de précarité de certaines familles. Il faut le reconnaître qu’en nombre réduit dans le ministère sacerdotal, la charge devient de plus en plus grande et nous avons énormément besoin de l’implication de tous les chrétiens baptisés, de tous les paroissiens dans toutes les communautés et surtout des agents pastoraux laïcs pour nous soutenir dans notre mission. Merci à vous, précieux agents pastoraux ! Aujourd’hui plus que jamais, l’Eglise a besoin de tous les baptisés, notre paroisse a besoin de tous les paroissiens et de toutes les paroissiennes pour l’annonce de la Bonne Nouvelle et faire vivre la paroisse tout entière. Merci de vous engager !
Le secrétariat paroissial : un centre névralgique !

Par Claudia Moret, secrétaire paroissiale
Travaillant au secrétariat paroissial depuis janvier 2022, j’ai la chance de travailler en binôme avec Marie-Christine Mota, qui me montre toutes les finalités d’un secrétariat paroissial. Je lui succéderai le 1er janvier prochain.
Travailler en paroisse n’est pas une nouveauté car je suis déjà engagée en tant que paroissienne dans mon village de Ménières. J’ai été au Conseil de communauté pendant une dizaine d’années et je suis actuellement catéchiste et lectrice.
Un travail en accord avec ma foi
Le secrétariat est le centre névralgique de la paroisse. Nous recueillons toutes les informations, tant administratives que pastorales. Nous faisons le lien entre les prêtres, le Conseil de paroisse, l’équipe pastorale et les communautés. C’est un travail très intéressant et très diversifié. Les tâches sont multiples, comme la rédaction du feuillet dominical, la gestion des honoraires de messe, ou encore la prise de PV du Conseil de paroisse. Bien sûr, l’accueil téléphonique ou à la porte de la cure est des plus importants.
Pour conclure, je peux dire qu’avoir un travail administratif dans un milieu en accord avec ma foi est le job idéal.
« Je prends ma fonction de lecteur très à cœur »

Par Lucien Roulin, lecteur
Je suis lecteur à Forel depuis de nombreuses années. Mes parents m’ont transmis la foi. Nous allions souvent à la messe et j’ai été servant de messe. Pour moi, ce n’était pas une obligation et j’y allais déjà volontiers. Depuis je suis un fervent croyant. Maintenant je sens le besoin d’y participer car je sais que ça me fait du bien de déposer ce qui me pèse dans les mains de Dieu.
Pour supporter toutes les difficultés de la vie, ma foi m’aide beaucoup. C’est comme une présence invisible à mes côtés. Lorsqu’il y a la messe à Forel, je sens un appel à participer. D’ailleurs je suis toujours attentif aux cloches, car c’est moi qui les règle. Ce qui me plaît aussi ce sont le contact avec les paroissiens et les discussions après la messe sur le parvis de l’église.
Lorsqu’on m’a demandé de lire, j’ai accepté avec joie car il y avait peu d’hommes qui lisaient. Je prends cette fonction très à cœur en préparant déjà à la maison. Je cherche le texte sur internet et je vérifie s’il y a des mots difficiles à dire. Ensuite, je peux le lire à la messe avec le cœur. Le 15 août, le secteur Est se retrouve à Notre Dame des Flots. J’ai plaisir à préparer l’endroit avec soin afin que le décor invite à prier. Pour bien finir ma journée, je récite une dizaine de chapelets avant de m’endormir.
Mon combat pour plus de justice sociale

Par Marianne Losey, active en diaconie
Marianne Losey, paroissienne d’Estavayer-le-Lac par mon baptême. Mariée, deux enfants et quatre petits-enfants. Depuis longtemps, tout ce qui touche à l’injustice et au non-respect des droits humains me préoccupe.
C’est pourquoi je me suis engagée dans l’Action chrétienne pour un monde sans torture ni peine de mort (ACAT). En écrivant des lettres adressées aux gouvernements pour demander la libération de prisonniers politiques ou le droit à un procès équitable, je contribue à soutenir ces personnes, souvent condamnées lors de jugements arbitraires.
Pour plus de justice sociale, je participe comme membre de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul à améliorer la situation des personnes en détresses morales et financières. Ce service caritatif vient en aide à toute personne dans le besoin, sans distinction de religion, d’idéologie, d’origine ethnique ou de classe sociale.
Parce que je crois que la solidarité et l’attention envers les plus démunis portent des fruits et répondent à l’invitation du pape François d’aller vers les périphéries, je continue à m’investir.
« Mon engagement a fait grandir ma foi »

Par Thomas Mota, servant de messe à la collégiale
Je m’appelle Thomas Mota et j’ai 16 ans. A 8 ans, en voyant les servants œuvrer dans la collégiale, j’ai eu envie de les rejoindre. Je me sentais croyant mais je n’aimais pas particulièrement assister aux offices et je me suis dit qu’intégrer le service de messe pouvait être une bonne manière de devenir actif et motivé à y participer.
Je me suis tout de suite senti bien au sein du groupe et m’y suis fait des amis avec qui je pouvais partager ma foi. J’ai évolué et grandi. En entrant au CO, j’ai été qualifié de « grand » servant, et suis devenu cérémoniaire, ce qui m’a rendu très fier. Gérer les enfants plus jeunes durant les messes est un rôle que j’apprécie beaucoup. Lors d’une récente rencontre, Cédric Chanez a proposé de créer un groupe de responsables. Je me suis porté volontaire avec grand plaisir, accompagné de mon cousin, de ma cousine et d’autres grands servants.
Tout ce parcours et ces engagements m’ont fait grandir dans ma foi et m’apportent beaucoup dans le partage avec les autres. Outre l’aspect religieux, ce sont aussi des amis avec qui je vis de superbes moments de détentes et de rires, et tout cela dans l’amour de Dieu.
« Je prie pour que la musique adoucisse aussi les cœurs »

Par Dominique Rosset, organiste à Cheyres
Il y a d’abord mes parents chanteurs – dans des chœurs, lors des trajets en voiture, autour de la table familiale… et également à l’église puisque mon père était un bienveillant et rayonnant pasteur vaudois !
Accompagner les chants du chœur paroissial tient donc à la fois de l’évidence, de l’atavisme familial et du plaisir. C’est une forme de partage et de soutien aux émotions et aux sentiments de celles et ceux qui donnent ainsi de leur temps et de leur voix.
Directrice durant plusieurs années du Chœur des Petits Bouchons, je poursuis – à ma manière – mon chemin de vie traversé de musiques.
Je respecte profondément la foi des êtres. Quelle qu’elle soit. Et, lorsque les homélies de certains prêtres me font hausser les sourcils (ou, pire, dresser les cheveux sur la tête), je regarde les membres du chœur et Jacques, leur directeur. Je souris. C’est pour eux que je joue, pour l’assemblée réunie, et pour le Dieu d’humour, d’ouverture et d’amour auquel je crois…
On dit que la musique adoucit les mœurs. Je prie pour qu’elle adoucisse également les cœurs.
« Fleurir en liturgie, c’est ma façon de remercier Dieu »

Par Lidia Broye, fleuriste
C’est en 2014 que je me suis engagée à fleurir l’église de Nuvilly. Puis plus tard celle de Lully. Car c’est si naturel de fleurir notre maison ou de mettre un bouquet sur la table de fête.
Les fleurs sont de l’ordre de la gratuité et de l’éphémère. Elles disent le don gratuit que Dieu nous fait de sa création. En étant vivant, on est mortel, et Jésus a pris ce chemin. La fragilité de la fleur me dit cela. Elle nous parle de la création, de la vie… mais aussi de la mort.
Bien plus qu’un pansement aux maux de la vie, avec la création florale j’adopte une philosophie de partage. Si belle aujourd’hui, fanée demain… Arranger, assembler des fleurs, des branches, c’est donner une partie de soi.
Fleurir en liturgie, c’est pour moi une façon de remercier Dieu pour la vie. C’est une joie à chaque bouquet, à chaque composition ! J’y prends beaucoup de plaisir !
Le rôle discret mais précieux du concierge

Portrait de Sébastien Bongard
Lorsque l’on rentre dans une église ou une chapelle et qu’elle est bien entretenue, nous ne pensons pas forcément au temps passé par le ou la concierge pour son entretien. A Murist, Sébastien Bongard occupe le poste de concierge de l’église depuis une dizaine d’années. Au départ, c’était juste un petit job à côté. Mais petit à petit, Sébastien s’est investi dans son travail et éprouve de la satisfaction quand les fidèles lui disent que l’église est propre.
Mais pour rendre ce lieu de prière accueillant, il lui faut de l’huile de coude pour passer l’aspirateur, récurer, enlever la poussière, les toiles d’araignées et les mouches. Mais aussi pour entretenir l’extérieur : balayer, ramasser les feuilles mortes en automne, déneiger les marches ou saler l’hiver. Vous l’avez peut-être même aperçu durant les beaux jours d’été à genoux au milieu du parvis en train d’arracher les mauvaises herbes !
En plus de tout ça, Sébastien s’investit depuis plusieurs années au sein du Conseil de communauté de Murist, donnant des coups de main pour la préparation des fêtes et des apéritifs.
Discret, il n’en reste pas moins que lui et ses collègues concierges sont des personnes précieuses pour le bien de nos communautés !
Un accompagnement épanouissant

Par Antonella Reggiani-La Faci, aumônière aux CO de Cugy et Estavayer
Je suis aumônière dans les CO de Cugy et d’Estavayer. J’ai trouvé la foi grâce à l’accueil sans jugement que j’ai eu par mon prêtre et par mon professeur de religion. Ils m’ont montré le vrai visage de Dieu. Cette expérience m’a permis de comprendre l’amour de Dieu. Après avoir pris conscience de l’infini amour de Dieu, j’avais besoin de partager ma foi. Alors je me suis engagée dans l’Eglise, d’abord dans la catéchèse.
C’est surtout l’accueil inconditionnel, donné en exemple par Jésus, que j’ai à cœur de transmettre. Cette première expérience dans la paroisse m’a permis de rencontrer l’innocence des petits enfants, ce qui m’a donné plein d’énergie. Toutes les personnes que Jésus met sur mon chemin, je les accueille comme si c’étaient mes enfants.
Fidèle à un fil rouge
Je travaille à l’aumônerie des CO de notre paroisse en duo avec mes homologues réformées : Lara Martin-Rosenow à Estavayer et Anne-Christine Wild à Cugy. Lorsque j’ai des difficultés soit dans la catéchèse soit à l’aumônerie, je repense à ce qui m’a amenée à la foi. Mon fil rouge, c’est de persévérer pour faire ressentir qu’ils sont aimés d’un amour infini. A l’aumônerie, je suis épanouie car ma mission c’est d’accueillir tout le monde sans jugement, indépendamment de sa confession et de vivre la solidarité. C’est cela être chrétien.
Deux communautés proches de la paroisse
Deux communautés, tout en ayant leur vie propre, sont néanmoins très proches de la paroisse et des liens forts existent avec elles. Il s’agit d’une part des Focolari, installés à Montet et, d’autre part, des Dominicaines vivant dans le monastère d’Estavayer.
Fondé en 1943 à Trente en Italie dans une période de guerre, le mouvement de Chiara Lubich souhaite mettre en route un « nouveau peuple né de l’Evangile » qui reste fidèle au Pape. Aujourd’hui présents dans de nombreux pays du monde, ces communautés ou foyers vivent l’Evangile au quotidien « Afin que tous soient un. » (Jn 17, 21) Depuis 40 ans, à Montet, nous avons la chance d’accueillir l’une de ces communautés où des jeunes jusqu’à cette année viennent effectuer leur deuxième année de formation rythmée le matin par un enseignement théologique et l’après-midi par le travail.
A Estavayer, le monastère des Dominicaines fait partie de la vie de la Cité, ne serait-ce que parce qu’il est implanté en plein cœur de la ville et que l’on peut entendre les cloches signaler les nombreux temps de prière que les moniales consacrent au Seigneur durant la journée. Malgré leur désormais petit effectif, malgré l’âge élevé de certaines sœurs, les moniales restent très actives et accueillantes, notamment à « La Source », leur hôtellerie très appréciée. Elles se sont aussi lancées avec courage dans la production d’une gamme de produits de soins qui s’avère être un succès.