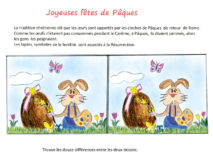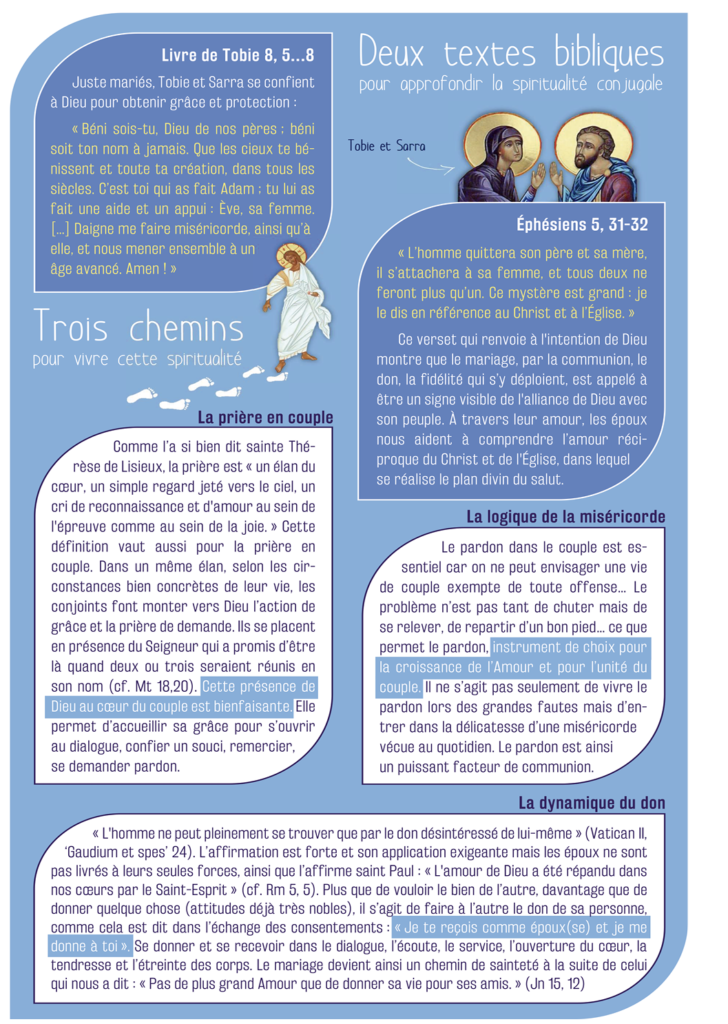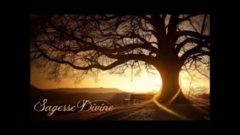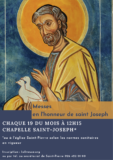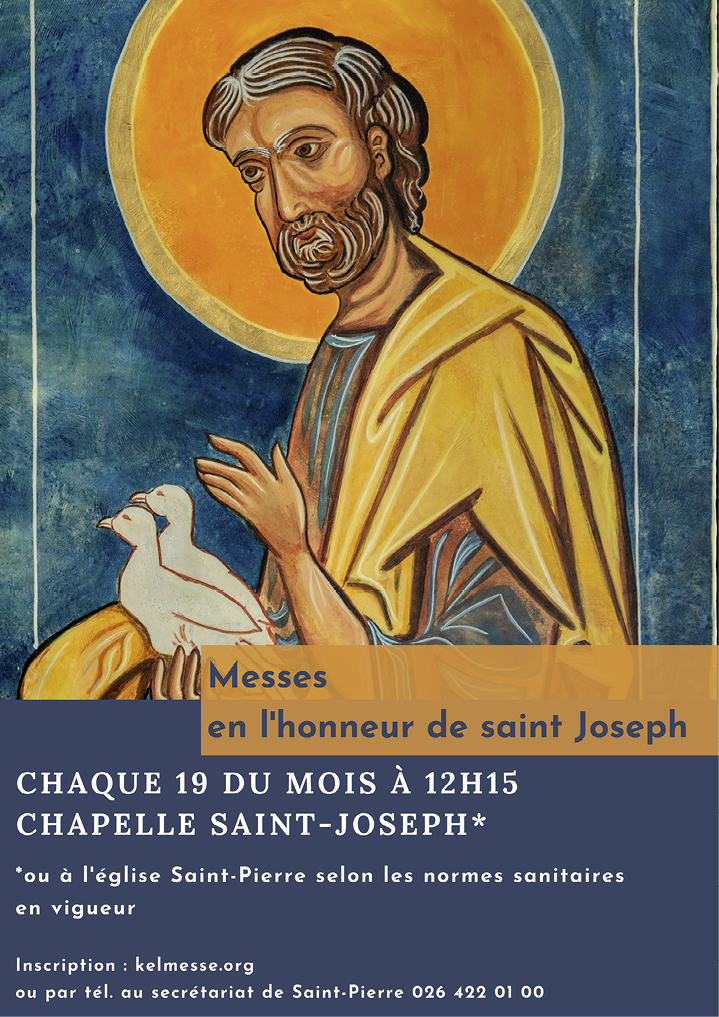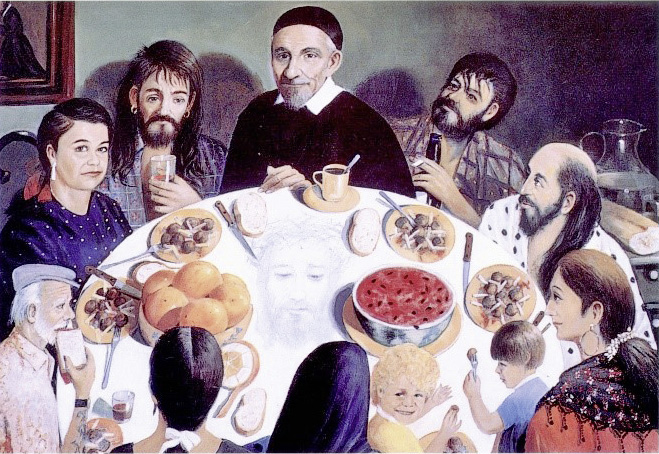Après quatre législatures au Conseil national, Dominique de Buman a pris sa retraite politique en 2019. Le « retraité à mi-temps » évoque des mandats professionnels correspondant à ses convictions, des engagements politiques qui lui tiennent à cœur et un « C » qui disparaît…
PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER
La retraite d’un politicien, ça ressemble à quoi ?
Ce n’est pas une vraie retraite. Les mandats purement électifs sont terminés, mais j’ai des activités professionnelles qui sont le prolongement de mon engagement politique. Proche de l’âge légal de la retraite, je n’y étais pas encore formellement et surtout pas moralement prêt. J’ai eu en amont un certain nombre de contacts afin de pouvoir poursuivre des mandats qui correspondent à mes convictions, à mon expérience et à ma vision de l’éthique dans les affaires.
La vôtre est plutôt celle d’un homme engagé, puisque vous avez prêté votre image à l’initiative pour des multinationales responsables ?
L’initiative a été déposée lorsque j’étais encore à Berne. La cause me semblait juste. J’ai réalisé qu’un bon nombre d’élus manquaient de courage par rapport à cette question. Nous avons tout intérêt à ce que les mécanismes économiques soient sains et les entreprises assujetties aux mêmes règles d’éthique. Il y a bien entendu l’aspect environnemental et humain. Pour ce dernier, il me paraissait important d’offrir une protection aux laissés-pour-compte.
On a beaucoup parlé de la nouvelle étiquette du PDC (le Centre), mais qu’en est-il du contenant et du contenu ?
J’ai beaucoup hésité sur l’opportunité de changer le nom du parti. D’un côté, je trouvais que nos prises de position n’étaient peut-être pas toujours en adéquation avec l’Evangile – donc est-ce juste de se dire encore chrétien ? – de l’autre, je ne voulais pas être acteur du démantèlement d’une étiquette chargée d’histoire. Finalement, j’ai voté pour le maintien du nom. Concernant le « flacon », j’ai une petite crainte qu’il n’y ait pas de projets nouveaux. Changer l’étiquette, c’est une chose, mais il faut aussi s’occuper de la qualité du contenu.
Un nouveau nom pour un nouvel élan : voyez-vous poindre ce nouveau souffle ?
C’est trop tôt pour le dire. Il faudra voir avec le temps si cette nouvelle appellation attire vraiment le public visé. C’est-à-dire ceux qui ne désirent pas de mélange entre le politique et le religieux.
N’y a-t-il pas un risque que ce changement de nom pousse aussi à une dilution des valeurs chrétiennes du parti ?
Bien sûr ! Je crains qu’il y ait encore moins de références aux valeurs chrétiennes à l’avenir. La dilution est un risque, puisque le but avoué est d’attirer une nouvelle tranche d’électorat qui aurait eu peur d’une étiquette chrétienne. Mais si la référence chrétienne dissuade, les nouveaux arrivants risquent bien de ne pas avoir d’attachement à ces valeurs-là et donc de diluer celles qui subsistent encore.
Est-ce que cela signifie que la politique et la foi ne font pas bon ménage ?
Non, je ne dirais pas cela. Il est possible de faire de la politique avec honnêteté et conviction, indépendamment du nom du parti. La responsabilité personnelle de chacun est engagée par rapport à sa conscience. Mais la foi est très exigeante, et si on la met en œuvre, on ne peut pas se comporter dans les décisions politiques comme un non-croyant.
Après la difficile année 2020, quels objectifs devraient se fixer vos collègues en fonction pour 2021 ?
La priorité du monde politique devrait être d’assurer la cohésion sociale. Finalement, ne pas laisser les gens sur le bord de la route. Ce devrait d’ailleurs être un but en tant que tel.
Ce dont je suis convaincu en tant que croyant : cette crise doit nous inciter à prier toujours davantage. Elle nous
a donné la preuve de notre fragilité, il nous faut donc demander les forces, le comportement
adéquat et la vision juste pour assumer cette crise. La pandémie nous interpelle, mais elle doit surtout nous pousser à nous améliorer.
Biographie express
Dominique de Buman est né
le 28 avril 1956 à Fribourg.
Il y grandit et effectue une maturité latin-grec au Collège Saint-Michel.
Il obtient ensuite une licence
en droit à l’Université de Fribourg.
1986 : Conseiller communal de la Ville de Fribourg (-1994) et député au Grand Conseil du Canton
de Fribourg (-2003)
1988 : Secrétaire politique
du PDC fribourgeois (-1993)
1994 : Syndic de la Ville
de Fribourg (-2004)
2001 : Président du Grand Conseil
2002 : Président du Groupe PDC
du Grand Conseil (-2003)
2003 : Conseiller national (-2019)
2004 : Vice-président du PDC Suisse (-2016)
2017 : Président du Conseil national (-2018)