Près de 500 jeunes Romands, dont plus de 80 Fribourgeois, ont participé aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à Lisbonne. Petit retour sur les moments forts de cette rencontre.
Par Véronique Benz et João Carita | Photos : J. Carita
Fête nationale
Après une nuit plus ou moins reposante dans les familles ou les lieux de logement collectifs de Colares, les jeunes Romands se sont déplacés vers le nord de Lisbonne pour rejoindre les jeunes venus de Suisse alémanique et de Suisse italienne. Ensemble ils ont célébré le 1er août par des chants de louange, des témoignages ainsi qu’une catéchèse de Mgr Pierre Bürcher, évêque émérite du diocèse de Reykjavik. Pendant la matinée, le groupe a aussi accueilli de manière chaleureuse plus de 40 pèlerins qui ont fait le trajet depuis la Suisse à vélo.
Les catéchèses
Les rencontres « Rise Up » se substituent à la catéchèse traditionnelle des JMJ. Elles proposent à travers une méthode synodale une expérience de foi et de rencontre avec le Christ dans un climat de communion et de participation.
Accueil du pape
Plus d’un million de personnes étaient présentes le jeudi 3 août à la colline de la Rencontre (Parc Eduardo VII) pour la cérémonie d’accueil du pape François. La célébration était animée par l’Ensemble23, un groupe de 50 jeunes de 21 nationalités différentes. Sur scène il y avait aussi le chœur et l’orchestre des JMJ, composé de 210 chanteurs et 100 musiciens provenant de tous les diocèses du Portugal, sous la baguette de Joana Carneiro. Sous la direction du chef d’orchestre Sérgio Peixoto, une chorale composée de 6 personnes sourdes était au service des malentendants.
Le chemin de croix
Lors du chemin de croix qui a eu lieu au parc Eduardo VII, le pape François a demandé aux jeunes : « Est-ce qu’il vous arrive de pleurer de temps en temps ? Y a-t-il des choses dans la vie qui me font pleurer ? Nous pleurons tous dans la vie et Jésus pleure avec nous. » « Jésus, avec sa tendresse, essuie nos larmes cachées. Jésus espère combler notre solitude par sa proximité. Comme sont tristes les moments de solitude », a-t-il souligné. Le pape a parlé des peurs « sombres » qui affectent les personnes, invitant chacun à « prendre le risque d’aimer ».
Veillée de prière
L’un des moments les plus intenses de ces JMJ a été la veillée de prière à Campo da Graça.
À travers la danse et le théâtre, les pèlerins ont été invités à réfléchir sur la manière de rencontrer Dieu dans leur quotidien. L’adoration eucharistique a suivi avec l’exposition du Saint-Sacrement d’une manière simple et profonde, au son d’un orgue. Le silence s’est alors installé dans Campo da Graça, traduisant une communion totale entre les jeunes.
Messe d’envoi
Le pape a exhorté les jeunes à « ne pas avoir peur » de la vie. Il s’adressait aux 1,5 million de participants aux JMJ 2023 au cours de la messe d’envoi, le dernier événement du rassemblement.
« Jésus est la lumière qui ne s’éteint pas, la lumière qui brille là où il fait nuit », a-t-il ajouté. Le pape François a averti : « Personne ne devient lumineux en se mettant sous les projecteurs ou en présentant une image parfaite, forte. »
« Nous brillons lorsque, accueillant Jésus, nous apprenons à aimer comme lui. Aimer comme Jésus nous rend lumineux et fait de nous des œuvres d’amour », a-t-il déclaré. Le pape a également parlé du verbe « écouter », estimant que l’écoute de Jésus représente « tout ce que l’on doit faire dans la vie ». Il a recommandé à chaque jeune de prendre l’Évangile pour y trouver « des paroles de vie éternelle ».
Les prochaines JMJ auront lieu à Séoul en Corée du Sud en 2029. Vous trouverez toutes les informations sur le site : www.jmj.ch

























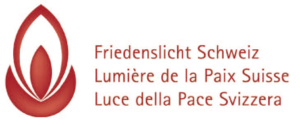 Dimanche 11 décembre à 17h, la flamme de Bethléem sera accueillie à l’église Saint-Paul au Schönberg. Des adolescents ainsi que quelques chanteurs à l’étoile seront les ambassadeurs de cette chaîne de lumière, qui se répandra simultanément dans d’autres lieux d’accueil en Suisse et sur le continent européen.
Dimanche 11 décembre à 17h, la flamme de Bethléem sera accueillie à l’église Saint-Paul au Schönberg. Des adolescents ainsi que quelques chanteurs à l’étoile seront les ambassadeurs de cette chaîne de lumière, qui se répandra simultanément dans d’autres lieux d’accueil en Suisse et sur le continent européen.






















