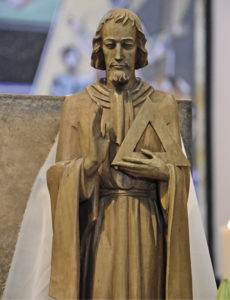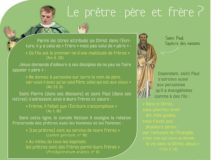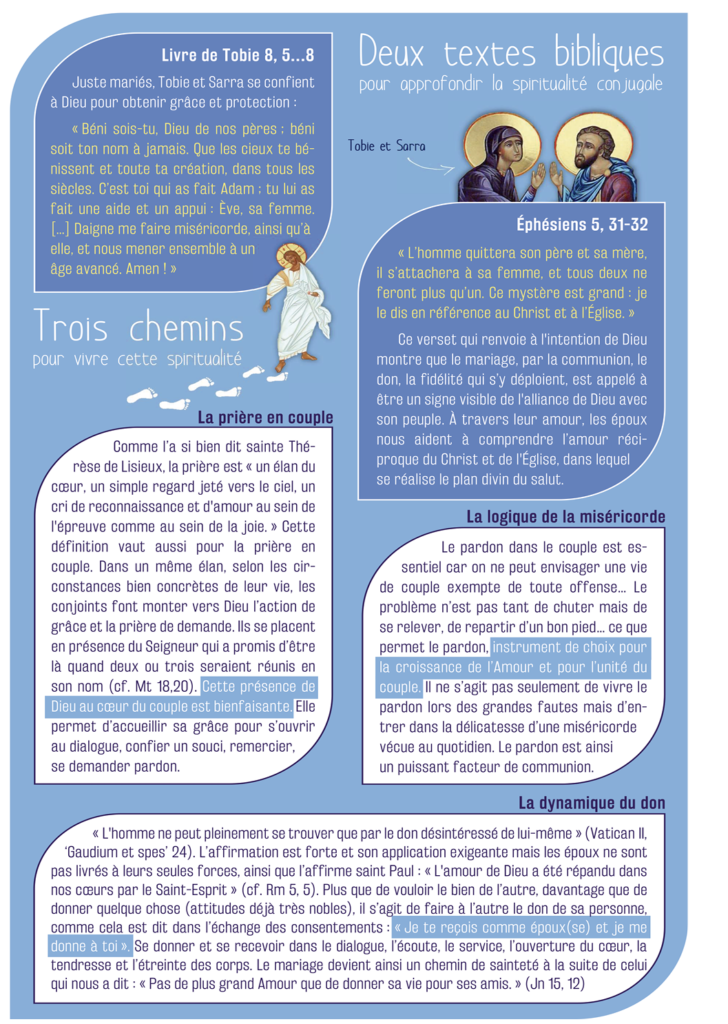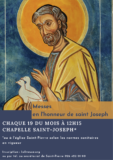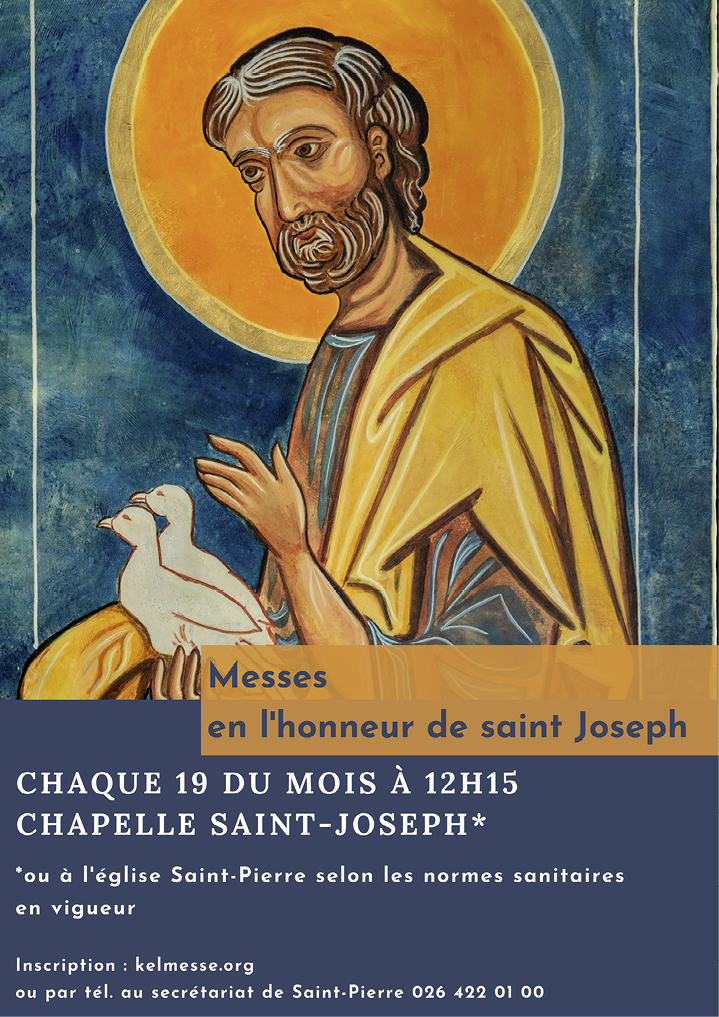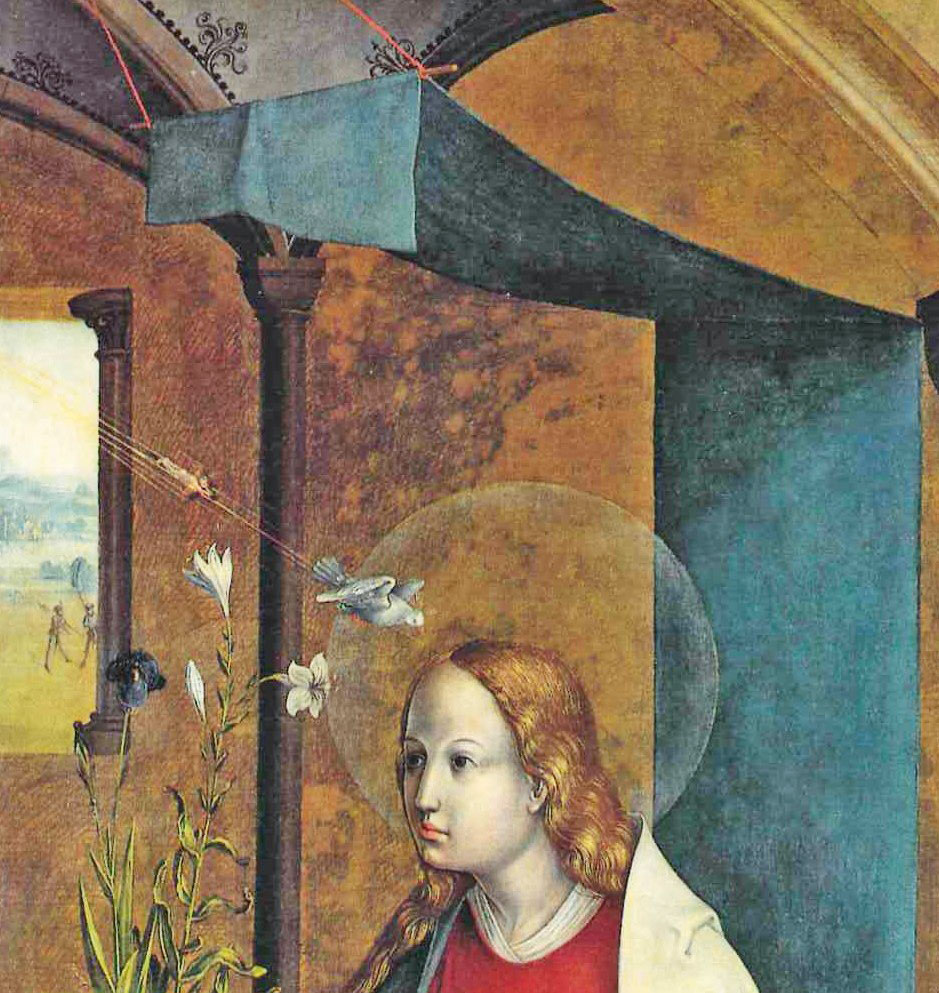Qui paye des impôts paroissiaux ?
Les personnes physiques, de religion catholique, et les personnes morales, c’est-à-dire les entreprises. Et la loi de 1990, qui régit les rapports entre les Églises et l’État, précise que « les personnes physiques et les morales ne peuvent pas être imposées les unes à l’exclusion des autres » (art15). Il n’est donc pas possible d’exclure les entreprises du paiement de l’impôt. Chaque paroisse fixe le taux d’impôt qu’elle juge nécessaire à son fonctionnement dans le périmètre de son champ d’activité. Le taux n’est donc pas identique dans tout le canton. En moyenne cantonale, ce taux est de 7,94%. Ce qui signifie que pour chaque tranche d’impôt de 100 francs versée au canton par le contribuable, le catholique va verser 7,95 francs à sa paroisse. Ce chiffre va varier d’une paroisse à l’autre, puisqu’il s’agit d’une moyenne cantonale.
En tenant compte des rentrées des personnes morales, chaque catholique verse 300 francs par année à sa paroisse, toujours en moyenne cantonale. Le total des revenus des paroisses du canton se monte à 59 millions de francs, par année. C’est ce montant qui fait vivre l’Église fribourgeoise. Même si comparaison n’est pas tout à fait raison, les revenus fiscaux de l’État se montent à 1,3 milliards de francs, au budget 2021, pour des revenus totaux de 3,7 milliards de francs.
Ce revenu de 59 millions de francs est perçu par l’État, qui en assume la tâche administrative, est reversé aux paroisses, sous forme d’acomptes.
À quoi sont affectés ces revenus ?
Tout d’abord, la paroisse va entretenir son fonctionnement: ses locaux et son personnel. Les locaux sont l’église, les chapelles, les croix et d’une manière générale les symboles de la vie religieuse, mais également la cure, les salles paroissiales ou encore ses bâtiments. Quant à son personnel, il peut s’agir des secrétaires paroissiales, des sacristains sans oublier tout le fonctionnement de la pastorale paroissiale, comme des catéchistes ou les premières communions ou les confirmations. Enfin, la paroisse va assumer les frais d’achats propres à son fonctionnement, comme les fleurs de l’église ou les hosties.
En contrepartie le paroissien va pouvoir disposer de « son » église pour des mariages ou des enterrements.
Ensuite, la paroisse va participer aux dépenses communes. La plus importante est la caisse des ministères qui paye les salaires des prêtres et des agents pastoraux. Dans le canton de Fribourg, cela représente quelque 400 personnes, pour un montant de 10 millions de francs, réparti entre les paroisses.
Enfin, le fonctionnement de la Corporation ecclésiastique catholique (CEC) est également une tâche à la charge des paroisses. Si ces dernières coordonnent la « pastorale territoriale », c’est-à-dire la pastorale sur leur territoire, la Corporation ecclésiastique coordonne la « pastorale catégorielle », c’est-à-dire la pastorale par champs d’activité. Par exemple : la pastorale de la santé dans les EMS et les hôpitaux, la pastorale dans les institutions pour les personnes en situation de handicap, le service de la formation pour les agents pastoraux, la pastorale pour les couples et les familles, la pastorale des jeunes, l’enseignement dans les Cycles d’orientation, ou encore le service de la catéchèse et du catéchuménat du canton.
La CEC contribue également au bon fonctionnement des services de conduite du vicariat épiscopal et de l’évêché, de La Doc (librairie et médiathèque) une mine de plus de 10’000 documents (livres, revues DVD etc, ouverte à tous), et au service de la communication. Enfin, il convient de mentionner les trois missions linguistiques : lusophones, hispanophones et italophones soutenues par l’ensemble des paroisses, par le biais de la CEC.
La part de la pastorale
Toujours sans vouloir être exhaustif, il est judicieux de relever que l’Église soutient, à travers les subventions versées par la CEC, bon nombre d’organismes, comme Caritas, le Centre catholique romand de formations en Église, le centre Sainte-Ursule ou plus modestement l’émission « Coin de Ciel » du dimanche matin sur Radio Fribourg.
En guise de conclusion, et toujours d’une manière générale, une paroisse dispose des deux tiers de son budget, le dernier tiers étant lié aux dépenses de la caisse des ministères et de la Corporation ecclésiastique. Enfin, il est très difficile d’estimer la part des dépenses d’une paroisse pour la pastorale ou pour son fonctionnement, tant la frontière entre ces deux types de dépenses est ténue. Mais selon un petit sondage auprès de conseils de paroisse, une bonne moitié des dépenses concernerait la pastorale.



 Dans son livre, l’abbé Jacques Rime propose vingt-cinq itinéraires à travers les sept districts du canton. Chaque itinéraire illustre un ou plusieurs aspects des riches rapports entre la foi et l’espace : les chapelles du terroir, la civilisation de la procession, les chemins de Compostelle, le christianisme et les points cardinaux, le christianisme et la montagne, la recherche du silence par les moines loin des villes, les lieux naturels dits sacrés… (un arbre, une source), la raison psychologique de l’attrait des grottes de Lourdes, les lieux mémoriels, les cloches et l’espace sonore, etc. De belles découvertes en perspective.
Dans son livre, l’abbé Jacques Rime propose vingt-cinq itinéraires à travers les sept districts du canton. Chaque itinéraire illustre un ou plusieurs aspects des riches rapports entre la foi et l’espace : les chapelles du terroir, la civilisation de la procession, les chemins de Compostelle, le christianisme et les points cardinaux, le christianisme et la montagne, la recherche du silence par les moines loin des villes, les lieux naturels dits sacrés… (un arbre, une source), la raison psychologique de l’attrait des grottes de Lourdes, les lieux mémoriels, les cloches et l’espace sonore, etc. De belles découvertes en perspective.