Par l’abbé David Roduit
Photo : Pixabay
C’est le week-end du dimanche de la Parole institué par le pape François que je rédige cet éditorial qui porte sur mon expérience du rapport entre Bible et archéologie.
Je ne peux pas du tout me réclamer de compétences archéologiques, même si, dit avec humour, j’aime creuser les choses, aller en profondeur et ai d’ailleurs toujours été intéressé par l’histoire.
En fait, je voudrais revenir avec vous sur un ou deux souvenirs de mes années d’études au séminaire et à l’université.
Un premier souvenir se passe lors d’une retraite d’Avent au Simplon où le prédicateur jésuite avait évoqué le livre des archéologues Israël Finkelstein et Neil Asher Sibermann, la Bible dévoilée. L’historicité de la conquête cananéenne après l’Exode, comme expliquée dans les Ecritures, était clairement relativisée. J’avais été troublé par ces affirmations, à l’instar d’autres critiques produites par les sciences historiques sur ce qui me semblait gravé dans le marbre de la Bible et de mes certitudes… à défaut de l’être dans les pierres découvertes (ou non) par les archéologues…
A contrario, mes études me permirent de suivre un cours de traduction du Grand Rouleau d’Isaïe, un des manuscrits bibliques découverts à Qumrân en 1947. Alors que dans l’imaginaire de beaucoup les manuscrits de la Mer Morte sentaient le mystère et peut-être un peu le soufre, j’ai été très rassuré de ce que j’y découvrais et apprenais. Si tout est moins simple que l’on se représente au premier abord, la fiabilité de notre texte biblique actuel est très largement confirmée. D’autres cours m’ont appris la vraisemblabilité historique de telle ou telle pratique ou coutume décrite dans les Ecritures saintes. Il est également devenu quasi impossible de mettre en doute l’historicité de la personne de Jésus, comme on avait pu le faire dans des universités au XIXe siècle.
Il ne me fallait donc pas être effrayé des résultats des découvertes historiques, même si elles avaient dans un premier temps ébranlé ma foi. Je devais par contre affiner ma lecture de la Bible, en connaissant mieux les différents genres littéraires utilisés (récits d’origine ou récits mythiques, épopées, évangiles…). La non-historicité de certains faits racontés dans la Bible me permit de mieux comprendre que c’est un message de foi qu’elle désirait transmettre, l’expérience de Dieu d’un peuple. Certains événements ont ainsi été relus dans une perspective croyante et amplifiés théologiquement.
C’est ce sens qui vient me rejoindre aujourd’hui et qui me fait vivre !






















 En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et son frère André occupés à pêcher. Il leur dit: «Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent, et il les envoya pour que se répande la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre.»
En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et son frère André occupés à pêcher. Il leur dit: «Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent, et il les envoya pour que se répande la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre.»
 Photo: Robert Zuber
Photo: Robert Zuber Photo: Camp Biblique Œcuménique de Vaumarcuse
Photo: Camp Biblique Œcuménique de Vaumarcuse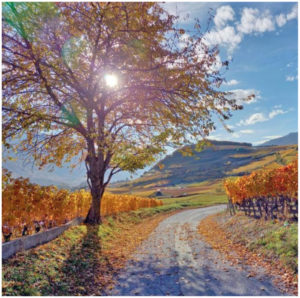 Photo: Robert Zuber
Photo: Robert Zuber Photo: Rémy Delalay
Photo: Rémy Delalay





