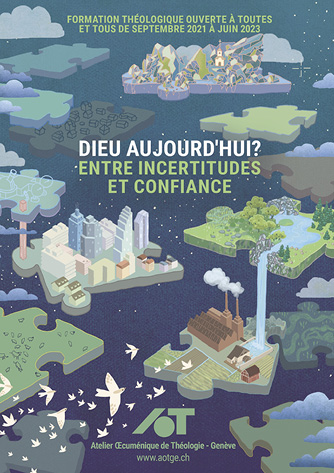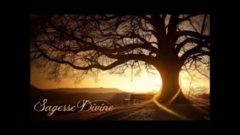Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, unité pastorale Sainte-Claire (FR), octobre-novembre 2019
Au nom du comité: Jacqueline Mardelle, présidente ; Jean-Bernard Livio, sj
Photos: DR
En 2005 lors d’un voyage en Terre sainte guidé par le Père Jean-Bernard Livio, jésuite, les pèlerins ont eu un coup de cœur en découvrant dans les institutions de Palestine de nombreux enfants en situation délicate. Pour leur venir en aide, nous avons alors fondé l’Association « Les Amis des Enfants de Bethléem ». Selon ses statuts, l’Association à but non lucratif a pour objectif d’aider les enfants défavorisés de Bethléem et de la région par tous les moyens juridiques, financiers et matériels, notamment par la formation d’un personnel spécialisé dans la petite enfance.
Nous nous sommes vite rendu compte que ce qui manquait le plus à ces enfants, c’est un cadre où ils puissent s’épanouir, développer leur esprit de créativité, jouer, rêver. L’expérience nous a amenés à introduire auprès de leurs éducatrices des techniques de psychomotricité, bien connues dans les milieux éducatifs européens, mais totalement inconnues là-bas. Notre Association s’est donc engagée dans le développement psychomoteur de la petite enfance, avec pour défi d’atteindre le plus grand nombre d’enfants possible, de 2 à 12 ans. Pari tenu, puisqu’avec notre équipe locale composée de cinq membres nous touchons actuellement près de 180 enfants chaque semaine, dans les différentes institutions où nous œuvrons, afin d’atténuer les traumatismes dus à la violence, à l’enfermement physique qu’impose la situation politique, au manque de respect qui les entoure.
En 2020, nous sommes actifs dans les institutions suivantes :
– Les Sœurs du Rosaire, congrégation de femmes arabes fondée par sainte Marie Alphonsine Ghattas, canonisée par le pape François le 17 mai 2015.
– L’institution LifeGate, accueillant des enfants en situation de handicap est une organisation chrétienne allemande. Le travail de LifeGate est basé sur l’espoir et l’amour pour tous les peuples qui sont enracinés dans la foi chrétienne.
– L’institution S.I.R.A. (Swedish International Relief Association) chrétienne œcuménique est une école spécialisée dans l’accueil des enfants rencontrant de grandes difficultés d’apprentissage et victimes de graves problèmes sociaux.
– Le Centre culturel Ghirass, établissement laïque, accueillant des enfants de camps de réfugiés et de villages autour de Bethléem.
Notre désir profond est de parvenir à changer petit à petit les mentalités, apportant aux institutions de nouveaux outils pour mieux encadrer l’enfant et montrer à la société combien il est important de prendre soin de leurs enfants qui deviendront les femmes et les hommes de demain.
Notre constat
La Palestine est étranglée entre un contexte politique difficile et des traditions patriarcales et familiales en plein bouleversement. La formation universitaire, de bon niveau, laisse des jeunes sans débouchés car le marché de l’emploi est saturé. Les grands-parents, voire les parents, n’acceptent guère cette situation sans autre espoir que de quitter le pays ; ils souhaitent offrir le meilleur à la jeune génération : mais les écoles officielles sont débordées, et les institutions privées coûtent cher.
L’aide pour une prise en charge de la petite enfance s’avère plus urgente que jamais, pour qu’une nouvelle génération se prépare à prendre en mains l’avenir du pays.
C’est pourquoi, en plus de notre présence dans les différentes institutions qui nous ont sollicités, nous constatons l’importance de donner aux éducatrices et éducateurs une formation qui leur permette de devenir des acteurs d’une communauté en construction en termes de principes d’éducation.
Ce constat est devenu notre motivation première : former, dans le plus possible d’institutions s’occupant de la petite enfance et tout spécialement d’enfants en difficultés physiques ou scolaires, du personnel capable de se prendre en charge, afin d’aller vers d’autres institutions, une fois formée l’équipe en place.
Convaincus que c’est l’approche et les techniques psychomotrices qui répondent le mieux aux besoins de la société locale, nous avons décidé de créer un Centre de formation, grâce à l’appui et les compétences de l’HETS (Haute Ecole de travail social) de l’Université de Genève, avec laquelle notre Association a signé un contrat de partenariat.
Pour ce faire, nous privilégions l’engagement dans des institutions privées chrétiennes, seules, à notre connaissance, préoccupées de l’avenir de la petite enfance défavorisée dans ce pays.
Nos objectifs aujourd’hui
– Soutenir le développement des enfants par l’intermédiaire de l’enrichissement des compétences des professionnels qui les encadrent, plus précisément concernant l’importance du droit de jouer comme vecteur de développement ;
– promouvoir le droit d’apprendre à son rythme en tenant compte de l’épanouissement de sa personnalité autant que des apprentissages/prérequis scolaires ;
– favoriser une vision de l’éducation qui aide les enfants à grandir et à devenir des adultes de demain en contexte fragile ;
– donner des moyens nouveaux à des professionnels engagés sur le terrain, en les soutenant dans leur compréhension des besoins des enfants qu’ils accompagnent ainsi que dans leurs capacités à élargir leurs moyens d’intervention ;
– soutenir un changement de regard sur l’enfant et son développement.
Les moyens à mettre en place
– Des interventions directes auprès de professionnels d’institutions spécialisées, de centres communautaires et d’écoles accueillant des populations d’enfants (de 2 à 12 ans) par des collaborateurs expérimentés de notre Association ;
– la préparation de la relève au niveau de l’Association par la formation de nouveaux collaborateurs ;
– la diffusion de l’expérience de l’Association – ainsi que des connaissances et compétences qui y sont associées – auprès des professionnels de la région de Cisjordanie, en collaboration avec la filière Psychomotricité de la HETS-Genève.
Une approche spécifique: la création d’un Centre de formation
La psychomotricité a été choisie, car elle est une approche qui contribue au développement de la personnalité en favorisant une vision des besoins de l’enfant qui s’appuie sur le rôle de l’expérience corporelle et du jeu. Pour cela, un programme de formation a été lancé dès l’automne 2019 : douze éducatrices, mandatées par leurs institutions ci-dessus mentionnées qui s’y sont engagées par contrat, vont suivre un parcours de dix-huit mois afin de devenir les animatrices de ces techniques pédagogiques au service de la petite enfance dans leurs institutions. Trois éducateurs ayant rejoint notre équipe locale suivent également cette première volée 2019-2021.
Pour cette première volée, notre Association s’est proposé d’offrir cette formation en en assumant entièrement les frais, car la nouveauté de la démarche et les difficultés financières des institutions concernées ne nous permettent pas pour l’heure d’exiger une contrepartie financière de leur part. Or notre Association ne vit que des dons de ses membres, sans aucun subside d’organismes d’Etat ni en Europe ni en Palestine.

Une formation honorée d’un diplôme
Le sérieux de la démarche est garanti par l’engagement de professeurs de l’HETS, un « diplôme » honorera les éducatrices et éducateurs qui auront suivi tout le parcours avec succès. Les mesures sanitaires imposées à cause du Covid-19 ont momentanément interrompu les sessions de formation. Nous espérons vivement pouvoir les reprendre dès le printemps prochain, afin de pouvoir décerner un diplôme à celles et ceux qui auront suivi avec succès l’ensemble du parcours.
Nous vous remercions de faire connaître notre travail autour de vous. Une certaine confusion règne parfois dans les milieux catholiques avec l’Hôpital des enfants de Bethléem, pour lequel la quête de Noël est recommandée par nos évêques sous le nom de « Bethléem – Secours aux enfants ». C’est pourquoi nous vous proposons d’intéresser les personnes qui le souhaitent, tout spécialement les familles, de nous envoyer leurs dons à l’occasion d’un mariage, d’un baptême, d’une confirmation, ou d’une fête de famille.
D’avance, nous vous adressons nos vifs remerciements pour l’intérêt que vous porterez à notre requête.
Vous en saurez plus en consultant notre site :
www.amisdesenfants-bethleem.net
IBAN : CH79 0900 0000 1757 4313 0